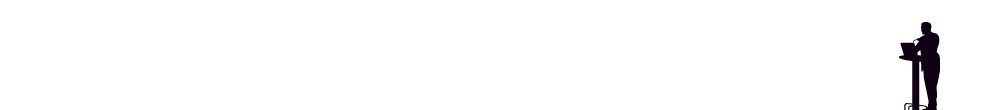Les camps d'extermination sont un contre-sens historique
Par définition, un dictionnaire historique donne le sens des mots et des notions d'histoire qu'ils nomment. Celui de Daniel Bovy sur la barbarie nazie et la Shoah s'attache à les utiliser, les uns et les autres, à bon escient. Non pas seulement parce qu'ancien journaliste, l'auteur sait ramasser l'information en un raccourci qui en communique l'essentiel. Il sait aussi, dans les articles qui interpellent le civisme des droits humains, se donner le plaisir de laisser aller sa plume. Il n'en abuse pas. De sa pratique d'enseignant - il est professeur de morale laïque dans l'enseignement secondaire -, il a cet art de la communication qui manque souvent aux historiens de formation. Lui, c'est sa passion.
Aussi, sa militance : il prête son concours au service pédagogique des " Territoires de la Mémoire ", le Centre d'éducation à la Tolérance et à la Résistance, établi à Liège. Passionné d'histoire du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, c'est un bibliophile acharné et infatigable. Il lit les auteurs dans le texte. Internaute infatigable, il exploite aussi toutes les ressources du Web sur cette période nazie, excédé par la vitesse de circulation des sites négationnistes, ajoute-t-il.
Cet accès direct à toutes les sources de l'historiographie - pour autant qu'un seul lecteur puisse maîtriser leur abondance - est, en l'occurrence, un réel atout. Pour l'essentiel, l'historiographie de l'Allemagne nazie et le génocide juif 1- pour reprendre un titre fameux autant que rare - ne s'écrit pas en français. Les percées éditoriales opérées ici ou là depuis les années quatre-vingt et surtout la dernière décennie n'ont pas vraiment changé la donne. Sauf les études locales où ils excellent, les chercheurs francophones ne travaillent guère sur la problématique générale du nazisme et de la solution finale. D'Hitler et les Juifs à La solution finale de la question juive, les exceptions sont rares et leur qualité est d'autant plus remarquable 2. Le sujet se traite plutôt en anglais, et même, sinon surtout, en allemand. En retard de traductions, les éditeurs publient - fort à propos au demeurant - des études sur ces historiens allemands [qui] relisent la Shoah 3 ou s'emploient à comprendre Hitler et la Shoah 4. Ce n'est donc pas le moindre intérêt du dictionnaire de Bovy d'apporter au lecteur francophone qui n'y a pas accès les acquis de cette historiographie si féconde.
L'honnête homme y trouvera, plus d'un demi-siècle après l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne, un état des lieux des connaissances indispensables à une conscience historique responsable. C'est à cet égard qu'on appréciera, chez Daniel Bovy, son souci du mot approprié. On ne s'étonnera pas qu'il porte une attention soutenue au langage nazi. Il lui consacre un substantiel article pour justement en déconstruire la perversion, mais il lui faut poursuivre transversalement, d'article en article, cette traque de la Lingua Tertii Imperii. Les carnets d'un philologue, Victor Klemperer, annotaient au jour le jour, à l'époque, les manipulations de cette langue du IIIe Reich. Lui était juif, un Juif dit " mixte ", ce qui veut dire marié à une " aryenne ", cet autre exemple de détournement de la langue, qui illustre sans conteste le nazisme, mais procède aussi de cette hétérophobie commune aux discours d'exclusion racistes et xénophobes. La traque des mots piégés et le dévoilement de leurs euphémismes sont une démarche élémentaire, même si elle incite, avec son insistance sur les significations, à privilégier l'idéologie.
L'histoire n'est pas seulement le déroulement et l'accomplissement de l'Idée, elle donne à voir les hommes qui en sont les porteurs agir dans des structures et selon des circonstances tout aussi déterminantes. Il n'empêche, a fortiori dans un dictionnaire, qu'il importe à chaque fois, de restaurer le sens des mots de l'histoire, de les démythifier.
Ce travail critique indispensable à la compréhension doit s'appliquer tout autant aux usages qui ne sont pas d'époque,ceux de la mémoire où les mythes sont d'une autre nature, plutôt d'une autre idéologie. Il faut sans doute faire, ici, cette mise au point à propos des camps. Ce Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah leur consacre par vocation une série de notices. Daniel Bovy en a bien saisi l'enjeu heuristique. " Il est important dans la problématique de la Solution finale, écrit-il d'emblée, de bien différencier "camps de concentration" et "centres de mise à mort" ". L'article sur les camps où il évite le leurre du " camp d'extermination " est à cet égard des plus pertinents. Il n'empêche qu'au détour de la documentation, l'expression surannée refasse surface. Elle a une telle prégnance dans la mémoire collective qu'elle trouve toujours à s'imposer avec sa tentation d'ancrer la radicalité du judéocide dans l'horreur concentrationnaire. Il faut ici, dans cette préface où la place n'est pas chichement comptée, réfléchir à ce mythe de l'après-1945 et prendre la mesure de sa distance à l'histoire.
Historiquement, la formule de " camp d'extermination " est inappropriée. Elle implique que les SS, tuant cependant en masse les déportés juifs à leur arrivée, auraient aussi enfermé dans leurs camps ceux qu'ils avaient l'ordre d'exterminer et dont ils différeraient la mise à mort, les faisant mourir plutôt que de les tuer et déclinant ainsi dans tous les sens le registre du génocide. Cette " mémoire d'Auschwitz " qui est aussi la mémoire de Nuremberg, prend appui sur le témoignage des rescapés et donc sur leur expérience concentrationnaire. Elle inscrit dès lors " la solution finale de la question juive " dans le système des camps. Comme à Auschwitz-Birkenau - et à cet égard, on parle d'un " événement Auschwitz " -, le principe en aurait été la sélection, les Juifs aptes au travail dans les camps, les inaptes à la chambre à gaz. Cet argumentaire qui fait d'Auschwitz l'archétype insiste sur la chambre à gaz qui n'y a pas été expérimentée pour les Juifs et dont ceux-ci n'ont pas été les seules victimes.
Cette lecture d'Auschwitz comme modèle du " camp d'extermination " dévie la signification effective du programme exposé par les autorités SS à la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942. Annonçant aux autres administrations centrales du Reich " l'évacuation des Juifs vers l'Est, solution adoptée avec l'accord du Führer ", le chef de la Sécurité du Reich assurait néanmoins que " les Juifs valides " seraient " affectés au service du travail " et que même des Juifs allemands, pourtant victimes obligées du judéocide hitlérien, ne seraient pas évacués s'ils étaient occupés à l'armement 5. Ce pragmatisme productiviste ne signifie pas que la mobilisation forcée de la main d'œuvre juive soit devenue l'un des chapitres de la " solution finale ". Elle s'inscrit, dit bien le compte rendu, " dans [ce] cadre ", mais elle n'en est justement pas le cadre. On prévoit " qu'une grande partie d'entre eux s'éliminera tout naturellement par son état de déficience physique. Le résidu qui subsisterait en fin de compte - et qu'il faut considérer comme la partie la plus résistante - devra être traité en conséquence ". En d'autres termes, l'hypothèque de l'économie de guerre enfin levée, les survivants seraient à leur tour traités comme les inaptes, c'est-à-dire exterminés. En conformité avec l'idéologie, ils réintégraient ainsi la solution finale à laquelle ils avaient échappé pour opportunité économique. Il n'avait été question, en effet, pour " les Juifs aptes au travail " que d' " interrompre leur voyage [vers l'Est] et [d']exécuter des travaux d'armement ", comme l'explique le chef de l'administration économique de la SS au plus fort de la grande vague des déportations juives en été 1942 6. Dans le texte même, ce dispositif s'applique à Auschwitz. Dans cette litote nazie où le " voyage vers l'Est " désigne l'extermination des Juifs, jugés aptes ou non au travail, le pragmatisme économiste dispute le terrain à l'idéologie. Par ce prélèvement de main d'oeuvre dans les convois juifs en provenance de Pologne et d'Europe, le Konzentrationslager Auschwitz - appellation d'époque pour un combinat de quelque quarante camps et autres commandos - devint, à partir de 1942, un camp principalement " juif " et le plus peuplé du système des camps nazis 7. En janvier 1945, au moment où toute l'organisation concentrationnaire se disloque, précipitant ses détenus dans un désastre démographique, un sur quatre est passé par la matricule d'Auschwitz et un sur huit est juif. S'agissant justement de ce complexe si souvent présenté, y compris pour ses détenus, comme un " camp d'extermination ", il faut constater que le modèle n'a pas connu la dernière période des camps, la plus catastrophique, des derniers mois du Reich millénariste.
Le repli de ses forçats de travail sur les camps de l'intérieur, entrepris dès avant l'entrée de l'armée rouge en Pologne en 1944 et poursuivi jusqu'aux marches de la mort précipitées en janvier 1945, donne à voir un bilan de l'internement à Auschwitz particulièrement meurtrier. Le plus grand des camps nazis a aussi été le plus destructeur pour ses détenus. De 1940 à 1945, la matricule du camp leur en a attribué environ 400.000 numéros, plutôt 360.000 effectivement distribués 8. Grosso modo, la moitié de ses détenus n'ont pas survécu à la captivité dans les camps et commandos d'Auschwitz 9. On ne parle évidemment pas ici du sort de la masse des déportés parvenus à cette destination qui n'y ont pas été détenus ! La forte mortalité des bagnards d'Auschwitz reste néanmoins dans la norme macabre des Konzentrationslager. Le nombre des décès à Mauthausen est de justesse aussi à six chiffres, il en est à cinq à Dachau, à Buchenwald, tous chiffres qui comprennent des évacués d'Auschwitz, juifs ou non, tous sortis vivants du " camp d'extermination " de référence. Ces derniers tout autant que l'accumulation de morts dans les autres camps de concentration - y compris dans une plus forte proportion, les évacués d'Auschwitz survivants des marches de la mort de janvier 1945 - interpellent cette désignation singulière de ce camp-là en particulier. Le " camp d'extermination " ne commence à prendre du sens qui le distingue du camp de concentration qu'en référence aux déportés - et ce ne sont que des Juifs 10 - refusés d'immatriculation à Auschwitz. Mais justement ce refus d'une trace administrative des Juifs du génocide implique que la formule ne soit pas d'usage à l'époque. Il n'existe pas de " Vernichtungslager " dans le jargon administratif du IIIe Reich et de ses multiples camps de toutes sortes.
Tout au plus, une source, le journal personnel d'un témoin allemand, un médecin SS d'Auschwitz, Johan-Paul Kremer, l'identifie comme " le camp de l'extermination ", " das Lager der Vernichtung ", écrit-il le 2 septembre 1942 11. Cette source, bien connue, est souvent interprétée à contresens et on y lit même le " Vernichtungslager " du texte allemand d'après-guerre. J'ai montré, dans Les Yeux du témoin et le regard du borgne, que le SS-Untersturmführer Kremer découvre cette fonction exterminatrice d'Auschwitz-Birkenau, au cours de sa première " Sonderaktion ".
Cette " action spéciale " a lieu, précise le témoin, " à l'extérieur ", en l'occurrence contre un convoi juif de France, le n° XXVI, arrivé le 2 septembre 1942 et réduit d'un coup de 74% de son effectif au cours de cette tuerie. Plus loin, le journal confirme que ces " actions spéciales " s'effectuent le plus souvent sur des " gens de l'extérieur ". À une ou deux reprises, il signale même l'arrivée de " Hollandais " et de " gens venant de Hollande ". Le recoupement avec d'autres sources existantes (listes de déportation au départ des camps de rassemblement de l'Ouest, séries des matricules attribués aux nouveaux internés du camp de concentration) confère au journal du médecin SS le statut d'un document capital sur le génocide des Juifs d'Europe occidentale à Birkenau. Une de ses " actions spéciales " date de l'arrivée d'un convoi juif de Belgique, le n°VIII, exterminé aux deux tiers après son débarquement, un taux d'extermination immédiate de 65% au moins. Mais c'est à propos des " Hollandais " que le document d'époque est le plus explicite. Avec le convoi hollandais, le n° XXV, arrivé le 12 octobre, l'officier SS ne peut s'empêcher, en dépit des consignes de secret, d'acter les " scènes horribles devant le dernier bunker ". L'analyse historique révèle que 73% des déportés de ce transport ne laissent plus d'autre trace dans l'histoire. Le 18 octobre, le convoi suivant des Pays-Bas, le n° XXVI, donne lieu, note le SS, à des " scènes horribles avec trois femmes qui suppliaient de leur laisser la vie sauve ". Le taux d'extermination immédiate du convoi est pourtant moindre, tout en restant dans la norme du judéocide à Birkenau, avec 60% du contingent disparus à jamais dès son arrivée. Resitué dans le contexte des notes quotidiennes du témoin SS, son " camp de l'extermination " n'apparaît plus comme un camp de captivité, d'internement. Tout au plus comme un campement de garnison, encore que l'officier SS de passage, l'un des plus âgés, loge à l'hôtel pendant les trois mois de son temps à Auschwitz. En tout cas, et de manière tout à fait significative, le processus qu'il a consigné se déroule à l'extérieur et essentiellement sur des gens de l'extérieur, à leur arrivée. En 1942 et encore au début de 1943, les déportés prévus pour l'extermination débarquent à la rampe dite des Juifs en dehors de tout camp. Ils descendent du train en pleine campagne, après Auschwitz et avant Birkenau. La plupart ne sont pas retenus pour le camp de concentration. Physiquement, ils n'entreront dans aucun camp, quel qu'il soit. Des camions viennent les prendre à la rampe et les transportent vers " le dernier bunker " du témoin Kremer. C'est, dans le jargon des SS, le Bunker II, une ferme transformée en chambre à gaz, appelée la " maison rouge " d'après la couleur de ses briques et dont il ne reste que les ruines du soubassement. Le Bunker I dont il ne reste qu'une plaque commémorative ignorée des visiteurs de Birkenau, cette " maison blanche " - blanche pour son revêtement - se situe aussi à l'extérieur du camp de Birkenau, dans la même forêt de bouleaux qui borde tout son flanc ouest. Le modus operandi est celui d'une extermination immédiate en dehors de tout camp. Il s'inscrit dans le droit fil des tueries dans le ravin de Babi Yar en septembre 1941, le premier, sinon le plus grand massacre du judéocide. (On lira à ce sujet l'article du dictionnaire de Daniel Bovy). A Auschwitz-Birkenau, au sortir des trains, le seul enfermement des Juifs du génocide est … la chambre à gaz. Elle équipe d'un moyen de mise à mort de masse le SS-Sonderkommando, le commando spécial de la SS et de la police, des tueurs SS en charge de la réception des déportés et de leur mise à mort. Daniel Bovy nous apprend que l'appellation de Sonderkommando est leur dénomination d'usage. Dans Le siècle des camps qu'il écrit avec Pierre Rigoulot, Joël Kotek insiste sur cette mutation du vocabulaire nazi. Du camp avec ses équipements, il ne retient que le Sonderkommando établi à demeure. " Là, distingue fort à propos Le siècle des camps, il ne s'agira pas de cantonner et de parquer des êtres humains, plus ou moins maltraités, mais d'y exterminer méthodiquement et systématiquement, au jour le jour et sans délais, tous les Juifs qui y seront acheminés " 12.
Dans le cas d'Auschwitz néanmoins, le convoi n'est pas entièrement exterminé. Le cas est particulier dans le judéocide. Il s'agit d'une exception aussi paradoxale qu'elle paraisse en regard d'une mémoire qui a pourtant érigé Auschwitz en paradigme de l'extermination. A Kulmhof (Chelmno en polonais) dans le Warthegau, nouvelle province de la Grande Allemagne, et surtout, dans le Gouvernement général de Pologne, à Treblinka, à Sobibor et à Belzec, dans ces " camps " de l' " Aktion Reinhardt " 13, les SS-Sonderkommandos assassinent tous les déportés leur parvenant.
Les chiffres de Daniel Bovy montrent qu'ils tuent deux fois plus de Juifs qu'à Auschwitz : en million de victimes, 1,75 pour 0,865. A la différence, ces camps de campement ne comportent pas de baraquements pour le logement des déportés. Ils ne sont pas adossés à un camp de concentration, comme les bunkers I et II de Birkenau. Tout au plus, logent-ils plusieurs centaines de détenus juifs, pas plus d'un millier, affectés au service des tueurs SS pour l'intendance de la mort et le conditionnement des objets récupérés des déportés. Il en est de même à Birkenau où, isolés du reste du camp, ils ne quittent pas l'espace clos des grands crématoires construits pendant l'hiver, après les grandes tueries de l'été et de l'automne 1942. Par un glissement de sens, on dit qu'ils sont des Sonderkommandos, oubliant qu'ils y sont seulement détenus. Leur témoignage, celui des survivants - ils sont rarissimes - et celui d'époque, absolument exceptionnel, caché sous la cendre, apportent l'autre regard, celui du témoin juif, sur l'expérience quotidienne du génocide 14.
Par une méprise historique, on a voulu en voir soi-même l'image à la libération des camps dans les charniers de cadavres squelettiques découverts en avril 1945. Il y avait quatre mille corps à Ohrdurf, un commando de Buchenwald, et, plus hallucinants s'il le faut encore, ils étaient dix mille à Bergen-Belsen. Ces scènes de la " mort de masse " - selon le mot d'Annette Wiéviorka 15 - dans les camps libérés donnent corps au " camp d'extermination ", le " Vernichtungslager " de l'après 1945. Le sens commun auquel cèdent les dictionnaires d'usage, et les plus sérieux, finira par assimiler les camps de concentrations nazis à des camps d'extermination " où furent affamés, suppliciés et exterminés certains groupes religieux ou ethniques ". On essayera bien dans les variations de la mémoire de rattraper cette dérive et de distinguer les deux " sortes ", les camps de concentration d'une part, les camps d'extermination de l'autre. On visera par ce distinguo surtout le statut d'Auschwitz, pourtant le plus grand des camps de concentration. En passant, Buchenwald perd son statut de métonyme du système concentrationnaire et Auschwitz est désormais " le camp de concentration et d'extermination " par excellence. Cette focalisation de la mémoire a faussé la compréhension même du système concentrationnaire confondu avec l'extermination des Juifs. Il a fallu que les historiens rament à contre-courant pour faire passer la différence. Une des premières études scientifiques des camps de concentration - écrite en français, au temps des pionniers -, la thèse de doctorat d'Olga Wormser n'accorde en 1968 que quelques pages à la solution finale et encore, l'aborde-t-elle pour traquer l'abus des chambres à gaz dans la mémoire des camps de concentration. " Le caractère fondamentalement dissemblable des deux processus " exclut qu'ils se traitent dans le même registre, explique-t-elle 16. Vingt ans après, Wolfgang Sofsky, étudiant en sociologue les camps comme une " organisation de la terreur ", réduit encore le " lieu historique, où le génocide des Juifs coïncida avec l'organisation des camps de concentration " : il le laisse sur " la rampe d'Auschwitz où avait lieu la "sélection" "17. On sait que cette rampe établie dans le camp de concentration de Birkenau date seulement du printemps 1944. Elle a été aménagée pour recevoir le demi-million de Juifs hongrois attendus dans l'ultime grande déportation opérée in extremis. C'est la dernière scène de l'extermination, celle que retiendra la mémoire. Dépourvu de profondeur chronologique - c'est-à-dire d'histoire -, le discours mémoriel fixe ses représentations sur la dernière image d'Auschwitz-Birkenau. Il lui manque les repères pour prendre en compte toute l'histoire. En l'espèce, l'essentiel lui échappe. Sur les 865.000 Juifs gazés à Auschwitz dès leur arrivée, un demimillion n'est jamais descendu sur le quai du " camp d'extermination " de Birkenau et plus de deux cent mille ne sont pas passés par ses crématoires.
Lecture tronquée du judéocide, le " camp " de la mémoire d'Auschwitz fausse aussi la représentation même des camps de concentration. Les Américains et les Britanniques qui les libèrent en 1945 les identifient comme " Extermination camps " et, plus souvent, comme " Death camps ". Cette appellation de " camps de la mort " serait pourtant la plus appropriée pour les camps de concentration si on ne s'employait pas à y inscrire absolument le génocide. Dès 1940 et bien avant que la mise à mort des Juifs ne se commette dans des terminaux ferroviaires équipés pour le meurtre de masse, la mort imprime sa marque sur les grands camps de concentration. Ils s'équipent de fours crématoires dont ils n'étaient pas pourvus dans la période précédente, mais qui s'avèrent indispensables avec l'accroissement de la population concentrationnaire et l'internement généralisé de longue durée. Avec sa cheminée macabre qui domine son architecture, le Konzentrationslager de la Seconde Guerre mondiale apparaît pour ce qu'il est historiquement : un camp de la mort. Il l'est dans une proportion inégalée après l'échec de la Blitzkrieg, la " guerre- éclair " en Union soviétique, à l'automne 1941. C'est alors que s'élabore par à-coups " l'extermination par le travail ". Daniel Bovy préfère traduire " Vernichtung durch Arbeit " par " destruction par le travail ", à l'instar du grand historien américain Raul Hilberg motivé lui aussi par des considérations d'ordre moral. Le concept en est conçu dès la conférence de Wannsee avec ces Juifs aptes au travail dont on escompte la mort " naturelle " " par déficience physique ". Il trouve en septembre 1942 sa formulation officielle - peu usitée, il est vrai - pour tous les camps de concentration 18. Mais, dès avril, une circulaire de l'Administration économique de la SS dont relèvent désormais les camps l'a déjà étendu à toute la population concentrationnaire. Sa mise en oeuvre provoque aussitôt une " mortalité persistante et même croissante " dont doit se plaindre la Sécurité du Reich s'épuisant à compenser les pertes avec de nouvelles vagues d'arrestations 19. Il faut dès lors ordonner, à la fin de l'année, rien de moins que " la mortalité soit réduite [sic] "20. Au final, on retiendra les chiffres collationnés par Wolfgang Sofsky dans L'organisation de la terreur : ils donnent un ordre de grandeur, 1,1 million de morts sur 1,65 million d'entrées, soit les deux tiers 21.
Ces chiffres n'englobent qu'en partie une autre dimension de la barbarie nazie, l'extermination des prisonniers de guerre soviétiques, la plupart par épuisement. Plusieurs dizaines de milliers sont exécutés dans les camps. 11 à 15.000 meurent à Auschwitz. On oublie que jusqu'en 1944, seul le camp d'origine était le Konzentrationslager Auschwitz. Le camp de Birkenau s'érige en 1941 comme un Kriegsgefangenenlager d'Auschwitz, le camp de prisonniers de guerre destiné à recevoir les soldats de l'armée rouge capturés 22. Il conservera cette dénomination jusqu'à sa mutation, fin 1943, en Konzentrationslager Auschwitz II. Mais c'est surtout en dehors des camps de concentration que des millions de prisonniers de guerre soviétiques meurent d'affamement dans les stalags, les camps de soldats. La situation est si catastrophique dans les camps tenus par la Wehrmacht que dès novembre 1941, la Sécurité du Reich décide que " les Russes soviétiques visiblement marqués par la mort et pour cette raison incapables de supporter l'effort ne fût-ce que d'une courte marche, ne seront pas transférés aux camps de concentration pour y être exécu-tés " 23. Les dernières évaluations du traitement réservé par la Grande Allemagne national-socialiste aux prisonniers de guerre soviétiques donnent 2.749.000 morts ou disparus sur un total 5.160.000 captifs 24.
L'autre dimension de la barbarie nazie plus stupéfiante encore ne s'inscrit pas plus dans les camps de concentration. Dans Le Siècle des camps, Joël Kotek l'exprime avec force. " Lorsqu'est abordée la question de la Shoah, écrit-il, c'est la notion même de camp, quels que soient les mots qui servent à qualifier celui-ci (camp de la mort, camp d'extermination), qui est à proscrire. […] Cette notion est en effet toujours déplacée, toujours inopérante "25. Dans La destruction des Juifs d'Europe - il a fallu attendre un quart de siècle pour que cet ouvrage capital soit traduit en français -, l'historien américain en décrit les deux dimensions, d'une part " les opérations mobiles de tueries " dont il chiffre le bilan meurtrier à plus d'1,3 million de victimes. D'autre part, " les centres de mises à mort " - et non des " camps d'extermination " - où sont gazées 2,7 millions personnes. A ces 4 millions de Juifs assassinés au sens propre du terme, tués de mort violente, s'ajoutent plus de huit cents mille morts de privations dans les ghettos, bien plus meurtriers que les camps dont le bilan se chiffre à trois cents mille victimes.
Les camps de concentration où la mémoire persiste à situer la mort de six millions de Juifs sont décidément bien trop étroits pour contenir l'histoire du judéocide. Daniel Bovy utilise aussi ce terme. Il le renvoie à Holocauste, préférant semble-t-il qu'on traite de " la solution finale de la question juive ", " selon l'expression utilisée par les nazis qualifiant ainsi leur génocide et considérant, de leur point de vue, qu'il existe une question juive ", lit-on dans son Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah.
Il faut le lire, un peu comme on fonctionne sur Internet ou comme on feuillette un livre. L'index guide sans doute le choix. Il fixe des points de repère, mais on gagne à se laisser porter par les renvois d'article à article. Et au final, on a un vaste aperçu sur la barbarie nazie et la Shoah, plein de ces " détails " qui donnent son sens à l'histoire.
Maxime Steinberg
Historien,
docteur en Philosophie et Lettres
de l'Université Libre de Bruxelles
Aussi, sa militance : il prête son concours au service pédagogique des " Territoires de la Mémoire ", le Centre d'éducation à la Tolérance et à la Résistance, établi à Liège. Passionné d'histoire du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, c'est un bibliophile acharné et infatigable. Il lit les auteurs dans le texte. Internaute infatigable, il exploite aussi toutes les ressources du Web sur cette période nazie, excédé par la vitesse de circulation des sites négationnistes, ajoute-t-il.
Cet accès direct à toutes les sources de l'historiographie - pour autant qu'un seul lecteur puisse maîtriser leur abondance - est, en l'occurrence, un réel atout. Pour l'essentiel, l'historiographie de l'Allemagne nazie et le génocide juif 1- pour reprendre un titre fameux autant que rare - ne s'écrit pas en français. Les percées éditoriales opérées ici ou là depuis les années quatre-vingt et surtout la dernière décennie n'ont pas vraiment changé la donne. Sauf les études locales où ils excellent, les chercheurs francophones ne travaillent guère sur la problématique générale du nazisme et de la solution finale. D'Hitler et les Juifs à La solution finale de la question juive, les exceptions sont rares et leur qualité est d'autant plus remarquable 2. Le sujet se traite plutôt en anglais, et même, sinon surtout, en allemand. En retard de traductions, les éditeurs publient - fort à propos au demeurant - des études sur ces historiens allemands [qui] relisent la Shoah 3 ou s'emploient à comprendre Hitler et la Shoah 4. Ce n'est donc pas le moindre intérêt du dictionnaire de Bovy d'apporter au lecteur francophone qui n'y a pas accès les acquis de cette historiographie si féconde.
L'honnête homme y trouvera, plus d'un demi-siècle après l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne, un état des lieux des connaissances indispensables à une conscience historique responsable. C'est à cet égard qu'on appréciera, chez Daniel Bovy, son souci du mot approprié. On ne s'étonnera pas qu'il porte une attention soutenue au langage nazi. Il lui consacre un substantiel article pour justement en déconstruire la perversion, mais il lui faut poursuivre transversalement, d'article en article, cette traque de la Lingua Tertii Imperii. Les carnets d'un philologue, Victor Klemperer, annotaient au jour le jour, à l'époque, les manipulations de cette langue du IIIe Reich. Lui était juif, un Juif dit " mixte ", ce qui veut dire marié à une " aryenne ", cet autre exemple de détournement de la langue, qui illustre sans conteste le nazisme, mais procède aussi de cette hétérophobie commune aux discours d'exclusion racistes et xénophobes. La traque des mots piégés et le dévoilement de leurs euphémismes sont une démarche élémentaire, même si elle incite, avec son insistance sur les significations, à privilégier l'idéologie.
L'histoire n'est pas seulement le déroulement et l'accomplissement de l'Idée, elle donne à voir les hommes qui en sont les porteurs agir dans des structures et selon des circonstances tout aussi déterminantes. Il n'empêche, a fortiori dans un dictionnaire, qu'il importe à chaque fois, de restaurer le sens des mots de l'histoire, de les démythifier.
Ce travail critique indispensable à la compréhension doit s'appliquer tout autant aux usages qui ne sont pas d'époque,ceux de la mémoire où les mythes sont d'une autre nature, plutôt d'une autre idéologie. Il faut sans doute faire, ici, cette mise au point à propos des camps. Ce Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah leur consacre par vocation une série de notices. Daniel Bovy en a bien saisi l'enjeu heuristique. " Il est important dans la problématique de la Solution finale, écrit-il d'emblée, de bien différencier "camps de concentration" et "centres de mise à mort" ". L'article sur les camps où il évite le leurre du " camp d'extermination " est à cet égard des plus pertinents. Il n'empêche qu'au détour de la documentation, l'expression surannée refasse surface. Elle a une telle prégnance dans la mémoire collective qu'elle trouve toujours à s'imposer avec sa tentation d'ancrer la radicalité du judéocide dans l'horreur concentrationnaire. Il faut ici, dans cette préface où la place n'est pas chichement comptée, réfléchir à ce mythe de l'après-1945 et prendre la mesure de sa distance à l'histoire.
Historiquement, la formule de " camp d'extermination " est inappropriée. Elle implique que les SS, tuant cependant en masse les déportés juifs à leur arrivée, auraient aussi enfermé dans leurs camps ceux qu'ils avaient l'ordre d'exterminer et dont ils différeraient la mise à mort, les faisant mourir plutôt que de les tuer et déclinant ainsi dans tous les sens le registre du génocide. Cette " mémoire d'Auschwitz " qui est aussi la mémoire de Nuremberg, prend appui sur le témoignage des rescapés et donc sur leur expérience concentrationnaire. Elle inscrit dès lors " la solution finale de la question juive " dans le système des camps. Comme à Auschwitz-Birkenau - et à cet égard, on parle d'un " événement Auschwitz " -, le principe en aurait été la sélection, les Juifs aptes au travail dans les camps, les inaptes à la chambre à gaz. Cet argumentaire qui fait d'Auschwitz l'archétype insiste sur la chambre à gaz qui n'y a pas été expérimentée pour les Juifs et dont ceux-ci n'ont pas été les seules victimes.
Cette lecture d'Auschwitz comme modèle du " camp d'extermination " dévie la signification effective du programme exposé par les autorités SS à la conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942. Annonçant aux autres administrations centrales du Reich " l'évacuation des Juifs vers l'Est, solution adoptée avec l'accord du Führer ", le chef de la Sécurité du Reich assurait néanmoins que " les Juifs valides " seraient " affectés au service du travail " et que même des Juifs allemands, pourtant victimes obligées du judéocide hitlérien, ne seraient pas évacués s'ils étaient occupés à l'armement 5. Ce pragmatisme productiviste ne signifie pas que la mobilisation forcée de la main d'œuvre juive soit devenue l'un des chapitres de la " solution finale ". Elle s'inscrit, dit bien le compte rendu, " dans [ce] cadre ", mais elle n'en est justement pas le cadre. On prévoit " qu'une grande partie d'entre eux s'éliminera tout naturellement par son état de déficience physique. Le résidu qui subsisterait en fin de compte - et qu'il faut considérer comme la partie la plus résistante - devra être traité en conséquence ". En d'autres termes, l'hypothèque de l'économie de guerre enfin levée, les survivants seraient à leur tour traités comme les inaptes, c'est-à-dire exterminés. En conformité avec l'idéologie, ils réintégraient ainsi la solution finale à laquelle ils avaient échappé pour opportunité économique. Il n'avait été question, en effet, pour " les Juifs aptes au travail " que d' " interrompre leur voyage [vers l'Est] et [d']exécuter des travaux d'armement ", comme l'explique le chef de l'administration économique de la SS au plus fort de la grande vague des déportations juives en été 1942 6. Dans le texte même, ce dispositif s'applique à Auschwitz. Dans cette litote nazie où le " voyage vers l'Est " désigne l'extermination des Juifs, jugés aptes ou non au travail, le pragmatisme économiste dispute le terrain à l'idéologie. Par ce prélèvement de main d'oeuvre dans les convois juifs en provenance de Pologne et d'Europe, le Konzentrationslager Auschwitz - appellation d'époque pour un combinat de quelque quarante camps et autres commandos - devint, à partir de 1942, un camp principalement " juif " et le plus peuplé du système des camps nazis 7. En janvier 1945, au moment où toute l'organisation concentrationnaire se disloque, précipitant ses détenus dans un désastre démographique, un sur quatre est passé par la matricule d'Auschwitz et un sur huit est juif. S'agissant justement de ce complexe si souvent présenté, y compris pour ses détenus, comme un " camp d'extermination ", il faut constater que le modèle n'a pas connu la dernière période des camps, la plus catastrophique, des derniers mois du Reich millénariste.
Le repli de ses forçats de travail sur les camps de l'intérieur, entrepris dès avant l'entrée de l'armée rouge en Pologne en 1944 et poursuivi jusqu'aux marches de la mort précipitées en janvier 1945, donne à voir un bilan de l'internement à Auschwitz particulièrement meurtrier. Le plus grand des camps nazis a aussi été le plus destructeur pour ses détenus. De 1940 à 1945, la matricule du camp leur en a attribué environ 400.000 numéros, plutôt 360.000 effectivement distribués 8. Grosso modo, la moitié de ses détenus n'ont pas survécu à la captivité dans les camps et commandos d'Auschwitz 9. On ne parle évidemment pas ici du sort de la masse des déportés parvenus à cette destination qui n'y ont pas été détenus ! La forte mortalité des bagnards d'Auschwitz reste néanmoins dans la norme macabre des Konzentrationslager. Le nombre des décès à Mauthausen est de justesse aussi à six chiffres, il en est à cinq à Dachau, à Buchenwald, tous chiffres qui comprennent des évacués d'Auschwitz, juifs ou non, tous sortis vivants du " camp d'extermination " de référence. Ces derniers tout autant que l'accumulation de morts dans les autres camps de concentration - y compris dans une plus forte proportion, les évacués d'Auschwitz survivants des marches de la mort de janvier 1945 - interpellent cette désignation singulière de ce camp-là en particulier. Le " camp d'extermination " ne commence à prendre du sens qui le distingue du camp de concentration qu'en référence aux déportés - et ce ne sont que des Juifs 10 - refusés d'immatriculation à Auschwitz. Mais justement ce refus d'une trace administrative des Juifs du génocide implique que la formule ne soit pas d'usage à l'époque. Il n'existe pas de " Vernichtungslager " dans le jargon administratif du IIIe Reich et de ses multiples camps de toutes sortes.
Tout au plus, une source, le journal personnel d'un témoin allemand, un médecin SS d'Auschwitz, Johan-Paul Kremer, l'identifie comme " le camp de l'extermination ", " das Lager der Vernichtung ", écrit-il le 2 septembre 1942 11. Cette source, bien connue, est souvent interprétée à contresens et on y lit même le " Vernichtungslager " du texte allemand d'après-guerre. J'ai montré, dans Les Yeux du témoin et le regard du borgne, que le SS-Untersturmführer Kremer découvre cette fonction exterminatrice d'Auschwitz-Birkenau, au cours de sa première " Sonderaktion ".
Cette " action spéciale " a lieu, précise le témoin, " à l'extérieur ", en l'occurrence contre un convoi juif de France, le n° XXVI, arrivé le 2 septembre 1942 et réduit d'un coup de 74% de son effectif au cours de cette tuerie. Plus loin, le journal confirme que ces " actions spéciales " s'effectuent le plus souvent sur des " gens de l'extérieur ". À une ou deux reprises, il signale même l'arrivée de " Hollandais " et de " gens venant de Hollande ". Le recoupement avec d'autres sources existantes (listes de déportation au départ des camps de rassemblement de l'Ouest, séries des matricules attribués aux nouveaux internés du camp de concentration) confère au journal du médecin SS le statut d'un document capital sur le génocide des Juifs d'Europe occidentale à Birkenau. Une de ses " actions spéciales " date de l'arrivée d'un convoi juif de Belgique, le n°VIII, exterminé aux deux tiers après son débarquement, un taux d'extermination immédiate de 65% au moins. Mais c'est à propos des " Hollandais " que le document d'époque est le plus explicite. Avec le convoi hollandais, le n° XXV, arrivé le 12 octobre, l'officier SS ne peut s'empêcher, en dépit des consignes de secret, d'acter les " scènes horribles devant le dernier bunker ". L'analyse historique révèle que 73% des déportés de ce transport ne laissent plus d'autre trace dans l'histoire. Le 18 octobre, le convoi suivant des Pays-Bas, le n° XXVI, donne lieu, note le SS, à des " scènes horribles avec trois femmes qui suppliaient de leur laisser la vie sauve ". Le taux d'extermination immédiate du convoi est pourtant moindre, tout en restant dans la norme du judéocide à Birkenau, avec 60% du contingent disparus à jamais dès son arrivée. Resitué dans le contexte des notes quotidiennes du témoin SS, son " camp de l'extermination " n'apparaît plus comme un camp de captivité, d'internement. Tout au plus comme un campement de garnison, encore que l'officier SS de passage, l'un des plus âgés, loge à l'hôtel pendant les trois mois de son temps à Auschwitz. En tout cas, et de manière tout à fait significative, le processus qu'il a consigné se déroule à l'extérieur et essentiellement sur des gens de l'extérieur, à leur arrivée. En 1942 et encore au début de 1943, les déportés prévus pour l'extermination débarquent à la rampe dite des Juifs en dehors de tout camp. Ils descendent du train en pleine campagne, après Auschwitz et avant Birkenau. La plupart ne sont pas retenus pour le camp de concentration. Physiquement, ils n'entreront dans aucun camp, quel qu'il soit. Des camions viennent les prendre à la rampe et les transportent vers " le dernier bunker " du témoin Kremer. C'est, dans le jargon des SS, le Bunker II, une ferme transformée en chambre à gaz, appelée la " maison rouge " d'après la couleur de ses briques et dont il ne reste que les ruines du soubassement. Le Bunker I dont il ne reste qu'une plaque commémorative ignorée des visiteurs de Birkenau, cette " maison blanche " - blanche pour son revêtement - se situe aussi à l'extérieur du camp de Birkenau, dans la même forêt de bouleaux qui borde tout son flanc ouest. Le modus operandi est celui d'une extermination immédiate en dehors de tout camp. Il s'inscrit dans le droit fil des tueries dans le ravin de Babi Yar en septembre 1941, le premier, sinon le plus grand massacre du judéocide. (On lira à ce sujet l'article du dictionnaire de Daniel Bovy). A Auschwitz-Birkenau, au sortir des trains, le seul enfermement des Juifs du génocide est … la chambre à gaz. Elle équipe d'un moyen de mise à mort de masse le SS-Sonderkommando, le commando spécial de la SS et de la police, des tueurs SS en charge de la réception des déportés et de leur mise à mort. Daniel Bovy nous apprend que l'appellation de Sonderkommando est leur dénomination d'usage. Dans Le siècle des camps qu'il écrit avec Pierre Rigoulot, Joël Kotek insiste sur cette mutation du vocabulaire nazi. Du camp avec ses équipements, il ne retient que le Sonderkommando établi à demeure. " Là, distingue fort à propos Le siècle des camps, il ne s'agira pas de cantonner et de parquer des êtres humains, plus ou moins maltraités, mais d'y exterminer méthodiquement et systématiquement, au jour le jour et sans délais, tous les Juifs qui y seront acheminés " 12.
Dans le cas d'Auschwitz néanmoins, le convoi n'est pas entièrement exterminé. Le cas est particulier dans le judéocide. Il s'agit d'une exception aussi paradoxale qu'elle paraisse en regard d'une mémoire qui a pourtant érigé Auschwitz en paradigme de l'extermination. A Kulmhof (Chelmno en polonais) dans le Warthegau, nouvelle province de la Grande Allemagne, et surtout, dans le Gouvernement général de Pologne, à Treblinka, à Sobibor et à Belzec, dans ces " camps " de l' " Aktion Reinhardt " 13, les SS-Sonderkommandos assassinent tous les déportés leur parvenant.
Les chiffres de Daniel Bovy montrent qu'ils tuent deux fois plus de Juifs qu'à Auschwitz : en million de victimes, 1,75 pour 0,865. A la différence, ces camps de campement ne comportent pas de baraquements pour le logement des déportés. Ils ne sont pas adossés à un camp de concentration, comme les bunkers I et II de Birkenau. Tout au plus, logent-ils plusieurs centaines de détenus juifs, pas plus d'un millier, affectés au service des tueurs SS pour l'intendance de la mort et le conditionnement des objets récupérés des déportés. Il en est de même à Birkenau où, isolés du reste du camp, ils ne quittent pas l'espace clos des grands crématoires construits pendant l'hiver, après les grandes tueries de l'été et de l'automne 1942. Par un glissement de sens, on dit qu'ils sont des Sonderkommandos, oubliant qu'ils y sont seulement détenus. Leur témoignage, celui des survivants - ils sont rarissimes - et celui d'époque, absolument exceptionnel, caché sous la cendre, apportent l'autre regard, celui du témoin juif, sur l'expérience quotidienne du génocide 14.
Par une méprise historique, on a voulu en voir soi-même l'image à la libération des camps dans les charniers de cadavres squelettiques découverts en avril 1945. Il y avait quatre mille corps à Ohrdurf, un commando de Buchenwald, et, plus hallucinants s'il le faut encore, ils étaient dix mille à Bergen-Belsen. Ces scènes de la " mort de masse " - selon le mot d'Annette Wiéviorka 15 - dans les camps libérés donnent corps au " camp d'extermination ", le " Vernichtungslager " de l'après 1945. Le sens commun auquel cèdent les dictionnaires d'usage, et les plus sérieux, finira par assimiler les camps de concentrations nazis à des camps d'extermination " où furent affamés, suppliciés et exterminés certains groupes religieux ou ethniques ". On essayera bien dans les variations de la mémoire de rattraper cette dérive et de distinguer les deux " sortes ", les camps de concentration d'une part, les camps d'extermination de l'autre. On visera par ce distinguo surtout le statut d'Auschwitz, pourtant le plus grand des camps de concentration. En passant, Buchenwald perd son statut de métonyme du système concentrationnaire et Auschwitz est désormais " le camp de concentration et d'extermination " par excellence. Cette focalisation de la mémoire a faussé la compréhension même du système concentrationnaire confondu avec l'extermination des Juifs. Il a fallu que les historiens rament à contre-courant pour faire passer la différence. Une des premières études scientifiques des camps de concentration - écrite en français, au temps des pionniers -, la thèse de doctorat d'Olga Wormser n'accorde en 1968 que quelques pages à la solution finale et encore, l'aborde-t-elle pour traquer l'abus des chambres à gaz dans la mémoire des camps de concentration. " Le caractère fondamentalement dissemblable des deux processus " exclut qu'ils se traitent dans le même registre, explique-t-elle 16. Vingt ans après, Wolfgang Sofsky, étudiant en sociologue les camps comme une " organisation de la terreur ", réduit encore le " lieu historique, où le génocide des Juifs coïncida avec l'organisation des camps de concentration " : il le laisse sur " la rampe d'Auschwitz où avait lieu la "sélection" "17. On sait que cette rampe établie dans le camp de concentration de Birkenau date seulement du printemps 1944. Elle a été aménagée pour recevoir le demi-million de Juifs hongrois attendus dans l'ultime grande déportation opérée in extremis. C'est la dernière scène de l'extermination, celle que retiendra la mémoire. Dépourvu de profondeur chronologique - c'est-à-dire d'histoire -, le discours mémoriel fixe ses représentations sur la dernière image d'Auschwitz-Birkenau. Il lui manque les repères pour prendre en compte toute l'histoire. En l'espèce, l'essentiel lui échappe. Sur les 865.000 Juifs gazés à Auschwitz dès leur arrivée, un demimillion n'est jamais descendu sur le quai du " camp d'extermination " de Birkenau et plus de deux cent mille ne sont pas passés par ses crématoires.
Lecture tronquée du judéocide, le " camp " de la mémoire d'Auschwitz fausse aussi la représentation même des camps de concentration. Les Américains et les Britanniques qui les libèrent en 1945 les identifient comme " Extermination camps " et, plus souvent, comme " Death camps ". Cette appellation de " camps de la mort " serait pourtant la plus appropriée pour les camps de concentration si on ne s'employait pas à y inscrire absolument le génocide. Dès 1940 et bien avant que la mise à mort des Juifs ne se commette dans des terminaux ferroviaires équipés pour le meurtre de masse, la mort imprime sa marque sur les grands camps de concentration. Ils s'équipent de fours crématoires dont ils n'étaient pas pourvus dans la période précédente, mais qui s'avèrent indispensables avec l'accroissement de la population concentrationnaire et l'internement généralisé de longue durée. Avec sa cheminée macabre qui domine son architecture, le Konzentrationslager de la Seconde Guerre mondiale apparaît pour ce qu'il est historiquement : un camp de la mort. Il l'est dans une proportion inégalée après l'échec de la Blitzkrieg, la " guerre- éclair " en Union soviétique, à l'automne 1941. C'est alors que s'élabore par à-coups " l'extermination par le travail ". Daniel Bovy préfère traduire " Vernichtung durch Arbeit " par " destruction par le travail ", à l'instar du grand historien américain Raul Hilberg motivé lui aussi par des considérations d'ordre moral. Le concept en est conçu dès la conférence de Wannsee avec ces Juifs aptes au travail dont on escompte la mort " naturelle " " par déficience physique ". Il trouve en septembre 1942 sa formulation officielle - peu usitée, il est vrai - pour tous les camps de concentration 18. Mais, dès avril, une circulaire de l'Administration économique de la SS dont relèvent désormais les camps l'a déjà étendu à toute la population concentrationnaire. Sa mise en oeuvre provoque aussitôt une " mortalité persistante et même croissante " dont doit se plaindre la Sécurité du Reich s'épuisant à compenser les pertes avec de nouvelles vagues d'arrestations 19. Il faut dès lors ordonner, à la fin de l'année, rien de moins que " la mortalité soit réduite [sic] "20. Au final, on retiendra les chiffres collationnés par Wolfgang Sofsky dans L'organisation de la terreur : ils donnent un ordre de grandeur, 1,1 million de morts sur 1,65 million d'entrées, soit les deux tiers 21.
Ces chiffres n'englobent qu'en partie une autre dimension de la barbarie nazie, l'extermination des prisonniers de guerre soviétiques, la plupart par épuisement. Plusieurs dizaines de milliers sont exécutés dans les camps. 11 à 15.000 meurent à Auschwitz. On oublie que jusqu'en 1944, seul le camp d'origine était le Konzentrationslager Auschwitz. Le camp de Birkenau s'érige en 1941 comme un Kriegsgefangenenlager d'Auschwitz, le camp de prisonniers de guerre destiné à recevoir les soldats de l'armée rouge capturés 22. Il conservera cette dénomination jusqu'à sa mutation, fin 1943, en Konzentrationslager Auschwitz II. Mais c'est surtout en dehors des camps de concentration que des millions de prisonniers de guerre soviétiques meurent d'affamement dans les stalags, les camps de soldats. La situation est si catastrophique dans les camps tenus par la Wehrmacht que dès novembre 1941, la Sécurité du Reich décide que " les Russes soviétiques visiblement marqués par la mort et pour cette raison incapables de supporter l'effort ne fût-ce que d'une courte marche, ne seront pas transférés aux camps de concentration pour y être exécu-tés " 23. Les dernières évaluations du traitement réservé par la Grande Allemagne national-socialiste aux prisonniers de guerre soviétiques donnent 2.749.000 morts ou disparus sur un total 5.160.000 captifs 24.
L'autre dimension de la barbarie nazie plus stupéfiante encore ne s'inscrit pas plus dans les camps de concentration. Dans Le Siècle des camps, Joël Kotek l'exprime avec force. " Lorsqu'est abordée la question de la Shoah, écrit-il, c'est la notion même de camp, quels que soient les mots qui servent à qualifier celui-ci (camp de la mort, camp d'extermination), qui est à proscrire. […] Cette notion est en effet toujours déplacée, toujours inopérante "25. Dans La destruction des Juifs d'Europe - il a fallu attendre un quart de siècle pour que cet ouvrage capital soit traduit en français -, l'historien américain en décrit les deux dimensions, d'une part " les opérations mobiles de tueries " dont il chiffre le bilan meurtrier à plus d'1,3 million de victimes. D'autre part, " les centres de mises à mort " - et non des " camps d'extermination " - où sont gazées 2,7 millions personnes. A ces 4 millions de Juifs assassinés au sens propre du terme, tués de mort violente, s'ajoutent plus de huit cents mille morts de privations dans les ghettos, bien plus meurtriers que les camps dont le bilan se chiffre à trois cents mille victimes.
Les camps de concentration où la mémoire persiste à situer la mort de six millions de Juifs sont décidément bien trop étroits pour contenir l'histoire du judéocide. Daniel Bovy utilise aussi ce terme. Il le renvoie à Holocauste, préférant semble-t-il qu'on traite de " la solution finale de la question juive ", " selon l'expression utilisée par les nazis qualifiant ainsi leur génocide et considérant, de leur point de vue, qu'il existe une question juive ", lit-on dans son Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah.
Il faut le lire, un peu comme on fonctionne sur Internet ou comme on feuillette un livre. L'index guide sans doute le choix. Il fixe des points de repère, mais on gagne à se laisser porter par les renvois d'article à article. Et au final, on a un vaste aperçu sur la barbarie nazie et la Shoah, plein de ces " détails " qui donnent son sens à l'histoire.
Maxime Steinberg
Historien,
docteur en Philosophie et Lettres
de l'Université Libre de Bruxelles
Auschwitz, ou quand l'exception occulte la règle
La souffrance devient une modalité extrême du génocide: mettre en exergue le sort des femmes résistantes à A., alors que c'est leur mise à mort systématique qui est la raison même du génocide.
In Le Soir, 14.3.1995
Carte blanche: Auschwitz ou la différence du génocide juif!
Les médias n'ont pas manqué, comme il convient dans une démocratie attachée à ses valeurs humanistes, d'assumer également une fonction pédagogique à l'occasion du cinquantenaire de la Libération d'Auschwitz. Le Soir pour sa part a publié un substantiel dossier qui resitue l'événement du 27 janvier 1945 bien au-delà du contexte de la libération des camps. Le Soir a aussi eu l'initiative tout à fait originale de publier, en une double page, les noms des "25.257 Belges d'Auschwitz". Il a ainsi permis au lecteur de se faire une idée de l'ampleur de cette déportation, à partir de notre pays, mieux qu'à la seule lecture des chiffres.
L'historien ne saurait que se féliciter de cette contribution à la diffusion du savoir historique. Ce dernier s'élabore dans un travail rigoureux. Il s'attache à serrer ces faits du passé au plus près, sans confondre les séries auxquelles ils appartiennent. De telles distinctions sont indispensables à leur saisie correcte. S'agissant justement d'Auschwitz, il importe de restituer à ce lieu d'histoire ce qui s'y est accompli, et tout ce qui s'y est accompli.
La difficulté essentielle - et les disputes de la mémoire autour de la commémoration de la libération du 27 janvier 1945 en sont une illustration - est justement de rendre compte de la dualité d'Auschwitz. L'usage veut qu'on présente ce lieu - dont on a fait un symbole - à la fois comme un camp de concentration et d'extermination. La notion est quelque peu confuse et le public ne perçoit guère la différence. Elle est pourtant essentielle sous peine d'écraser l'histoire sous le poids de morts. La mémoire serait vaine si elle ne rendait aux morts l'histoire de leur mort et n'identifiait les mécanismes qui l'ont administrée, pour l'instruction du temps présent.
Cette différence qui oblige à distinguer le camp de concentration et ce qu'on appelle le camp d'extermination, c'est la différence du génocide juif. L'événement ne se confond pas avec la mort concentrationnaire. Les Juifs du génocide ne sont pas déportés pour être enfermés dans un camp de concentration.
A Auschwitz-Birkenau, ils disparaissent dès leur arrivée. Ils disparaissent au sens où le chef des SS, Himmler utilise la formule, le 6 octobre 1943. Parlant aux dignitaires du parti nazi, et à propos des seuls Juifs, de "la grave décision de faire disparaître ce peuple de la terre", il ne laisse planer aucune ambiguïté sur le sens de cette extermination. "Dites si vous voulez, de les tuer ou de les faire tuer", précise-t-il. Ses tueurs SS disposent de structures adéquates pour exécuter cette "grave décision" d'assassiner un peuple.
Tantôt, des escadrons mobiles de la mort, des Groupes d'action de la SS et de la Police se déplacent vers leurs victimes pour les fusiller en masse à la sortie des villes et des villages. Un quart du génocide juif s'accomplit de cette manière en dehors de tout camp dans les territoires occupés de l'Est européen.
Tantôt, les tueurs SS sont installés à demeure dans un centre fixe d'extermination. Ce lieu n'est pas à proprement parler un camp voué à l'internement de déportés. Au plus, il comporte quelques bâtiments dont ceux, indispensables, qui sont aménagés en chambres à gaz à défaut de camions à gaz. Au départ de l'événement génocide, ils n'ont même pas une installation d'incinération pour faire disparaître les cadavres. Le personnel détenu est aussi réduit à l'indispensable, une trentaine de déportés juifs ici, quelques centaines là, retenus en vie pour l'intendance des SS et de la mort. Ainsi organisé, le centre de mise à mort extermine, dès leur arrivée, tous les déportés juifs qui y sont amenés. Il n'y a pas de sélection à l'arrivée à Chelmno, à Treblinka, à Sobibor et à Belzec. Près de la moitié du génocide s'accomplit dans ces terminus ferroviaires équipés pour massacrer tous les arrivants.
Le dernier quart du génocide s'exécute à l'arrivée à Auschwitz-Birkenau et, dans une bien moindre mesure, à Lublin-Maïdanek. Là, le centre d'extermination est installé, avec son équipement de gaz homicide, dans un camp de concentration, mais ce dernier n'est toujours pas ce qu'on a pris l'habitude de qualifier de "camp d'extermination". Le million de Juifs qui y sont déportés pour le génocide y sont gazés, le jour même de leur sortie des convois.
Cet assassinat de masse, méthodique et systématique ne procède pas de l'histoire de la mort qui se déroule dans le camp de concentration. Auschwitz est, à cet égard, un cas d'école. En raison de la libération de janvier 1945, ce camp n'a pas connu la dernière phase de l'histoire concentrationnaire avec l'effondrement du système des camps nazis dans la débâcle du IIIe Reich. Les sources documentaires désormais disponibles permettent d'évaluer l'ampleur de cette mort concentrationnaire à Auschwitz. De mai 1940 à janvier 1945, environ 130.000 détenus y ont péri. Ce qui, sur les 360.000 détenus effectivement immatriculés dans le complexe d'Auschwitz pendant ses cinq années d'existence, représente une mortalité d'environ 36%.
A Auschwitz comme ailleurs, la mort est constitutive des camps de concentration nazis. Elle s'inscrit dans leur architecture. Avec sa cheminée qui fume, le crématoire, présent dans tous les grands camps nazis, les désigne comme des camps de la mort. Mais ils ne sauraient, pour autant, s'identifier aux lieux conçus pour l'assassinat d'un peuple. La confusion dans les esprits vient de la dualité d'Auschwitz. Là, les SS font la différence, à l'arrivée des convois juifs et des seuls convois juifs. Les historiens sont particulièrement bien documentés pour mesurer la différence, en ce qui concerne la déportation 'occidentale', et notamment le cas 'belge'. Les guillemets s'imposent ici. Les 25.257 déportés raciaux qui, rassemblés à Malines, sont arrivés à Auschwitz ne sont pas belges pour la plupart. Il y a à peine 1.203 citoyens belges parmi eux. C'est précisément parce qu'ils sont massivement des étrangers, des immigrés récents, voire des réfugiés que l'Occupant parvient à déporter les Juifs du pays en si grand nombre sans provoquer une crise politique avec ses autorités nationales. Arrivés à Auschwitz en 27 convois, les deux tiers des déportés juifs - 62,7 % - sont immédiatement assassinés, dès leur descente des trains. Disparaissent ainsi au sens où Himmler, le chef des SS, utilise l'expression 15.621 hommes, femmes - surtout les femmes, les ¾ des Juives déportées - et enfants - quasi tous. Ces personnes déportées au titre de la solution finale n'ont pas eu d'autre histoire à Auschwitz que celle de leur mort immédiate dans ce centre d'extermination du génocide juif.
L'autre tiers - exactement 9.636 déportés dont 351 Tziganes, y compris les enfants - partage l'histoire des concentrationnaires d'Auschwitz. Les "survivants" de cette captivité subissent en janvier 1945 les terribles "marches de la mort"lors de l'évacuation devant l'avance de l'armée rouge. Le 8 mai 1945, ils sont seulement 1.207 encore en vie. Mais à ne considérer que ce bilan des déportations raciales de Belgique, la mémoire risque, cinquante ans après, d'évacuer l'événement colossal qui se déroulait, à chaque arrivée d'un convoi juif de Malines à Auschwitz. Elle s'interdirait, ce faisant, de comprendre ce qu'est un génocide, une connaissance plus que jamais indispensable dans cette dérive nationaliste et ethno-centriste d'une fin de siècle.
In Le Soir, 14.3.1995
Carte blanche: Auschwitz ou la différence du génocide juif!
Les médias n'ont pas manqué, comme il convient dans une démocratie attachée à ses valeurs humanistes, d'assumer également une fonction pédagogique à l'occasion du cinquantenaire de la Libération d'Auschwitz. Le Soir pour sa part a publié un substantiel dossier qui resitue l'événement du 27 janvier 1945 bien au-delà du contexte de la libération des camps. Le Soir a aussi eu l'initiative tout à fait originale de publier, en une double page, les noms des "25.257 Belges d'Auschwitz". Il a ainsi permis au lecteur de se faire une idée de l'ampleur de cette déportation, à partir de notre pays, mieux qu'à la seule lecture des chiffres.
L'historien ne saurait que se féliciter de cette contribution à la diffusion du savoir historique. Ce dernier s'élabore dans un travail rigoureux. Il s'attache à serrer ces faits du passé au plus près, sans confondre les séries auxquelles ils appartiennent. De telles distinctions sont indispensables à leur saisie correcte. S'agissant justement d'Auschwitz, il importe de restituer à ce lieu d'histoire ce qui s'y est accompli, et tout ce qui s'y est accompli.
La difficulté essentielle - et les disputes de la mémoire autour de la commémoration de la libération du 27 janvier 1945 en sont une illustration - est justement de rendre compte de la dualité d'Auschwitz. L'usage veut qu'on présente ce lieu - dont on a fait un symbole - à la fois comme un camp de concentration et d'extermination. La notion est quelque peu confuse et le public ne perçoit guère la différence. Elle est pourtant essentielle sous peine d'écraser l'histoire sous le poids de morts. La mémoire serait vaine si elle ne rendait aux morts l'histoire de leur mort et n'identifiait les mécanismes qui l'ont administrée, pour l'instruction du temps présent.
Cette différence qui oblige à distinguer le camp de concentration et ce qu'on appelle le camp d'extermination, c'est la différence du génocide juif. L'événement ne se confond pas avec la mort concentrationnaire. Les Juifs du génocide ne sont pas déportés pour être enfermés dans un camp de concentration.
A Auschwitz-Birkenau, ils disparaissent dès leur arrivée. Ils disparaissent au sens où le chef des SS, Himmler utilise la formule, le 6 octobre 1943. Parlant aux dignitaires du parti nazi, et à propos des seuls Juifs, de "la grave décision de faire disparaître ce peuple de la terre", il ne laisse planer aucune ambiguïté sur le sens de cette extermination. "Dites si vous voulez, de les tuer ou de les faire tuer", précise-t-il. Ses tueurs SS disposent de structures adéquates pour exécuter cette "grave décision" d'assassiner un peuple.
Tantôt, des escadrons mobiles de la mort, des Groupes d'action de la SS et de la Police se déplacent vers leurs victimes pour les fusiller en masse à la sortie des villes et des villages. Un quart du génocide juif s'accomplit de cette manière en dehors de tout camp dans les territoires occupés de l'Est européen.
Tantôt, les tueurs SS sont installés à demeure dans un centre fixe d'extermination. Ce lieu n'est pas à proprement parler un camp voué à l'internement de déportés. Au plus, il comporte quelques bâtiments dont ceux, indispensables, qui sont aménagés en chambres à gaz à défaut de camions à gaz. Au départ de l'événement génocide, ils n'ont même pas une installation d'incinération pour faire disparaître les cadavres. Le personnel détenu est aussi réduit à l'indispensable, une trentaine de déportés juifs ici, quelques centaines là, retenus en vie pour l'intendance des SS et de la mort. Ainsi organisé, le centre de mise à mort extermine, dès leur arrivée, tous les déportés juifs qui y sont amenés. Il n'y a pas de sélection à l'arrivée à Chelmno, à Treblinka, à Sobibor et à Belzec. Près de la moitié du génocide s'accomplit dans ces terminus ferroviaires équipés pour massacrer tous les arrivants.
Le dernier quart du génocide s'exécute à l'arrivée à Auschwitz-Birkenau et, dans une bien moindre mesure, à Lublin-Maïdanek. Là, le centre d'extermination est installé, avec son équipement de gaz homicide, dans un camp de concentration, mais ce dernier n'est toujours pas ce qu'on a pris l'habitude de qualifier de "camp d'extermination". Le million de Juifs qui y sont déportés pour le génocide y sont gazés, le jour même de leur sortie des convois.
Cet assassinat de masse, méthodique et systématique ne procède pas de l'histoire de la mort qui se déroule dans le camp de concentration. Auschwitz est, à cet égard, un cas d'école. En raison de la libération de janvier 1945, ce camp n'a pas connu la dernière phase de l'histoire concentrationnaire avec l'effondrement du système des camps nazis dans la débâcle du IIIe Reich. Les sources documentaires désormais disponibles permettent d'évaluer l'ampleur de cette mort concentrationnaire à Auschwitz. De mai 1940 à janvier 1945, environ 130.000 détenus y ont péri. Ce qui, sur les 360.000 détenus effectivement immatriculés dans le complexe d'Auschwitz pendant ses cinq années d'existence, représente une mortalité d'environ 36%.
A Auschwitz comme ailleurs, la mort est constitutive des camps de concentration nazis. Elle s'inscrit dans leur architecture. Avec sa cheminée qui fume, le crématoire, présent dans tous les grands camps nazis, les désigne comme des camps de la mort. Mais ils ne sauraient, pour autant, s'identifier aux lieux conçus pour l'assassinat d'un peuple. La confusion dans les esprits vient de la dualité d'Auschwitz. Là, les SS font la différence, à l'arrivée des convois juifs et des seuls convois juifs. Les historiens sont particulièrement bien documentés pour mesurer la différence, en ce qui concerne la déportation 'occidentale', et notamment le cas 'belge'. Les guillemets s'imposent ici. Les 25.257 déportés raciaux qui, rassemblés à Malines, sont arrivés à Auschwitz ne sont pas belges pour la plupart. Il y a à peine 1.203 citoyens belges parmi eux. C'est précisément parce qu'ils sont massivement des étrangers, des immigrés récents, voire des réfugiés que l'Occupant parvient à déporter les Juifs du pays en si grand nombre sans provoquer une crise politique avec ses autorités nationales. Arrivés à Auschwitz en 27 convois, les deux tiers des déportés juifs - 62,7 % - sont immédiatement assassinés, dès leur descente des trains. Disparaissent ainsi au sens où Himmler, le chef des SS, utilise l'expression 15.621 hommes, femmes - surtout les femmes, les ¾ des Juives déportées - et enfants - quasi tous. Ces personnes déportées au titre de la solution finale n'ont pas eu d'autre histoire à Auschwitz que celle de leur mort immédiate dans ce centre d'extermination du génocide juif.
L'autre tiers - exactement 9.636 déportés dont 351 Tziganes, y compris les enfants - partage l'histoire des concentrationnaires d'Auschwitz. Les "survivants" de cette captivité subissent en janvier 1945 les terribles "marches de la mort"lors de l'évacuation devant l'avance de l'armée rouge. Le 8 mai 1945, ils sont seulement 1.207 encore en vie. Mais à ne considérer que ce bilan des déportations raciales de Belgique, la mémoire risque, cinquante ans après, d'évacuer l'événement colossal qui se déroulait, à chaque arrivée d'un convoi juif de Malines à Auschwitz. Elle s'interdirait, ce faisant, de comprendre ce qu'est un génocide, une connaissance plus que jamais indispensable dans cette dérive nationaliste et ethno-centriste d'une fin de siècle.
Les peuples chrétiens face au laissez-faire de l'église officielle
Maxime Steinberg évoque cette question, notamment dans un chapitre de son livre "Un pays occupé et ses juifs (La Belgique, entre France et Pays-Bas)", 1998, intitulé Le silence de l'église et les actes chrétiens face à la solution finale.
Table de matières Print (4p)
"Chaque Église", insistait René Rémond lors d'un colloque sur l'Allemagne nazie et le génocide juif, est "une société composite qui demande à être considérée dans sa totalité"[1]. Dans l'historiographie, "le silence du Vicaire" a cessé d'être la question centrale. Si le retentissement de la pièce de Rolf Hochhuth a pu, dans les années soixante, focaliser l'attention sur les attitudes pontificales, "les Églises et la persécution des Juifs pendant la seconde guerre mondiale" sont désormais étudiées dans une approche globale.
A cette fin, le professeur de l'Université de Nanterre suggérait un modèle de lecture, un "schéma" permettant de saisir les comportements. Cette grille d'interprétation serait, en somme, bipolaire. Le "problème" chrétien était, selon l'historien français, de "concilier l'action de témoignage dénonçant le crime et l'action de sauvetage visant d'abord à soustraire à la mort le plus grand nombre d'innocentes victimes"[2]. Le modèle, construit à partir du cas français et susceptible d'"ajustements", se vérifie, insiste-t-on, dans le cas hollandais. "Toutes les modalités s['y] sont trouvées expérimentées". Ce cas remarquable, estime l'historien catholique, présente "le plus vif intérêt pour qui réfléchit aujourd'hui sur ce qui était possible et s'interroge sur ce que les Églises eussent dû faire, pas seulement pour être fidèles à leur mission, mais pour que leur intervention fût efficace et préserve les Juifs".
Cette réflexion, toute légitime qu'elle soit d'un point de vue éthique, comporte le risque d'instrumentaliser les attitudes du passé. Elle institue ce qui est advenu en norme de ce qui devait advenir. Le critère objectif d'appréciation ne se réfère pas à "ce qui était possible" selon une norme chrétienne de l'après-Auschwitz. Cette problématique est métahistorique et ses termes évoluent au demeurant selon les enjeux d'un présent inconstant dans son rapport au passé. Elle pose les questions, non de l'histoire, mais de la mémoire, avec inévitablement leur part de refoulement, voire de mensonges[3]. Le problème historiographique est de rendre compte des comportements dans l'événement, pendant qu'il s'accomplit et, le plus souvent, dans l'ignorance où se trouvent ses acteurs du sens réel de cet accomplissement. A cet égard, la référence obligée s'inscrit dans les sociétés dont les Églises sont aussi une composante et d'où les services du IIIe Reich éliminent, 'extirpent' les Juifs. Dans cette lecture, le schéma de Rémond intervient comme l'une des variables parmi d'autres d'un modèle plus large et applicable à tout le corps social.
Le cas belge conduit à poser la problématique de l'Église en ces termes. C'est qu'en Belgique, le schéma de Rémond est trop réducteur pour restituer tout le comportement de l'Église catholique, de l'institution comme de ses fidèles. Dans ce pays, à la différence de ses voisins du Nord et du Sud, il n'y eut ni en français, ni en néerlandais la moindre protestation publique de l'Église contre la persécution raciale.
Les seules paroles prononcées en chaire de vérité sont des "prières pour la conversion des juifs"[4]. Selon la police de sécurité allemande, elles "n'étaient pas rares tant en Flandre qu'en Wallonie" pendant l'hiver 1942/1943. Le service allemand y découvre une preuve supplémentaire de "la propagande hostile pratiquée par le clergé". La Sécurité du Reich apprend ainsi que "les curés des paroisses et les assistants sociaux parlent des horreurs infligées aux 'pauvres juifs'".
Ce témoignage chrétien contre le "crime", enregistré dans les archives nazies, n'est pas à lire rétrospectivement. Si la rumeur du génocide perpétré à l'Est parvient effectivement en Europe occidentale, la plupart des témoins occidentaux des "horreurs infligées" aux persécutés ne conçoivent nullement combien elles sont minimes en regard du sort des déportés assassinés dès l'arrivée des convois[5]. Cette "barbarie nazie" que dénonce l'opinion clandestine désigne seulement la mise en route des trains de la solution finale.
L'"horreur" dont parle, le 20 juillet 1942, "l'épiscopat catholique, de concert avec la plupart des ministres des communautés réformées de Hollande", c'est justement d'avoir "appris (...) la nouvelle des déportations massives de familles juives tout entières : hommes, femmes et enfants, vers les territoires du Reich". Cet appel chrétien à l'opinion publique s'emploie à "prévenir si possible l'exécution" de "mesures (qui) vont à l'encontre du sens moral du peuple hollandais et, qui plus est, s'opposent aux commandements de Dieu"[6].
Quant aux "scènes épouvantables" qui décident, en France, l'archevêque de Toulouse à dire publiquement son sentiment à ses fidèles, le 26 août, ce n'est rien de plus que le "triste spectacle" dont il est le témoin dans son propre diocèse - en zone non-occupée - où "des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères sont traités comme un vil troupeau"[7].
"Ces mesures", ajoute le cardinal Van Roey en ce qui concerne la Belgique , "ont été exécutées avec une brutalité et même une cruauté qui ont révolté profondément la population belge"[8]. Ce témoignage - on ne peut plus explicite - est porté … dans le secret de la diplomatie vaticane: à la fin de l'année 1942, le Primat de Belgique informe le cardinal Maglione sur le sentiment belge après la grande vague de déportation qui vient, en cent jours, de décimer, à 30 %, la population juive locale. Dans ce pays catholique où la parole de l'Église compte et où elle n'a pas manqué de se faire entendre sur d'autres sujets, la hiérarchie n'a jamais donné forme au sentiment populaire dans la question juive.
Les "prières pour la conversion des juifs", dont s'inquiète le détachement de la Sécurité du Reich dans ce territoire, renseignent-elles sur ce silence? Cette protestation bien tardive est pour le moins ambiguë. Avec son empreinte d'antijudaïsme traditionnel de l'Église, elle témoigne, en ce temps de persécutions antisémites, racistes et nazies, que l'imaginaire chrétien ne parvient toujours pas à prendre le recul attendu tout au moins par les chrétiens de la résistance.
Un journal liégeois auquel collaborent des prêtres du diocèse le regrette, en juin 1942, dés que le port obligatoire de l'étoile jaune révèle la persécution raciale à un public stupéfait, sinon scandalisé. "Nous avons entendu des catholiques fervents, ardents patriotes dire", déplore Churchill-Gazette, "que tout en désavouant les mesures antijuives, ils ne parvenaient pas à plaindre les Juifs". Et l'organe patriotique d'expliquer à ces fidèles "peu charitable(s)" qu'"ils ne doivent pas perdre de vue cependant que si leur manque de sympathie pour les Juifs trouve son origine dans la mort du Christ, Celui-ci leur a donné le meilleur exemple. Ne s'est-il pas contenté de pleurer sur les bourreaux et par la Croix ? N'a-t-il pas demandé à son Père de leur pardonner?".
Les militants d'ordre nouveau les plus radicaux, tout hostiles qu'ils soient au catholicisme "politique", procèdent à une autre lecture de l'enseignement chrétien.
Le Pays réel - l'organe du mouvement rexiste qui se souvient de ses origines lointaines dans la droite catholique des années trente - s'attache, dans une version positive, à persuader "les esprits sincèrement religieux": "ne doivent-ils pas considérer notre tâche comme un effort sincère de retrouver dans la réalité créée le plan providentiel de Dieu"[9]. Dans cette lecture, "Dieu a fait de notre race, de la communauté populaire à laquelle nous appartenons l'instrument de ses bienfaits".
L'Ami du Peuple - organe d'une Ligue pour la Sauvegarde de la Race et du Sol déjà à la fin des années trente - préfère, dans son inspiration hitlérienne, agir comme l'instrument de la vengeance du Tout-Puissant. Dans cette version négative, le journal raciste annonce que "l'heure du règlement de compte a sonné. Depuis vingt siècles, les Juifs ont causé tant de ruines et de guerres qu'il faut leur appliquer les paroles qu'eux-mêmes ont prononcées quand Jésus fut crucifié: que son sang retombe sur nous et nos enfants. Nous autres nationaux-socialistes wallons, nous savons que nous exécuterons cette sentence"8.
L'évangile selon Matthieu et sa damnation du déicide ne sauraient pourtant intimider le chrétien de la résistance. Le christianisme lui offre d'autres références théologiques pour refuser les persécutions antisémites. À défaut d'un magister approprié de l'épiscopat belge[10], Churchill Gazette se tourne vers les "récentes paroles de l'archevêque de Montréal: il m'est impossible d'approuver les mesures prises dans certains pays contre les juifs parce que je ne dois pas oublier que le Christ est Juif d'origine et de ce fait, que je suis moi, Juif spirituellement".
Au demeurant, dans cette question juive du temps de l'occupation allemande, il n'est nullement question de religion[11]. "Nous ne voulons pas discuter de la religion, si elle a du bon ou du mauvais", avertit Churchill Gazette. "Nous le répétons, nous ne prenons pas la défense des juifs au point de vue religieux. Ces discussions ne sont pas de mise actuellement".
Le "point de vue" adopté est résolument patriotique. Et cette option patriotique fait écran à l'antisémitisme d'importation allemande, quelle que soit la résonance de ses leitmotive dans les couches moyennes du pays. Le slogan que lance La Libre Belgique dans son numéro d'août 1942, mis sous presse peu avant le départ des premiers convois juifs, traduit sans doute le mieux le sentiment public. "Belges, que vous soyez pro ou antisémites. Souvenez-vous que les Juifs sont victimes des Boches (...). Protestez contre les mesures barbares prises à leur égard. Cela fera enrager les Boches".
Cet organe, de sensibilité chrétienne, est l'un des plus importants de la presse clandestine et il est significatif qu'après les premières déportations, c'est ce journal tirant des milliers d'exemplaires imprimés qui explique, et précisément dans cet esprit chrétien, "pourquoi le problème juif doit être à l'avant-plan de(s...) préoccupations" belges. Il doit l'être parce qu'il n'est "qu'un aspect de l'attitude des états totalitaires à l'égard de tout mouvement qui reconnaît, au delà de l'État, une solidarité internationale quelconque. Le sort des juifs aujourd'hui guette demain les maçons, après-demain les chrétiens". L'organe ne dit rien des communistes! La solidarité qu'il recommande envers les Juifs persécutés n'en est que plus remarquable, même si son argumentaire témoigne d'une incompréhension des enjeux de l'antisémitisme dans racisme nazi.
Organe de résistance, La Libre Belgique appelle en effet "tous ceux qui croient en la solidarité humaine (à) se dresse(r) pour protester, de la façon la plus énergique possible, contre toute persécution qui frappe leur conviction dans l'un ou l'autre de ses membres, même si cette persécution frappe une manière de concevoir les choses qui n'est pas la leur"[12]. Une telle mobilisation est, à son estime, "de la plus haute importance".
Pour Churchill-Gazette, c'est même aux autorités du pays - entre autres, à "notre clergé" - à qui il incombe de "protester énergiquement". Dans cette attente d'une parole autorisée, l'organe liégeois se trouve "réconfort(é) d'apprendre par les radios anglaises et neutres que, dans un sermon qui fera époque, l'archevêque de Toulouse s'est solennellement élevé en chaire de vérité contre les persécutions organisées en France". Le journal a même découvert "une protestation [sic] du Pape auprès du gouvernement" français[13]. "Ce sera l'honneur de l'Église catholique", est-il trop heureux d'annoncer, "d'avoir été les premiers à protester officiellement. Nous espérons, nous souhaitons que cette protestation s'amplifiera".
Elle s'amplifie effectivement, mais toujours en France où les voix les plus autorisées de l'Église, cessant d'acquiescer par leur silence aux persécutions antijuives de l'"État français", disent plus que la protestation d'une "France chevaleresque et généreuse" dans "la tradition du respect de la personne humaine"[14]. Elles posent un acte politique qui imprime sa marque à l'événement en cours! Il s'agit, en l'occurrence d'une "résistance sans pareille de la part de l'Église"[15] et un tel acte posé par l'un des piliers du régime du Maréchal Pétain contraint, en effet, le gouvernement de Vichy, tout désireux qu'il soit "de régler la question juive", à cesser d'acquiescer à l'engagement systématique de ses polices dans l'arrestation des Juifs, comme le comprennent bon gré mal gré ses interlocuteurs de la police nazie dès le 2 septembre.
Les "paroles" de cette Église inspirent à un autre journal clandestin belge, La Légion Noire , la conclusion que "le catholicisme en France et en Belgique (sic) comme celui de n'importe quelle nation ne se prête jamais aux traitements honteux infligés à n'importe quelle personne. Elle est respectable et peu importe la nuance à laquelle elle appartient, l'Église sait lui donner la place qui lui revient dans l'existence d'ici-bas. Seuls les monstres ignorent les sentiments d'humanité que la charité chrétienne commande et que la loi naturelle elle-même exige". Et comme si effectivement "l'épiscopat à ce moment prend parole", ce message chrétien s'autorise de la signature d'un "A.B."[16].
Dans ce pays, le chrétien n'est cependant pas autorisé à invoquer l'autorité de son Église pour justifier sa résistance! Ni le cardinal Van Roey, ni les évêques - pas même celui du diocèse de Liège Mgr. Kerkhofs pourtant le plus engagé - ne font entendre cette autorisation face à ce que La Libre Belgique chrétienne dénonce pourtant comme un "retour à la barbarie, [un] recul vers les épisodes de l'Histoire de l'humanité qui nous font tous rougir à l'heure actuelle".
En dépit de son silence, la plus haute autorité de l'Église belge partage certes le sentiment public. Le jour même où le premier convoi quitte le pays, - le 4 août 1942 -, le Primat de Belgique informe le Vatican qu'"actuellement, les traitements qu'on fait subir aux Juifs sont vraiment inhumains et excitent la commisération et l'indignation générales"[17]. Un geste du cardinal Van Roey a même signifié son sentiment personnel. Comme le Consistoire Central Israélite l'en remercie, le 12 août, avec une "profonde gratitude", il lui a manifesté sa "bienveillance et (sa) sympathie (...) à l'occasion des pénibles épreuves que subit en ce moment la population juive". Il l'a fait sous la forme d'une entrevue accordée au Grand Rabbin Salomon Ullmann.
Ce dernier, suivant les avis des notables belges dont le cardinal, préside la communauté obligatoire depuis sa création sur ordre de l'occupant à la fin de 1941. Cette Association des Juifs en Belgique venait, le 22 juillet, d'être requise de distribuer à ses membres les ordres individuels de se présenter au camp de rassemblement. Résigné à leur distribution, le Grand Rabbin alerte les autorités belges et recherche leur aval.
Sa démarche auprès du cardinal ne laisse aucune trace dans les archives allemandes. L'audience est d'une grande discrétion, mais elle ne reste pas sans écho. La Résistance - du moins l'organe clandestin portant ce titre - diffuse, dès la fin de juillet, la nouvelle que "Mgr Van Roey, Primat de Belgique a reçu officiellement à l'archevêché le Grand Rabbin de Belgique". A suivre l'interprétation du journal patriotique, ce geste signifierait que "les autorités ecclésiastiques ont témoigné ouvertement leur réprobation à l'égard des mesures antijuives" .
Il n'en est rien. Un instant, le cardinal a sans doute songé à répondre à cette attente diffuse. "Son Éminence s'est posé la question de savoir s'il convenait de faire une protestation contre le sort fait aux juifs"[18]. Un témoin bien informé le rapporte in tempore non suspecto, si l'on ose dire. L'avocat Max-Albert Van den Berg, directeur des Colonies Scolaires catholiques de la province de Liège, n'a pas survécu au camp de concentration où la police SS l'avait transféré parce qu'"il avait accepté dans les maisons d'enfants qui étaient sous sa direction des enfants juifs et les a soustraits aux mesures contre les Juifs". Au moment d'entreprendre le sauvetage des enfants juifs qui lui vaudra de perdre la vie, il se rend à l'archevêché de Malines pour connaître les dispositions de l'Église. Il n'a pas vu le cardinal, mais son interlocuteur Mgr. Van Eynden, vicaire général de l'archidiocèse, a toute autorité pour connaître la doctrine officielle en la matière.
Malines n'ignore rien du drame juif en train de s'accomplir, en cette fin de l'été 1942. Le chanoine Leclef, le secrétaire du cardinal, ne vit jamais, selon son témoignage d'après guerre, "rien de plus pitoyable, ni de plus révoltant que ce long cortège d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, emmenés vers un destin épouvantable". Il y avait aussi des enfants en bas âge et des vieillards, et ce, dans ce pays, dès les premiers transports vers Auschwitz. Ce dont justement le chanoine Leclef n'a pas gardé le souvenir dans son témoignage d'après guerre. Il était pourtant un observateur privilégié. La caserne Dossin où la police nazie avait installé son camp de rassemblement pour la déportation des Juifs est à peu de distance de l'archevêché de Malines.
Dans Le Cardinal Van Roey et l'occupation allemande en Belgique que le chanoine publie, en 1945, il avance aussi, à propos de l'attitude de l'Église, une autre explication que celle recueillie à l'époque par l'avocat liégeois. Au nom du cardinal, son secrétaire personnel est intervenu auprès d'autorités allemands en faveur de Juifs catholiques requis de se présenter à la caserne Dossin, aussi de femmes enceintes qui avaient fait appel au chef de l'Église "lui demandant aide et protection".
Ces démarches pour "obtenir des mitigations" furent vaines, expose le Primat de Belgique au cardinal Maglione, le 4 août 1942! "J'étais indigné", se souvient pour sa part, le chanoine Leclef. Il garde en mémoire un entretien avec un officier allemand à qui "délibérément", il cria son indignation. "Je ne puis comprendre que des officiers comme vous couvrent et excusent les illégalités, les injustices et les crimes perpétrés par la Gestapo ", lui aurait-il même déclaré. "Le Cardinal à qui je rapportais aussitôt cette conversation, jugea que toute démarche ultérieure serait inutile"[19].
La relation que le directeur des Colonies scolaires catholiques adresse, le 21 septembre 1942, à l'évêque de Liège, Mgr. Kerkhofs, n'impute pas le silence du cardinal à ces précédents décevants. C'est d'une manière générale que Van Roey aurait jugé sa protestation inopportune face à l'occupant. A Van den Berg, on a expliqué qu'"il est démontré, par les protestations antérieures, que l'autorité occupante n'y a aucun égard, en sorte qu'une protestation aurait toute chance d'être aussi vaine que les protestations antérieures relatives à d'autres sujets"[20]
Ce sentiment d'impuissance n'empêche pas le chef de l'Eglise belge de se prononcer publiquement sur d'autres sujets graves. La raison principale du silence de l'Eglise belge face à la déportation juive relève d'une autre attitude. Le Primat de Belgique sensible à l'attente chrétienne d'une protestation autorisée "a décidé de n'en rien faire" parce que, note Van den Berg en premier lieu, "les Allemands ont déclaré ne vouloir s'occuper que des Juifs allemands, visant par ce terme les Juifs de la Grande Allemagne , inclus la Pologne , la Silésie , l'Ukraine, la Yougoslavie et l'Autriche. Les Juifs belges et hollandais n'auraient donc rien à craindre, au moins pour le moment" .
Dans cette acceptation surprenante des prétentions de la puissance occupante en Europe centrale et orientale, l'autorité religieuse, rassurée sur le sort de ses compatriotes israélites, ne réagit pas autrement à la tragédie juive du terrible été 1942 que les autres autorités nationales[22]. Le 15 septembre, le chef de l'administration militaire allemande se montre fort satisfait de ce que l'"Action Est", confiée à la police SS, "ne fit pas trop de sensation dans l'opinion publique". Avec soulagement, l'adjoint le plus important du Général Alexander von Falkenhausen note que "les représentants du ministère de la justice belge et des autres institutions belges ont toujours déclaré qu'ils ne voulaient s'occuper que des juifs de nationalité belge"[23].
Avec un sens très fin des opportunités, Eggert Reeder, chef de son administration militaire, a prévu, dès qu'il a appris que la Sécurité du Reich se disposait à entamer la déportation de son ressort territorial, qu'il désamorcerait toute crise dans les relations du pouvoir d'occupation avec les autorités du pays en leur laissant l'impression de négocier la protection de leurs ressortissants juifs[24]. Le 9 juillet, avant même que la moindre rumeur sur l'imminente déportation n'ait filtré du côté belge, Reeder négocie en personne avec Himmler la concession - tout au moins provisoire - des citoyens juifs.
Général SS à titre honorifique, mais non pas l'homme de la SS , le chef de l'administration militaire a la préoccupation permanente dans le traitement de la question juive d'"amener les résultats obtenus en concordance avec les répercussions politiques"[25]. Pendant les déportations raciales de 1942, l 'immunité des citoyens juifs est son maître atout.
"L'administration militaire avait renoncé à la déportation d'environ 3.000 juifs belges pour éviter une aggravation de la situation générale", expliquera-t-il, un an plus tard, après le départ du convoi XXII B, B comme "belge"[26]. Le pouvoir d'occupation, très pragmatique, a ainsi au moment crucial aménagé aux autorités du pays un espace de moindre mal dans la solution finale.
Cette politique de moindre mal - pratique constante des autorités belges de l'occupation - s'avère, dans la question juive, particulièrement étriquée. Elle n'en suscite pas moins des réticences du côté allemand. A la veille des déportations de 1942, le représentant d'un service impliqué dans l'opération, s'inquiète de "la raison pour laquelle on épargnait les Juifs de nationalité belge". On fait comprendre à l'impatient que "des 50.000 juifs de Belgique environ vivant actuellement [dans le pays], 10 % seulement étaient de nationalité belge de sorte que par cette action imminente, la grande partie des juifs vivant ici serait atteinte"[27].
La part des 'privilégiés' dans la population juive est encore moindre que l'évalue l'autorité allemande: à peine de 6 % de Belges parmi les 56.000 Juifs de la cartothèque de la police nazie. La 'protection' dont ils bénéficient pendant une longue année se traduit, dans le bilan global de la solution finale en Belgique occupée, par un paradoxe statistique. Il convient de le qualifier de xénophobe à défaut d'une caractérisation mieux appropriée. Le racisme antijuif, totalitaire dans son principe, n'affecte pas, en effet, de manière égale tous les Juifs du pays. Dans cette démographie macabre, la différence va du simple au double selon leur statut national. Si 23 % des citoyens juifs ont finalement emprunté l'itinéraire fatal d'Auschwitz, la proportion s'élève à 45 % chez les Juifs étrangers résidant dans ce pays.
De toute évidence, les ressortissants étrangers d'origine juive, la plupart des immigrés récents et, pour un cinquième, des réfugiés du Grand Reich allemand arrivés à la veille de la guerre, ont été - et tragiquement - les plus vulnérables.
Cette vulnérabilité renvoie à la politique de moindre mal des autorités belges. Leur attitude a varié selon que l'occupant s'attaque à leurs compatriotes israélites ou aux Juifs étrangers. Le paradoxe xénophobe dans la solution finale ressort de la manière singulière dont les responsables belges ont respecté le prescrit constitutionnel. Les autorités nationales ont réservé la protection des personnes aux seuls citoyens israélites et, dans la dérive du possible conçu par le pouvoir d'occupation, elles lui ont épargné cette crise politique que la déportation massive des Juifs étrangers par sa police politique lui faisait redouter.
En Belgique, les autorités autochtones ne les ont pas livrés aux services allemands. L'appareil d'Etat n'y était pas comme en France rallié à l'Ordre Nouveau. Dans ce pays, le recours à la police nationale pour rassembler les déportés se fait à l'insu des autorités administratives. Il est, au demeurant, absolument exceptionnel.
Le constat n'enlève rien à la gravité de l'événement: toutes proportions gardées, les razzias d'Anvers, dans les nuits des 15/16 et 28/29 août 1942 reproduisent dans un tout autre contexte politique la grande rafle du Vel' d'Hiver à Paris, les 15 et 16 juillet. Les ravages sont identiques: les policiers anversois arrêtent de cinq à sept fois moins de personnes que leurs collègues parisiens dans une population juive cinq à sept fois moins nombreuse. Ce qui, en revanche, n'est pas comparable, c'est qu'ici, l'autorité d'occupation, toujours attentive aux "conséquences extrêmement fâcheuses au point de vue politique" des initiatives inconsidérées de la police de sécurité, se voit dans l'obligation politique de lui rappeler les conventions passées excluant les polices belges des "opérations d'envergure" contre les Juifs[28].
Dans ce pays, si la police nationale met seulement 15 % des Juifs déportés à la disposition des agents de la Sécurité du Reich en charge de la solution finale, c'est parce que la politique de l'occupant n'entend pas impliquer l'appareil d'Etat belge dans la déportation raciale. Le succès de l'entreprise commande qu'au moment du plus grand danger, les Juifs étrangers soient laissés à eux-mêmes et sans défense.
Abandonnés, ils ne sont cependant pas restés longtemps à la merci des services allemands et de leurs auxiliaires belges d'ordre nouveau. Les grandes rafles de la fin de l'été 1942 leur ont appris douloureusement que la soumission à la légalité de l'occupation, y compris aux lois belges, ne leur laisse pas d'autre alternative que d'être, à leur tour, déportés. La terrible leçon leur fut salutaire. Dès l'automne, ils font en masse la rupture et cette plongée dans le monde souterrain de l'occupation brise, dans ce pays, définitivement l'élan de la solution finale .
Mais alors que les services allemands perdent irrémédiablement la maîtrise de l'événement juif, les autorités belges ne sont pas moins pusillanimes que pendant la "mise au travail" de l'été 1942. Même l'institution catholique évite d'engager sa responsabilité: ménagée par l'occupant dans ses oeuvres et ses mouvements d'action, elle ne prend pas l'initiative d'y aménager un espace clandestin pour l'asile aux fugitifs juifs. L'initiative en vient de cette base chrétienne chez qui la défense des valeurs l'emporte sur tout autre considération d'opportunité, y compris le souci de préserver les institutions catholiques.
Tel est du moins l'argumentaire de Churchill Gazette à Liège: appelant les autorités à protester énergiquement, le journal clandestin sait par avance la vanité de ses appels et il s'adresse plutôt aux "hommes de bonne volonté", les "vrais Belges, les patriotes qui savent eux (sic) que la domination boche n'est que passagère": ils "doivent, quand ils le peuvent, donner aide et assistance aux persécutés. L'asile est dû aux opprimés. Il faut les cacher, les héberger chaque fois que c'est possible. Il ne manque pas de moyens pour atténuer leurs souffrances. Il faut les soustraire au sort affreux qui les guette".
L'inspiration est ici pleinement chrétienne: "Comme le dit l'archevêque de Toulouse", explique l'organe liégeois, "les Juifs sont des hommes comme nous. Leurs malheurs actuels doivent nous les faire aimer. Ne nous contentons plus demain de saluer les porteurs d'étoile jaune. Nous devons maintenant les aider à ne plus la porter afin qu'on ne les remarque plus dans la foule anonyme". Et, l'organe chrétien d'énoncer alors cette vérité profonde que l'histoire authentifie: "l'aide maximum aux Juifs, nous le répétons est une belle forme de résistance" .
En première ligne, dans les quartiers 'juifs', des prêtres, des religieuses, des militants sociaux sont personnellement confrontés à cette nouvelle pratique du droit d'asile. Sur le point d'enlever leur étoile, des parents, souvent des réfugiés allemands dépourvus d'attache dans ce pays d'exil, se tournent vers les paroisses voisines pour leur confier leurs enfants.
De son côté, le Front de l'Indépendance - le principal mouvement de résistance sous l'occupation où précisément des chrétiens côtoient les communistes - fournit à sa section de défense des Juifs une assistante sociale catholique: elle aura la charge de prospecter les établissements de cette obédience disposés à recevoir ses "enfants" dotés de noms d'emprunt. Généralement, le responsable de l'institution complice de cette solidarité clandestine s'y engage sans se référer à une autorité supérieure.
Dans le diocèse de Liège - remarquable à bien d'autres égards[29] -, c'est par contre l'évêque qui précède les fantassins! A la différence des autres évêques, Louis-Joseph Kerkhofs en personne donne l'impulsion de départ. Le comité clandestin de défense juive rappelle, à la fin de 1943, qu'"à Liège, surtout les milieux ecclésiastiques ont, dès le début des déportations, organisé très activement le sauvetage des enfants et des adultes"[30].
La visite du directeur des colonies scolaires de Liège à l'archevêché de Malines s'inscrit, à l'automne 1942, dans ces initiatives patronnées par son évêque. Les "renseignements (...) recueillis", lui rapporte-t-il, concernent uniquement "les enfants israélites" admis "dans les orphelinats et les colonies" au titre d'"enfants abandonnés". Max-Albert Van den Berg apprend que "certains supérieurs ayant demandé si l'autorité religieuse ne prenait la responsabilité de l'admission, il leur a été répondu négativement et donné le conseil que s'il leur était reproché de n'avoir pas consulté les autorités religieuses, il convenait de répliquer que celles-ci s'étaient bornées à faire savoir qu'il n'y avait aucune nouvelle directive eu égard à la situation"[31]. L'Église restait en retrait, elle laissait faire ses fidèles, mais ne couvrait pas leurs actes.
Les témoignages d'après-guerre laissent une autre impression. Les militants chrétiens du sauvetage tendent après coup à impliquer toute l'Église dans leur action. Ainsi Soeur Marie-Aurélie - Eugénie Leloup dans le siècle – "répond[…] au voeu de son Éminence le Cardinal-Archevêque Van Roey, Primat de Belgique qui fut toujours plein de sollicitude pour les enfants juifs" en faisant connaître comment son couvent des Soeurs Gardes-Malades du Très Saint Sacré-Coeur, dans le quartier "juif" d'Anderlecht, était devenu un refuge pour une dizaine de petites juives.
"Ne voulant prendre aucune décision de mon propre chef", témoigne la Mère Supérieure , "sur le conseil de notre Mère Provinciale, je me rendis à Malines pour soumettre à son Éminence notre désir de recevoir des enfants à la communauté". On lui accorda cette audience. "Notre Cardinal accueillit favorablement ma demande", continue Eugénie Leloup, "et l'on m'encouragea beaucoup dans cet acte de charité". La Soeur Marie-Aurélie relate encore que le chanoine Leclef qui l'"avait introduite chez son Éminence ne (lui) cacha pas sa satisfaction et (lui) dit, en sortant du salon, qu'il serait souhaitable que tous les couvents en fissent autant"[32].
Publiant les Actes et documents de l'archevêque de Malines face à l'occupation du pays, son secrétaire donne aussi à entendre que "par tous sortes de moyens, le Cardinal s'efforçait de venir en aide aux Juifs traqués, aux enfants privés de leurs parents, aux vieillards dénués de ressources. Que de couvents cachaient les enfants dont les parents avaient été exilés (sic) ou avaient dû prendre le maquis", ajoute même le chanoine Leclef, en 1945[33]!
Ce bilan rétrospectif n'avait pas cette netteté au moment où s'ouvrit la perspective. L'archevêché de Malines, très circonspect, ne s'était pas impliqué dans les agissements auxquels la charité chrétienne conduirait ses fidèles.
Il ne s'agissait pas seulement d'admettre des enfants juifs dans les établissements catholiques! Ce droit d'asile devait s'organiser clandestinement. Très vite, les militants chrétiens de l'hébergement clandestin seraient contraints de franchir le pas des pratiques illégales comme ce vicaire de Charneux incarcéré dès le 17 novembre 1942 pour avoir "soustrait des juifs (...) à la police de sécurité" : Paul Nolens avait lui-même falsifié leurs pièces d'identité. Le conseil de guerre condamnant ce prêtre à 18 mois de prison considérait comme "circonstances aggravantes" le fait que "l'accusé a(it) secouru les Juifs de Belgique par pitié comme il l'affirme afin de donner à ces derniers la possibilité d'échapper aux ordonnances du commandant militaire". Il n'y a pas d'échappatoire à cette logique de la résistance.
Les petites 'protégées" de Soeur Marie-Aurélie furent elles aussi pourvues de fausses identités. Dès novembre 1942, les carnets secrets de la défense juive mentionnent le couvent sous le code 412 et inscrivent un montant de pension mensuelle de 800 frs pour les fillettes les plus âgées. Cette clandestinité n'était jamais sûre. Le 20 mai 1943, les traqueurs des "affaires juives" font leur descente à l'avenue Clémenceau. Soeur Marie-Aurélie obtient qu'ils n'emmènent les petites juives que le lendemain. Alerté, le vicaire de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, l'abbé Bruylandts "se rendit immédiatement à Malines où il sollicita une entrevue avec le cardinal", relate Eugénie Leloup[34]. Le prélat qui l'avait encouragée à héberger les fillettes jugea son intercession inopportune. "Cela ne pourrait qu'aggraver la situation", aurait-il estimé. Le soir, des résistants juifs et non-juifs simulent un rapt armé avec la complicité du curé de la paroisse et des soeurs du couvent et enlèvent les enfants à la grande colère de la police de sécurité et de son officier SS en charge des affaires juives.
Si, dans le temps où la déportation des Juifs atteint son paroxysme, l'Eglise n'engage pas sa responsabilité dans ce droit d'asile qu'elle laisse s'organiser dans son enceinte, elle a néanmoins le souci du "scandale" de cette présence juive dans les établissements religieux. Il lui importe que "le nombre des enfants non-catholiques ne soit pas tel qu'ils deviennent une occasion de scandale pour les enfants catholiques". Elle recommande aussi qu'ils suivent "tous les exercices du culte catholique". Ce qui d'ailleurs s'impose pour des raisons de sécurité! Cela étant, Malines ne formule pas d'objection à cette présence juive. "Ce faisant", apprend Max-Albert Van den Berg rassuré, "les institutions ne font qu'agir conformément à l'esprit de l'Eglise qui est avant tout charité: les enfants qui nous sont confiés ou qui viennent à Elle sont, en définitive, des enfants à sauver"[35] .
D'aucuns conçoivent ce sauvetage dans l'esprit de prosélytisme traditionnel. "Il y eut", reconnaît après coup Dom Bruno Reynders, dont le réseau d'hébergement clandestin s'étendait sur tout le pays, "de la part de certains logeurs catholiques, des maladresses dues à l'ignorance, l'excès de zèle, la ferveur mal comprise et l'étroitesse d'esprit"[36]. De tels "écarts" ont néanmoins été l'exception.
Les conversions, quand elles survenaient, correspondaient à une "expérience" personnelle réellement vécue qui n'eût certes pas eu "lieu sans le malheur de la persécution", concède volontiers le moine bénédictin de l'abbaye de Mont César, à Louvain. Sous l'occupation, le comité de défense des Juifs, responsable de plus de 2.000 enfants clandestins, estimait déjà "les cas connus de conversion (...) relativement fort peu nombreux". Néanmoins, notait-il à la fin de 1943, "dans certains milieux juifs, on s'inquiète (...)".
L'"âme" des enfants n'est cependant pas une source de tensions avec les chrétiens de l'aide clandestine. Elle l'est au sein même du comité juif clandestin où les sionistes disputent aux communistes le contrôle de la section enfance. Le problème des conversions ne se pose pas moins dans les établissements catholiques, d'autant qu'il ne concerne pas les seuls enfants juifs hébergés en ces temps troublés. Le 2 mai 1944, les recommandations épiscopales invitent les aumôniers des colonies scolaires et des séjours de vacances à ne baptiser les enfants ayant atteint l'âge de raison qu'avec le consentement de l'ordinaire et après s'être informés auprès du curé des parents.
Si la problématique des conversions n'est pas le facteur déterminant, le militantisme chrétien n'entend pas moins conserver son autonomie. Les prêtres les plus engagés, le Père Joseph André à Namur, l'abbé Antoine de Breucker à St-Josse, l'abbé Jan Bruylandts à Anderlecht, ainsi que Dom Bruno, de Louvain, mobilisent leurs propres équipes de paroissiens et leurs relations. Dans cette action, ils coopèrent certes étroitement avec le comité juif clandestin, mais ils ne franchissent pas le pas de leur intégration dans cette structure comme acceptent de le faire d'autres militants non-juifs tout aussi importants. L'enjeu, aggravé par les dangers de la répression, est le contrôle des enfants qui leur ont été confiés directement par les parents ou par d'autres canaux que la résistance juive.
Au-delà se profilent les enjeux de l'immédiat après-guerre. Ils n'étaient pas encore ceux de l'après-Auschwitz.
L'après-Auschwitz ne s'ancre dans la mémoire collective qu'autour des années soixante. Les questions que pose ce deuxième temps de la mémoire invitent le plus souvent à une lecture rétrospective des comportements de l'histoire, sur base d'un paramètre qui n'a justement pas déterminé les actions de la plupart de ses acteurs. Certes, en amenant la question du silence de Pie XII, son interpellation est vraie: à l'époque, le Vatican n'ignorait rien du génocide en cours à l'Est de l'Europe. Mais pas plus que cette connaissance n'a déterminé l'attitude, ceux à qui parvenaient l'information ou encore qui la diffusaient ne s'engageaient pas sur cette base. La conscience historique n'a pas cette faculté qu'on se plaît à lui prêter, sinon d'annuler, du moins de surdéterminer les dispositions idéologiques et politiques et, au-delà, de dicter les attitudes les plus appropriées aux enjeux réels de l'histoire en cours[37].
Quoi qu'il en soit, la question ne se pose même pas dans le cas de l'Église catholique en Belgique: cette rumeur du génocide qui parvient dans le pays occupé ne trouve pas de relais dans les milieux chrétiens de la résistance, même engagés dans l'aide clandestine aux Juifs. On l'a dit, les chrétiens qui s'expriment jugent de la 'barbarie nazie' au vu des persécutions dont ils sont les témoins sur place, dans le pays. S'ils appellent à cette "belle forme de résistance" qu'est, à leurs yeux, "l'aide aux opprimés", c'est qu'ils refusent de se faire "les complices, même passifs d'une politique cynique, d'injustice", pour reprendre les termes de Churchill Gazette au plus fort de la grande vague des déportations juives de l'été 1942.
Ce discours d'époque inscrit dans l'événement un critère d'appréciation qui n'est nullement anachronique. "L'aide maximum aux Juifs" se conçoit comme un banc d'épreuve. Il s'agit, espère Churchill Gazette, "qu'après la présente guerre, on puisse dire que la Belgique s'est montrée la plus secourable aux victimes du régime hitlérien.".
Après coup, les multiples complicités dont ont bénéficié les Juifs pour échapper à la déportation donne la mesure de cette Belgique "secourable". Effectivement dans ce pays, plus de la moitié des Juifs ont survécu à la solution finale, grâce à. l'aide qu'ils ont trouvée dans la population belge et notamment grâce à un réel activisme chrétien. Cette Belgique "secourable" n'est cependant pas toute la Belgique. Si , dès le début de l'automne 1942, les services allemands s'aperçoivent qu'"une large partie de la population"[38] aide les Juifs à se soustraire aux déportations, il ne s'agit toujours, même dans une lecture apologétique, que de "quelques dizaines de milliers" de personnes[39]. Leur comportement décisif n'apure pas tous les comptes belges. Il faut tout autant s'interroger sur les conditions dans lesquelles une vingtaine de SS en charge des affaires juives sont parvenus à déporter l'autre moitié des Juifs, celle précisément qui a disparu!
Il ne suffit pas ici de pointer dans la société belge, ces milieux, très minoritaires, qui ont opté pour l'Ordre nouveau et où les policiers SS ont pu recruter les effectifs qui leur faisaient défaut pour rassembler les déportés juifs. La contribution nullement négligeable de la police anversoise ne relève pas de l'adhésion à l'extrême droite. Tout exceptionnelle qu'elle ait été, elle dérive de l'attitude d'"exécution passive" des autorités administratives nationales et locales face aux ordres de l'occupant dans la question juive. Version administrative de la politique de présence et de moindre mal, elle lui a permis d'installer et de déployer son processus d'exclusion des Juifs avec le concours des services de l'état belge. Et cette même politique de moindre mal piège, dans sa version xénophobe, les autorités du pays qui, persuadées d'avoir protégé leurs compatriotes israélites, laissent l'occupant déporter la masse des Juifs étrangers sans provoquer cette crise politique que celui-ci redoute.
L'historien peut tout au plus constater dans ses archives d'époque les traces de cette préoccupation constante du pouvoir d'occupation d'éviter de compromettre la participation des autorités belges à l'administration du pays occupé. Il n'a pas, comme le scientifique, la possibilité de vérifier ce qui se serait passé si les autorités belges, tant les autorités administratives et judiciaires que morales – les Universités et l'Église – avaient protesté ouvertement, dès les premiers pas de la législation antijuive et tout au long de son déploiement, jusqu'à ses conséquences ultimes, les déportations[40]. Le fait est qu'elles ne l'ont pas fait. Et, que ne le faisant pas, elles ont laissé à l'occupant la pleine maîtrise de sa politique antijuive. S'il a cependant fini par la perdre, c'est seulement en raison de l'insoumission croissante de la population juive rescapée des rafles de la fin de l'été 1942. Abandonnés à leur sort et restés sans défense, ces Juifs ont, en masse, cherché leur salut dans l'illégalité. Et ils se sont d'abord sauvés eux-mêmes. Les concours indispensables à leur sécurité dans la clandestinité, ils ne les ont trouvés qu'en faisant eux-mêmes la rupture avec la légalité.
Cette "belle forme de résistance" qu'ils ont rencontrée dans la population belge n'autorise pas à reporter en Belgique, telle quelle, la conclusion qu'un historien britannique dégage de l'analyse de l'opinion publique dans l'Allemagne nazie face à la question juive. "Si elle fut le fruit de la haine", constate Ian Kershaw, "la route d'Auschwitz est pavée d'indifférence"[41]. Il n'en reste pas moins que l'occupant n'a pas cessé, dans son traitement de la question juive, de tabler précisément sur cette "indifférence" d'une "population" dont il s'aperçoit qu'elle est "non intéressée" par les mesures qu'il prend contre les Juifs et qu'elle se tient "à l'écart" de ceux-ci[42]. Non pas que, dans le cas belge, les instances nazies aient eu le moindre doute sur les réactions négatives de cette population face à une persécution par trop brutale des Juifs. Sollicité au printemps 1942 d'instaurer le port obligatoire de l'étoile jaune, l'administration militaire s'abstient de le faire "pour le moment […] étant donné qu'on doit supposer que ceci provoquerait un mouvement de pitié en faveur des Juifs". L'imposition du port de l'étoile quelques semaines avant leur déportation provoquera effectivement un véritable choc dans l'opinion en rendant leur persécution visible, mais il n'aura aucune conséquence politique, les autorités belges ne relayant pas le mouvement en protestant ouvertement et publiquement.
Tout au plus, les services allemands prendront-ils en compte et uniquement dans le cas de la capitale, le refus des bourgmestres bruxellois de prêter le concours de leurs administrations à la distribution des étoiles jaunes et, donc, de s'"associer à une prescription qui porte une atteinte aussi directe à la dignité de tout homme quel qu'il soit"[43]. Le geste des bourgmestres de la capitale – certes discret et sans éclat, mais pourtant dénoncé dans la presse d'Ordre nouveau comme une "résistance passive"[44] – dissuadera les officiers SS des affaires juives de recourir à la police bruxelloise pour opérer les rafles.
Ce cas unique donne quelque consistance à l'hypothèse qu'il existait bel et bien dans la situation en Belgique occupée un espace pour une autre politique des autorités belges face à la "question juive", de 1940 à 1942. Pour l'historien, une telle histoire-fiction a l'avantage, en envisageant ce qui ne s'est pas passé, de serrer au plus près ce qui est advenu. Il ne lui appartient pas de dire ce qui aurait dû se passer. Ce questionnement ne relève plus de l'histoire, mais d'une conscience citoyenne.
Après 1945, la Belgique a longtemps considéré, et les voix les plus autorisées de la communauté juive l'ont entretenue dans ce sentiment, que "les Belges" avaient fait leur devoir "face à la persécution raciale". L'Église de Belgique en particulier n'a pas manqué de valoriser les actes des chrétiens en oubliant ses silences.
Le propre de la mémoire est d'évoluer au gré des générations qui se succèdent depuis un demi-siècle. Et; il n'est pas sûr qu'à son tour, la catholicité belge n'en arrive pas, comme l'Église de France en 1997, à "se demander si des gestes de charité et d'entraide suffisent à honorer les exigences de la justice et le respect des droits de la personne humaine"[45]
Table de matières Print (4p)
- Question de perspective
- La "barbarie" nazie
- "Cela est peu charitable" !
- Faire "enrager le boche"!
- Une "parole" de Malines ?
- Le paradoxe xénophobe
- Variations "belges"
- Un "droit d'asile" clandestin
- Les "circonstances aggravantes"
- Les conversions ?
- Histoire et Mémoire
Question de perspective
"Chaque Église", insistait René Rémond lors d'un colloque sur l'Allemagne nazie et le génocide juif, est "une société composite qui demande à être considérée dans sa totalité"[1]. Dans l'historiographie, "le silence du Vicaire" a cessé d'être la question centrale. Si le retentissement de la pièce de Rolf Hochhuth a pu, dans les années soixante, focaliser l'attention sur les attitudes pontificales, "les Églises et la persécution des Juifs pendant la seconde guerre mondiale" sont désormais étudiées dans une approche globale.
A cette fin, le professeur de l'Université de Nanterre suggérait un modèle de lecture, un "schéma" permettant de saisir les comportements. Cette grille d'interprétation serait, en somme, bipolaire. Le "problème" chrétien était, selon l'historien français, de "concilier l'action de témoignage dénonçant le crime et l'action de sauvetage visant d'abord à soustraire à la mort le plus grand nombre d'innocentes victimes"[2]. Le modèle, construit à partir du cas français et susceptible d'"ajustements", se vérifie, insiste-t-on, dans le cas hollandais. "Toutes les modalités s['y] sont trouvées expérimentées". Ce cas remarquable, estime l'historien catholique, présente "le plus vif intérêt pour qui réfléchit aujourd'hui sur ce qui était possible et s'interroge sur ce que les Églises eussent dû faire, pas seulement pour être fidèles à leur mission, mais pour que leur intervention fût efficace et préserve les Juifs".
Cette réflexion, toute légitime qu'elle soit d'un point de vue éthique, comporte le risque d'instrumentaliser les attitudes du passé. Elle institue ce qui est advenu en norme de ce qui devait advenir. Le critère objectif d'appréciation ne se réfère pas à "ce qui était possible" selon une norme chrétienne de l'après-Auschwitz. Cette problématique est métahistorique et ses termes évoluent au demeurant selon les enjeux d'un présent inconstant dans son rapport au passé. Elle pose les questions, non de l'histoire, mais de la mémoire, avec inévitablement leur part de refoulement, voire de mensonges[3]. Le problème historiographique est de rendre compte des comportements dans l'événement, pendant qu'il s'accomplit et, le plus souvent, dans l'ignorance où se trouvent ses acteurs du sens réel de cet accomplissement. A cet égard, la référence obligée s'inscrit dans les sociétés dont les Églises sont aussi une composante et d'où les services du IIIe Reich éliminent, 'extirpent' les Juifs. Dans cette lecture, le schéma de Rémond intervient comme l'une des variables parmi d'autres d'un modèle plus large et applicable à tout le corps social.
Le cas belge conduit à poser la problématique de l'Église en ces termes. C'est qu'en Belgique, le schéma de Rémond est trop réducteur pour restituer tout le comportement de l'Église catholique, de l'institution comme de ses fidèles. Dans ce pays, à la différence de ses voisins du Nord et du Sud, il n'y eut ni en français, ni en néerlandais la moindre protestation publique de l'Église contre la persécution raciale.
Les seules paroles prononcées en chaire de vérité sont des "prières pour la conversion des juifs"[4]. Selon la police de sécurité allemande, elles "n'étaient pas rares tant en Flandre qu'en Wallonie" pendant l'hiver 1942/1943. Le service allemand y découvre une preuve supplémentaire de "la propagande hostile pratiquée par le clergé". La Sécurité du Reich apprend ainsi que "les curés des paroisses et les assistants sociaux parlent des horreurs infligées aux 'pauvres juifs'".
La "barbarie" nazie
Ce témoignage chrétien contre le "crime", enregistré dans les archives nazies, n'est pas à lire rétrospectivement. Si la rumeur du génocide perpétré à l'Est parvient effectivement en Europe occidentale, la plupart des témoins occidentaux des "horreurs infligées" aux persécutés ne conçoivent nullement combien elles sont minimes en regard du sort des déportés assassinés dès l'arrivée des convois[5]. Cette "barbarie nazie" que dénonce l'opinion clandestine désigne seulement la mise en route des trains de la solution finale.
L'"horreur" dont parle, le 20 juillet 1942, "l'épiscopat catholique, de concert avec la plupart des ministres des communautés réformées de Hollande", c'est justement d'avoir "appris (...) la nouvelle des déportations massives de familles juives tout entières : hommes, femmes et enfants, vers les territoires du Reich". Cet appel chrétien à l'opinion publique s'emploie à "prévenir si possible l'exécution" de "mesures (qui) vont à l'encontre du sens moral du peuple hollandais et, qui plus est, s'opposent aux commandements de Dieu"[6].
Quant aux "scènes épouvantables" qui décident, en France, l'archevêque de Toulouse à dire publiquement son sentiment à ses fidèles, le 26 août, ce n'est rien de plus que le "triste spectacle" dont il est le témoin dans son propre diocèse - en zone non-occupée - où "des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères sont traités comme un vil troupeau"[7].
"Ces mesures", ajoute le cardinal Van Roey en ce qui concerne la Belgique , "ont été exécutées avec une brutalité et même une cruauté qui ont révolté profondément la population belge"[8]. Ce témoignage - on ne peut plus explicite - est porté … dans le secret de la diplomatie vaticane: à la fin de l'année 1942, le Primat de Belgique informe le cardinal Maglione sur le sentiment belge après la grande vague de déportation qui vient, en cent jours, de décimer, à 30 %, la population juive locale. Dans ce pays catholique où la parole de l'Église compte et où elle n'a pas manqué de se faire entendre sur d'autres sujets, la hiérarchie n'a jamais donné forme au sentiment populaire dans la question juive.
Les "prières pour la conversion des juifs", dont s'inquiète le détachement de la Sécurité du Reich dans ce territoire, renseignent-elles sur ce silence? Cette protestation bien tardive est pour le moins ambiguë. Avec son empreinte d'antijudaïsme traditionnel de l'Église, elle témoigne, en ce temps de persécutions antisémites, racistes et nazies, que l'imaginaire chrétien ne parvient toujours pas à prendre le recul attendu tout au moins par les chrétiens de la résistance.
"Cela est peu charitable" !
Un journal liégeois auquel collaborent des prêtres du diocèse le regrette, en juin 1942, dés que le port obligatoire de l'étoile jaune révèle la persécution raciale à un public stupéfait, sinon scandalisé. "Nous avons entendu des catholiques fervents, ardents patriotes dire", déplore Churchill-Gazette, "que tout en désavouant les mesures antijuives, ils ne parvenaient pas à plaindre les Juifs". Et l'organe patriotique d'expliquer à ces fidèles "peu charitable(s)" qu'"ils ne doivent pas perdre de vue cependant que si leur manque de sympathie pour les Juifs trouve son origine dans la mort du Christ, Celui-ci leur a donné le meilleur exemple. Ne s'est-il pas contenté de pleurer sur les bourreaux et par la Croix ? N'a-t-il pas demandé à son Père de leur pardonner?".
Les militants d'ordre nouveau les plus radicaux, tout hostiles qu'ils soient au catholicisme "politique", procèdent à une autre lecture de l'enseignement chrétien.
Le Pays réel - l'organe du mouvement rexiste qui se souvient de ses origines lointaines dans la droite catholique des années trente - s'attache, dans une version positive, à persuader "les esprits sincèrement religieux": "ne doivent-ils pas considérer notre tâche comme un effort sincère de retrouver dans la réalité créée le plan providentiel de Dieu"[9]. Dans cette lecture, "Dieu a fait de notre race, de la communauté populaire à laquelle nous appartenons l'instrument de ses bienfaits".
L'Ami du Peuple - organe d'une Ligue pour la Sauvegarde de la Race et du Sol déjà à la fin des années trente - préfère, dans son inspiration hitlérienne, agir comme l'instrument de la vengeance du Tout-Puissant. Dans cette version négative, le journal raciste annonce que "l'heure du règlement de compte a sonné. Depuis vingt siècles, les Juifs ont causé tant de ruines et de guerres qu'il faut leur appliquer les paroles qu'eux-mêmes ont prononcées quand Jésus fut crucifié: que son sang retombe sur nous et nos enfants. Nous autres nationaux-socialistes wallons, nous savons que nous exécuterons cette sentence"8.
L'évangile selon Matthieu et sa damnation du déicide ne sauraient pourtant intimider le chrétien de la résistance. Le christianisme lui offre d'autres références théologiques pour refuser les persécutions antisémites. À défaut d'un magister approprié de l'épiscopat belge[10], Churchill Gazette se tourne vers les "récentes paroles de l'archevêque de Montréal: il m'est impossible d'approuver les mesures prises dans certains pays contre les juifs parce que je ne dois pas oublier que le Christ est Juif d'origine et de ce fait, que je suis moi, Juif spirituellement".
Au demeurant, dans cette question juive du temps de l'occupation allemande, il n'est nullement question de religion[11]. "Nous ne voulons pas discuter de la religion, si elle a du bon ou du mauvais", avertit Churchill Gazette. "Nous le répétons, nous ne prenons pas la défense des juifs au point de vue religieux. Ces discussions ne sont pas de mise actuellement".
Faire "enrager le boche"!
Le "point de vue" adopté est résolument patriotique. Et cette option patriotique fait écran à l'antisémitisme d'importation allemande, quelle que soit la résonance de ses leitmotive dans les couches moyennes du pays. Le slogan que lance La Libre Belgique dans son numéro d'août 1942, mis sous presse peu avant le départ des premiers convois juifs, traduit sans doute le mieux le sentiment public. "Belges, que vous soyez pro ou antisémites. Souvenez-vous que les Juifs sont victimes des Boches (...). Protestez contre les mesures barbares prises à leur égard. Cela fera enrager les Boches".
Cet organe, de sensibilité chrétienne, est l'un des plus importants de la presse clandestine et il est significatif qu'après les premières déportations, c'est ce journal tirant des milliers d'exemplaires imprimés qui explique, et précisément dans cet esprit chrétien, "pourquoi le problème juif doit être à l'avant-plan de(s...) préoccupations" belges. Il doit l'être parce qu'il n'est "qu'un aspect de l'attitude des états totalitaires à l'égard de tout mouvement qui reconnaît, au delà de l'État, une solidarité internationale quelconque. Le sort des juifs aujourd'hui guette demain les maçons, après-demain les chrétiens". L'organe ne dit rien des communistes! La solidarité qu'il recommande envers les Juifs persécutés n'en est que plus remarquable, même si son argumentaire témoigne d'une incompréhension des enjeux de l'antisémitisme dans racisme nazi.
Organe de résistance, La Libre Belgique appelle en effet "tous ceux qui croient en la solidarité humaine (à) se dresse(r) pour protester, de la façon la plus énergique possible, contre toute persécution qui frappe leur conviction dans l'un ou l'autre de ses membres, même si cette persécution frappe une manière de concevoir les choses qui n'est pas la leur"[12]. Une telle mobilisation est, à son estime, "de la plus haute importance".
Pour Churchill-Gazette, c'est même aux autorités du pays - entre autres, à "notre clergé" - à qui il incombe de "protester énergiquement". Dans cette attente d'une parole autorisée, l'organe liégeois se trouve "réconfort(é) d'apprendre par les radios anglaises et neutres que, dans un sermon qui fera époque, l'archevêque de Toulouse s'est solennellement élevé en chaire de vérité contre les persécutions organisées en France". Le journal a même découvert "une protestation [sic] du Pape auprès du gouvernement" français[13]. "Ce sera l'honneur de l'Église catholique", est-il trop heureux d'annoncer, "d'avoir été les premiers à protester officiellement. Nous espérons, nous souhaitons que cette protestation s'amplifiera".
Elle s'amplifie effectivement, mais toujours en France où les voix les plus autorisées de l'Église, cessant d'acquiescer par leur silence aux persécutions antijuives de l'"État français", disent plus que la protestation d'une "France chevaleresque et généreuse" dans "la tradition du respect de la personne humaine"[14]. Elles posent un acte politique qui imprime sa marque à l'événement en cours! Il s'agit, en l'occurrence d'une "résistance sans pareille de la part de l'Église"[15] et un tel acte posé par l'un des piliers du régime du Maréchal Pétain contraint, en effet, le gouvernement de Vichy, tout désireux qu'il soit "de régler la question juive", à cesser d'acquiescer à l'engagement systématique de ses polices dans l'arrestation des Juifs, comme le comprennent bon gré mal gré ses interlocuteurs de la police nazie dès le 2 septembre.
Les "paroles" de cette Église inspirent à un autre journal clandestin belge, La Légion Noire , la conclusion que "le catholicisme en France et en Belgique (sic) comme celui de n'importe quelle nation ne se prête jamais aux traitements honteux infligés à n'importe quelle personne. Elle est respectable et peu importe la nuance à laquelle elle appartient, l'Église sait lui donner la place qui lui revient dans l'existence d'ici-bas. Seuls les monstres ignorent les sentiments d'humanité que la charité chrétienne commande et que la loi naturelle elle-même exige". Et comme si effectivement "l'épiscopat à ce moment prend parole", ce message chrétien s'autorise de la signature d'un "A.B."[16].
Une "parole" de Malines ?
Dans ce pays, le chrétien n'est cependant pas autorisé à invoquer l'autorité de son Église pour justifier sa résistance! Ni le cardinal Van Roey, ni les évêques - pas même celui du diocèse de Liège Mgr. Kerkhofs pourtant le plus engagé - ne font entendre cette autorisation face à ce que La Libre Belgique chrétienne dénonce pourtant comme un "retour à la barbarie, [un] recul vers les épisodes de l'Histoire de l'humanité qui nous font tous rougir à l'heure actuelle".
En dépit de son silence, la plus haute autorité de l'Église belge partage certes le sentiment public. Le jour même où le premier convoi quitte le pays, - le 4 août 1942 -, le Primat de Belgique informe le Vatican qu'"actuellement, les traitements qu'on fait subir aux Juifs sont vraiment inhumains et excitent la commisération et l'indignation générales"[17]. Un geste du cardinal Van Roey a même signifié son sentiment personnel. Comme le Consistoire Central Israélite l'en remercie, le 12 août, avec une "profonde gratitude", il lui a manifesté sa "bienveillance et (sa) sympathie (...) à l'occasion des pénibles épreuves que subit en ce moment la population juive". Il l'a fait sous la forme d'une entrevue accordée au Grand Rabbin Salomon Ullmann.
Ce dernier, suivant les avis des notables belges dont le cardinal, préside la communauté obligatoire depuis sa création sur ordre de l'occupant à la fin de 1941. Cette Association des Juifs en Belgique venait, le 22 juillet, d'être requise de distribuer à ses membres les ordres individuels de se présenter au camp de rassemblement. Résigné à leur distribution, le Grand Rabbin alerte les autorités belges et recherche leur aval.
Sa démarche auprès du cardinal ne laisse aucune trace dans les archives allemandes. L'audience est d'une grande discrétion, mais elle ne reste pas sans écho. La Résistance - du moins l'organe clandestin portant ce titre - diffuse, dès la fin de juillet, la nouvelle que "Mgr Van Roey, Primat de Belgique a reçu officiellement à l'archevêché le Grand Rabbin de Belgique". A suivre l'interprétation du journal patriotique, ce geste signifierait que "les autorités ecclésiastiques ont témoigné ouvertement leur réprobation à l'égard des mesures antijuives" .
Il n'en est rien. Un instant, le cardinal a sans doute songé à répondre à cette attente diffuse. "Son Éminence s'est posé la question de savoir s'il convenait de faire une protestation contre le sort fait aux juifs"[18]. Un témoin bien informé le rapporte in tempore non suspecto, si l'on ose dire. L'avocat Max-Albert Van den Berg, directeur des Colonies Scolaires catholiques de la province de Liège, n'a pas survécu au camp de concentration où la police SS l'avait transféré parce qu'"il avait accepté dans les maisons d'enfants qui étaient sous sa direction des enfants juifs et les a soustraits aux mesures contre les Juifs". Au moment d'entreprendre le sauvetage des enfants juifs qui lui vaudra de perdre la vie, il se rend à l'archevêché de Malines pour connaître les dispositions de l'Église. Il n'a pas vu le cardinal, mais son interlocuteur Mgr. Van Eynden, vicaire général de l'archidiocèse, a toute autorité pour connaître la doctrine officielle en la matière.
Malines n'ignore rien du drame juif en train de s'accomplir, en cette fin de l'été 1942. Le chanoine Leclef, le secrétaire du cardinal, ne vit jamais, selon son témoignage d'après guerre, "rien de plus pitoyable, ni de plus révoltant que ce long cortège d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, emmenés vers un destin épouvantable". Il y avait aussi des enfants en bas âge et des vieillards, et ce, dans ce pays, dès les premiers transports vers Auschwitz. Ce dont justement le chanoine Leclef n'a pas gardé le souvenir dans son témoignage d'après guerre. Il était pourtant un observateur privilégié. La caserne Dossin où la police nazie avait installé son camp de rassemblement pour la déportation des Juifs est à peu de distance de l'archevêché de Malines.
Dans Le Cardinal Van Roey et l'occupation allemande en Belgique que le chanoine publie, en 1945, il avance aussi, à propos de l'attitude de l'Église, une autre explication que celle recueillie à l'époque par l'avocat liégeois. Au nom du cardinal, son secrétaire personnel est intervenu auprès d'autorités allemands en faveur de Juifs catholiques requis de se présenter à la caserne Dossin, aussi de femmes enceintes qui avaient fait appel au chef de l'Église "lui demandant aide et protection".
Ces démarches pour "obtenir des mitigations" furent vaines, expose le Primat de Belgique au cardinal Maglione, le 4 août 1942! "J'étais indigné", se souvient pour sa part, le chanoine Leclef. Il garde en mémoire un entretien avec un officier allemand à qui "délibérément", il cria son indignation. "Je ne puis comprendre que des officiers comme vous couvrent et excusent les illégalités, les injustices et les crimes perpétrés par la Gestapo ", lui aurait-il même déclaré. "Le Cardinal à qui je rapportais aussitôt cette conversation, jugea que toute démarche ultérieure serait inutile"[19].
La relation que le directeur des Colonies scolaires catholiques adresse, le 21 septembre 1942, à l'évêque de Liège, Mgr. Kerkhofs, n'impute pas le silence du cardinal à ces précédents décevants. C'est d'une manière générale que Van Roey aurait jugé sa protestation inopportune face à l'occupant. A Van den Berg, on a expliqué qu'"il est démontré, par les protestations antérieures, que l'autorité occupante n'y a aucun égard, en sorte qu'une protestation aurait toute chance d'être aussi vaine que les protestations antérieures relatives à d'autres sujets"[20]
Ce sentiment d'impuissance n'empêche pas le chef de l'Eglise belge de se prononcer publiquement sur d'autres sujets graves. La raison principale du silence de l'Eglise belge face à la déportation juive relève d'une autre attitude. Le Primat de Belgique sensible à l'attente chrétienne d'une protestation autorisée "a décidé de n'en rien faire" parce que, note Van den Berg en premier lieu, "les Allemands ont déclaré ne vouloir s'occuper que des Juifs allemands, visant par ce terme les Juifs de la Grande Allemagne , inclus la Pologne , la Silésie , l'Ukraine, la Yougoslavie et l'Autriche. Les Juifs belges et hollandais n'auraient donc rien à craindre, au moins pour le moment" .
Le paradoxe xénophobe[21]
Dans cette acceptation surprenante des prétentions de la puissance occupante en Europe centrale et orientale, l'autorité religieuse, rassurée sur le sort de ses compatriotes israélites, ne réagit pas autrement à la tragédie juive du terrible été 1942 que les autres autorités nationales[22]. Le 15 septembre, le chef de l'administration militaire allemande se montre fort satisfait de ce que l'"Action Est", confiée à la police SS, "ne fit pas trop de sensation dans l'opinion publique". Avec soulagement, l'adjoint le plus important du Général Alexander von Falkenhausen note que "les représentants du ministère de la justice belge et des autres institutions belges ont toujours déclaré qu'ils ne voulaient s'occuper que des juifs de nationalité belge"[23].
Avec un sens très fin des opportunités, Eggert Reeder, chef de son administration militaire, a prévu, dès qu'il a appris que la Sécurité du Reich se disposait à entamer la déportation de son ressort territorial, qu'il désamorcerait toute crise dans les relations du pouvoir d'occupation avec les autorités du pays en leur laissant l'impression de négocier la protection de leurs ressortissants juifs[24]. Le 9 juillet, avant même que la moindre rumeur sur l'imminente déportation n'ait filtré du côté belge, Reeder négocie en personne avec Himmler la concession - tout au moins provisoire - des citoyens juifs.
Général SS à titre honorifique, mais non pas l'homme de la SS , le chef de l'administration militaire a la préoccupation permanente dans le traitement de la question juive d'"amener les résultats obtenus en concordance avec les répercussions politiques"[25]. Pendant les déportations raciales de 1942, l 'immunité des citoyens juifs est son maître atout.
"L'administration militaire avait renoncé à la déportation d'environ 3.000 juifs belges pour éviter une aggravation de la situation générale", expliquera-t-il, un an plus tard, après le départ du convoi XXII B, B comme "belge"[26]. Le pouvoir d'occupation, très pragmatique, a ainsi au moment crucial aménagé aux autorités du pays un espace de moindre mal dans la solution finale.
Cette politique de moindre mal - pratique constante des autorités belges de l'occupation - s'avère, dans la question juive, particulièrement étriquée. Elle n'en suscite pas moins des réticences du côté allemand. A la veille des déportations de 1942, le représentant d'un service impliqué dans l'opération, s'inquiète de "la raison pour laquelle on épargnait les Juifs de nationalité belge". On fait comprendre à l'impatient que "des 50.000 juifs de Belgique environ vivant actuellement [dans le pays], 10 % seulement étaient de nationalité belge de sorte que par cette action imminente, la grande partie des juifs vivant ici serait atteinte"[27].
La part des 'privilégiés' dans la population juive est encore moindre que l'évalue l'autorité allemande: à peine de 6 % de Belges parmi les 56.000 Juifs de la cartothèque de la police nazie. La 'protection' dont ils bénéficient pendant une longue année se traduit, dans le bilan global de la solution finale en Belgique occupée, par un paradoxe statistique. Il convient de le qualifier de xénophobe à défaut d'une caractérisation mieux appropriée. Le racisme antijuif, totalitaire dans son principe, n'affecte pas, en effet, de manière égale tous les Juifs du pays. Dans cette démographie macabre, la différence va du simple au double selon leur statut national. Si 23 % des citoyens juifs ont finalement emprunté l'itinéraire fatal d'Auschwitz, la proportion s'élève à 45 % chez les Juifs étrangers résidant dans ce pays.
De toute évidence, les ressortissants étrangers d'origine juive, la plupart des immigrés récents et, pour un cinquième, des réfugiés du Grand Reich allemand arrivés à la veille de la guerre, ont été - et tragiquement - les plus vulnérables.
Variations "belges"
Cette vulnérabilité renvoie à la politique de moindre mal des autorités belges. Leur attitude a varié selon que l'occupant s'attaque à leurs compatriotes israélites ou aux Juifs étrangers. Le paradoxe xénophobe dans la solution finale ressort de la manière singulière dont les responsables belges ont respecté le prescrit constitutionnel. Les autorités nationales ont réservé la protection des personnes aux seuls citoyens israélites et, dans la dérive du possible conçu par le pouvoir d'occupation, elles lui ont épargné cette crise politique que la déportation massive des Juifs étrangers par sa police politique lui faisait redouter.
En Belgique, les autorités autochtones ne les ont pas livrés aux services allemands. L'appareil d'Etat n'y était pas comme en France rallié à l'Ordre Nouveau. Dans ce pays, le recours à la police nationale pour rassembler les déportés se fait à l'insu des autorités administratives. Il est, au demeurant, absolument exceptionnel.
Le constat n'enlève rien à la gravité de l'événement: toutes proportions gardées, les razzias d'Anvers, dans les nuits des 15/16 et 28/29 août 1942 reproduisent dans un tout autre contexte politique la grande rafle du Vel' d'Hiver à Paris, les 15 et 16 juillet. Les ravages sont identiques: les policiers anversois arrêtent de cinq à sept fois moins de personnes que leurs collègues parisiens dans une population juive cinq à sept fois moins nombreuse. Ce qui, en revanche, n'est pas comparable, c'est qu'ici, l'autorité d'occupation, toujours attentive aux "conséquences extrêmement fâcheuses au point de vue politique" des initiatives inconsidérées de la police de sécurité, se voit dans l'obligation politique de lui rappeler les conventions passées excluant les polices belges des "opérations d'envergure" contre les Juifs[28].
Dans ce pays, si la police nationale met seulement 15 % des Juifs déportés à la disposition des agents de la Sécurité du Reich en charge de la solution finale, c'est parce que la politique de l'occupant n'entend pas impliquer l'appareil d'Etat belge dans la déportation raciale. Le succès de l'entreprise commande qu'au moment du plus grand danger, les Juifs étrangers soient laissés à eux-mêmes et sans défense.
Abandonnés, ils ne sont cependant pas restés longtemps à la merci des services allemands et de leurs auxiliaires belges d'ordre nouveau. Les grandes rafles de la fin de l'été 1942 leur ont appris douloureusement que la soumission à la légalité de l'occupation, y compris aux lois belges, ne leur laisse pas d'autre alternative que d'être, à leur tour, déportés. La terrible leçon leur fut salutaire. Dès l'automne, ils font en masse la rupture et cette plongée dans le monde souterrain de l'occupation brise, dans ce pays, définitivement l'élan de la solution finale .
Mais alors que les services allemands perdent irrémédiablement la maîtrise de l'événement juif, les autorités belges ne sont pas moins pusillanimes que pendant la "mise au travail" de l'été 1942. Même l'institution catholique évite d'engager sa responsabilité: ménagée par l'occupant dans ses oeuvres et ses mouvements d'action, elle ne prend pas l'initiative d'y aménager un espace clandestin pour l'asile aux fugitifs juifs. L'initiative en vient de cette base chrétienne chez qui la défense des valeurs l'emporte sur tout autre considération d'opportunité, y compris le souci de préserver les institutions catholiques.
Tel est du moins l'argumentaire de Churchill Gazette à Liège: appelant les autorités à protester énergiquement, le journal clandestin sait par avance la vanité de ses appels et il s'adresse plutôt aux "hommes de bonne volonté", les "vrais Belges, les patriotes qui savent eux (sic) que la domination boche n'est que passagère": ils "doivent, quand ils le peuvent, donner aide et assistance aux persécutés. L'asile est dû aux opprimés. Il faut les cacher, les héberger chaque fois que c'est possible. Il ne manque pas de moyens pour atténuer leurs souffrances. Il faut les soustraire au sort affreux qui les guette".
L'inspiration est ici pleinement chrétienne: "Comme le dit l'archevêque de Toulouse", explique l'organe liégeois, "les Juifs sont des hommes comme nous. Leurs malheurs actuels doivent nous les faire aimer. Ne nous contentons plus demain de saluer les porteurs d'étoile jaune. Nous devons maintenant les aider à ne plus la porter afin qu'on ne les remarque plus dans la foule anonyme". Et, l'organe chrétien d'énoncer alors cette vérité profonde que l'histoire authentifie: "l'aide maximum aux Juifs, nous le répétons est une belle forme de résistance" .
Un "droit d'asile" clandestin
En première ligne, dans les quartiers 'juifs', des prêtres, des religieuses, des militants sociaux sont personnellement confrontés à cette nouvelle pratique du droit d'asile. Sur le point d'enlever leur étoile, des parents, souvent des réfugiés allemands dépourvus d'attache dans ce pays d'exil, se tournent vers les paroisses voisines pour leur confier leurs enfants.
De son côté, le Front de l'Indépendance - le principal mouvement de résistance sous l'occupation où précisément des chrétiens côtoient les communistes - fournit à sa section de défense des Juifs une assistante sociale catholique: elle aura la charge de prospecter les établissements de cette obédience disposés à recevoir ses "enfants" dotés de noms d'emprunt. Généralement, le responsable de l'institution complice de cette solidarité clandestine s'y engage sans se référer à une autorité supérieure.
Dans le diocèse de Liège - remarquable à bien d'autres égards[29] -, c'est par contre l'évêque qui précède les fantassins! A la différence des autres évêques, Louis-Joseph Kerkhofs en personne donne l'impulsion de départ. Le comité clandestin de défense juive rappelle, à la fin de 1943, qu'"à Liège, surtout les milieux ecclésiastiques ont, dès le début des déportations, organisé très activement le sauvetage des enfants et des adultes"[30].
La visite du directeur des colonies scolaires de Liège à l'archevêché de Malines s'inscrit, à l'automne 1942, dans ces initiatives patronnées par son évêque. Les "renseignements (...) recueillis", lui rapporte-t-il, concernent uniquement "les enfants israélites" admis "dans les orphelinats et les colonies" au titre d'"enfants abandonnés". Max-Albert Van den Berg apprend que "certains supérieurs ayant demandé si l'autorité religieuse ne prenait la responsabilité de l'admission, il leur a été répondu négativement et donné le conseil que s'il leur était reproché de n'avoir pas consulté les autorités religieuses, il convenait de répliquer que celles-ci s'étaient bornées à faire savoir qu'il n'y avait aucune nouvelle directive eu égard à la situation"[31]. L'Église restait en retrait, elle laissait faire ses fidèles, mais ne couvrait pas leurs actes.
Les témoignages d'après-guerre laissent une autre impression. Les militants chrétiens du sauvetage tendent après coup à impliquer toute l'Église dans leur action. Ainsi Soeur Marie-Aurélie - Eugénie Leloup dans le siècle – "répond[…] au voeu de son Éminence le Cardinal-Archevêque Van Roey, Primat de Belgique qui fut toujours plein de sollicitude pour les enfants juifs" en faisant connaître comment son couvent des Soeurs Gardes-Malades du Très Saint Sacré-Coeur, dans le quartier "juif" d'Anderlecht, était devenu un refuge pour une dizaine de petites juives.
"Ne voulant prendre aucune décision de mon propre chef", témoigne la Mère Supérieure , "sur le conseil de notre Mère Provinciale, je me rendis à Malines pour soumettre à son Éminence notre désir de recevoir des enfants à la communauté". On lui accorda cette audience. "Notre Cardinal accueillit favorablement ma demande", continue Eugénie Leloup, "et l'on m'encouragea beaucoup dans cet acte de charité". La Soeur Marie-Aurélie relate encore que le chanoine Leclef qui l'"avait introduite chez son Éminence ne (lui) cacha pas sa satisfaction et (lui) dit, en sortant du salon, qu'il serait souhaitable que tous les couvents en fissent autant"[32].
Publiant les Actes et documents de l'archevêque de Malines face à l'occupation du pays, son secrétaire donne aussi à entendre que "par tous sortes de moyens, le Cardinal s'efforçait de venir en aide aux Juifs traqués, aux enfants privés de leurs parents, aux vieillards dénués de ressources. Que de couvents cachaient les enfants dont les parents avaient été exilés (sic) ou avaient dû prendre le maquis", ajoute même le chanoine Leclef, en 1945[33]!
Ce bilan rétrospectif n'avait pas cette netteté au moment où s'ouvrit la perspective. L'archevêché de Malines, très circonspect, ne s'était pas impliqué dans les agissements auxquels la charité chrétienne conduirait ses fidèles.
Les "circonstances aggravantes"
Il ne s'agissait pas seulement d'admettre des enfants juifs dans les établissements catholiques! Ce droit d'asile devait s'organiser clandestinement. Très vite, les militants chrétiens de l'hébergement clandestin seraient contraints de franchir le pas des pratiques illégales comme ce vicaire de Charneux incarcéré dès le 17 novembre 1942 pour avoir "soustrait des juifs (...) à la police de sécurité" : Paul Nolens avait lui-même falsifié leurs pièces d'identité. Le conseil de guerre condamnant ce prêtre à 18 mois de prison considérait comme "circonstances aggravantes" le fait que "l'accusé a(it) secouru les Juifs de Belgique par pitié comme il l'affirme afin de donner à ces derniers la possibilité d'échapper aux ordonnances du commandant militaire". Il n'y a pas d'échappatoire à cette logique de la résistance.
Les petites 'protégées" de Soeur Marie-Aurélie furent elles aussi pourvues de fausses identités. Dès novembre 1942, les carnets secrets de la défense juive mentionnent le couvent sous le code 412 et inscrivent un montant de pension mensuelle de 800 frs pour les fillettes les plus âgées. Cette clandestinité n'était jamais sûre. Le 20 mai 1943, les traqueurs des "affaires juives" font leur descente à l'avenue Clémenceau. Soeur Marie-Aurélie obtient qu'ils n'emmènent les petites juives que le lendemain. Alerté, le vicaire de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, l'abbé Bruylandts "se rendit immédiatement à Malines où il sollicita une entrevue avec le cardinal", relate Eugénie Leloup[34]. Le prélat qui l'avait encouragée à héberger les fillettes jugea son intercession inopportune. "Cela ne pourrait qu'aggraver la situation", aurait-il estimé. Le soir, des résistants juifs et non-juifs simulent un rapt armé avec la complicité du curé de la paroisse et des soeurs du couvent et enlèvent les enfants à la grande colère de la police de sécurité et de son officier SS en charge des affaires juives.
Si, dans le temps où la déportation des Juifs atteint son paroxysme, l'Eglise n'engage pas sa responsabilité dans ce droit d'asile qu'elle laisse s'organiser dans son enceinte, elle a néanmoins le souci du "scandale" de cette présence juive dans les établissements religieux. Il lui importe que "le nombre des enfants non-catholiques ne soit pas tel qu'ils deviennent une occasion de scandale pour les enfants catholiques". Elle recommande aussi qu'ils suivent "tous les exercices du culte catholique". Ce qui d'ailleurs s'impose pour des raisons de sécurité! Cela étant, Malines ne formule pas d'objection à cette présence juive. "Ce faisant", apprend Max-Albert Van den Berg rassuré, "les institutions ne font qu'agir conformément à l'esprit de l'Eglise qui est avant tout charité: les enfants qui nous sont confiés ou qui viennent à Elle sont, en définitive, des enfants à sauver"[35] .
Les conversions ?
D'aucuns conçoivent ce sauvetage dans l'esprit de prosélytisme traditionnel. "Il y eut", reconnaît après coup Dom Bruno Reynders, dont le réseau d'hébergement clandestin s'étendait sur tout le pays, "de la part de certains logeurs catholiques, des maladresses dues à l'ignorance, l'excès de zèle, la ferveur mal comprise et l'étroitesse d'esprit"[36]. De tels "écarts" ont néanmoins été l'exception.
Les conversions, quand elles survenaient, correspondaient à une "expérience" personnelle réellement vécue qui n'eût certes pas eu "lieu sans le malheur de la persécution", concède volontiers le moine bénédictin de l'abbaye de Mont César, à Louvain. Sous l'occupation, le comité de défense des Juifs, responsable de plus de 2.000 enfants clandestins, estimait déjà "les cas connus de conversion (...) relativement fort peu nombreux". Néanmoins, notait-il à la fin de 1943, "dans certains milieux juifs, on s'inquiète (...)".
L'"âme" des enfants n'est cependant pas une source de tensions avec les chrétiens de l'aide clandestine. Elle l'est au sein même du comité juif clandestin où les sionistes disputent aux communistes le contrôle de la section enfance. Le problème des conversions ne se pose pas moins dans les établissements catholiques, d'autant qu'il ne concerne pas les seuls enfants juifs hébergés en ces temps troublés. Le 2 mai 1944, les recommandations épiscopales invitent les aumôniers des colonies scolaires et des séjours de vacances à ne baptiser les enfants ayant atteint l'âge de raison qu'avec le consentement de l'ordinaire et après s'être informés auprès du curé des parents.
Si la problématique des conversions n'est pas le facteur déterminant, le militantisme chrétien n'entend pas moins conserver son autonomie. Les prêtres les plus engagés, le Père Joseph André à Namur, l'abbé Antoine de Breucker à St-Josse, l'abbé Jan Bruylandts à Anderlecht, ainsi que Dom Bruno, de Louvain, mobilisent leurs propres équipes de paroissiens et leurs relations. Dans cette action, ils coopèrent certes étroitement avec le comité juif clandestin, mais ils ne franchissent pas le pas de leur intégration dans cette structure comme acceptent de le faire d'autres militants non-juifs tout aussi importants. L'enjeu, aggravé par les dangers de la répression, est le contrôle des enfants qui leur ont été confiés directement par les parents ou par d'autres canaux que la résistance juive.
Au-delà se profilent les enjeux de l'immédiat après-guerre. Ils n'étaient pas encore ceux de l'après-Auschwitz.
Histoire et Mémoire
L'après-Auschwitz ne s'ancre dans la mémoire collective qu'autour des années soixante. Les questions que pose ce deuxième temps de la mémoire invitent le plus souvent à une lecture rétrospective des comportements de l'histoire, sur base d'un paramètre qui n'a justement pas déterminé les actions de la plupart de ses acteurs. Certes, en amenant la question du silence de Pie XII, son interpellation est vraie: à l'époque, le Vatican n'ignorait rien du génocide en cours à l'Est de l'Europe. Mais pas plus que cette connaissance n'a déterminé l'attitude, ceux à qui parvenaient l'information ou encore qui la diffusaient ne s'engageaient pas sur cette base. La conscience historique n'a pas cette faculté qu'on se plaît à lui prêter, sinon d'annuler, du moins de surdéterminer les dispositions idéologiques et politiques et, au-delà, de dicter les attitudes les plus appropriées aux enjeux réels de l'histoire en cours[37].
Quoi qu'il en soit, la question ne se pose même pas dans le cas de l'Église catholique en Belgique: cette rumeur du génocide qui parvient dans le pays occupé ne trouve pas de relais dans les milieux chrétiens de la résistance, même engagés dans l'aide clandestine aux Juifs. On l'a dit, les chrétiens qui s'expriment jugent de la 'barbarie nazie' au vu des persécutions dont ils sont les témoins sur place, dans le pays. S'ils appellent à cette "belle forme de résistance" qu'est, à leurs yeux, "l'aide aux opprimés", c'est qu'ils refusent de se faire "les complices, même passifs d'une politique cynique, d'injustice", pour reprendre les termes de Churchill Gazette au plus fort de la grande vague des déportations juives de l'été 1942.
Ce discours d'époque inscrit dans l'événement un critère d'appréciation qui n'est nullement anachronique. "L'aide maximum aux Juifs" se conçoit comme un banc d'épreuve. Il s'agit, espère Churchill Gazette, "qu'après la présente guerre, on puisse dire que la Belgique s'est montrée la plus secourable aux victimes du régime hitlérien.".
Après coup, les multiples complicités dont ont bénéficié les Juifs pour échapper à la déportation donne la mesure de cette Belgique "secourable". Effectivement dans ce pays, plus de la moitié des Juifs ont survécu à la solution finale, grâce à. l'aide qu'ils ont trouvée dans la population belge et notamment grâce à un réel activisme chrétien. Cette Belgique "secourable" n'est cependant pas toute la Belgique. Si , dès le début de l'automne 1942, les services allemands s'aperçoivent qu'"une large partie de la population"[38] aide les Juifs à se soustraire aux déportations, il ne s'agit toujours, même dans une lecture apologétique, que de "quelques dizaines de milliers" de personnes[39]. Leur comportement décisif n'apure pas tous les comptes belges. Il faut tout autant s'interroger sur les conditions dans lesquelles une vingtaine de SS en charge des affaires juives sont parvenus à déporter l'autre moitié des Juifs, celle précisément qui a disparu!
Il ne suffit pas ici de pointer dans la société belge, ces milieux, très minoritaires, qui ont opté pour l'Ordre nouveau et où les policiers SS ont pu recruter les effectifs qui leur faisaient défaut pour rassembler les déportés juifs. La contribution nullement négligeable de la police anversoise ne relève pas de l'adhésion à l'extrême droite. Tout exceptionnelle qu'elle ait été, elle dérive de l'attitude d'"exécution passive" des autorités administratives nationales et locales face aux ordres de l'occupant dans la question juive. Version administrative de la politique de présence et de moindre mal, elle lui a permis d'installer et de déployer son processus d'exclusion des Juifs avec le concours des services de l'état belge. Et cette même politique de moindre mal piège, dans sa version xénophobe, les autorités du pays qui, persuadées d'avoir protégé leurs compatriotes israélites, laissent l'occupant déporter la masse des Juifs étrangers sans provoquer cette crise politique que celui-ci redoute.
L'historien peut tout au plus constater dans ses archives d'époque les traces de cette préoccupation constante du pouvoir d'occupation d'éviter de compromettre la participation des autorités belges à l'administration du pays occupé. Il n'a pas, comme le scientifique, la possibilité de vérifier ce qui se serait passé si les autorités belges, tant les autorités administratives et judiciaires que morales – les Universités et l'Église – avaient protesté ouvertement, dès les premiers pas de la législation antijuive et tout au long de son déploiement, jusqu'à ses conséquences ultimes, les déportations[40]. Le fait est qu'elles ne l'ont pas fait. Et, que ne le faisant pas, elles ont laissé à l'occupant la pleine maîtrise de sa politique antijuive. S'il a cependant fini par la perdre, c'est seulement en raison de l'insoumission croissante de la population juive rescapée des rafles de la fin de l'été 1942. Abandonnés à leur sort et restés sans défense, ces Juifs ont, en masse, cherché leur salut dans l'illégalité. Et ils se sont d'abord sauvés eux-mêmes. Les concours indispensables à leur sécurité dans la clandestinité, ils ne les ont trouvés qu'en faisant eux-mêmes la rupture avec la légalité.
Cette "belle forme de résistance" qu'ils ont rencontrée dans la population belge n'autorise pas à reporter en Belgique, telle quelle, la conclusion qu'un historien britannique dégage de l'analyse de l'opinion publique dans l'Allemagne nazie face à la question juive. "Si elle fut le fruit de la haine", constate Ian Kershaw, "la route d'Auschwitz est pavée d'indifférence"[41]. Il n'en reste pas moins que l'occupant n'a pas cessé, dans son traitement de la question juive, de tabler précisément sur cette "indifférence" d'une "population" dont il s'aperçoit qu'elle est "non intéressée" par les mesures qu'il prend contre les Juifs et qu'elle se tient "à l'écart" de ceux-ci[42]. Non pas que, dans le cas belge, les instances nazies aient eu le moindre doute sur les réactions négatives de cette population face à une persécution par trop brutale des Juifs. Sollicité au printemps 1942 d'instaurer le port obligatoire de l'étoile jaune, l'administration militaire s'abstient de le faire "pour le moment […] étant donné qu'on doit supposer que ceci provoquerait un mouvement de pitié en faveur des Juifs". L'imposition du port de l'étoile quelques semaines avant leur déportation provoquera effectivement un véritable choc dans l'opinion en rendant leur persécution visible, mais il n'aura aucune conséquence politique, les autorités belges ne relayant pas le mouvement en protestant ouvertement et publiquement.
Tout au plus, les services allemands prendront-ils en compte et uniquement dans le cas de la capitale, le refus des bourgmestres bruxellois de prêter le concours de leurs administrations à la distribution des étoiles jaunes et, donc, de s'"associer à une prescription qui porte une atteinte aussi directe à la dignité de tout homme quel qu'il soit"[43]. Le geste des bourgmestres de la capitale – certes discret et sans éclat, mais pourtant dénoncé dans la presse d'Ordre nouveau comme une "résistance passive"[44] – dissuadera les officiers SS des affaires juives de recourir à la police bruxelloise pour opérer les rafles.
Ce cas unique donne quelque consistance à l'hypothèse qu'il existait bel et bien dans la situation en Belgique occupée un espace pour une autre politique des autorités belges face à la "question juive", de 1940 à 1942. Pour l'historien, une telle histoire-fiction a l'avantage, en envisageant ce qui ne s'est pas passé, de serrer au plus près ce qui est advenu. Il ne lui appartient pas de dire ce qui aurait dû se passer. Ce questionnement ne relève plus de l'histoire, mais d'une conscience citoyenne.
Après 1945, la Belgique a longtemps considéré, et les voix les plus autorisées de la communauté juive l'ont entretenue dans ce sentiment, que "les Belges" avaient fait leur devoir "face à la persécution raciale". L'Église de Belgique en particulier n'a pas manqué de valoriser les actes des chrétiens en oubliant ses silences.
Le propre de la mémoire est d'évoluer au gré des générations qui se succèdent depuis un demi-siècle. Et; il n'est pas sûr qu'à son tour, la catholicité belge n'en arrive pas, comme l'Église de France en 1997, à "se demander si des gestes de charité et d'entraide suffisent à honorer les exigences de la justice et le respect des droits de la personne humaine"[45]
Le rendez-vous raté de la justice et du génocide
Il y a un déni de reconnaissance du génocide par le système judiciaire et l'appareil d'état.
Maxime Steinberg a évoqué cet aspect dans l'article suivant :
M. STEINBERG, "Le génocide aux rendez-vous du palais", in Justice et Barbarie 1940-1944, in Juger, n° 6-7, 1994.
Table de matières
Il est, en histoire, des rendez-vous manqués. Ses acteurs vivent l'instant présent en ignorant le sens réel de son accomplissement. "On ne savait pas", disent-ils après coup. Cet hiatus dans la conscience historique est typique de l'histoire du génocide juif ou, pour mieux dire, de la "solution finale". La formule du discours nazi d'époque dit bien l'ambiguïté de l'événement. Il comporte tout à la fois la déportation des Juifs et leur extermination; d'une part, leur évacuation d'un territoire au vu et au su de ses populations, et d'autre part, dans le secret de ses centres d'extermination, l'assassinat systématique des "évacués" dès leur débarquement. Ce secret et ses conventions de langage codées ont posé, après coup, la question la plus épineuse aux magistrats chargés d'instruire les procès des responsables des déportations juives. Cette difficulté inhérente aux retombées judiciaires du génocide juif n'explique pourtant pas que, pour leur part, les magistrats belges aient raté ce rendez-vous avec l'histoire à peine accomplie.
Durant son accomplissement, dans un pays où l'appareil d'Etat ne s'était pas rallié à l'Ordre nouveau, le Palais de Justice était resté à l'écart du dispositif antijuif importé par l'occupant. Au cours de ce premier rendez-vous avec l'histoire, les autorités judiciaires belges n'eurent guère à "se salir les mains" dans la "question juive". C'est l'occupant qui s'appliquait à la résoudre après l'avoir posée. Leur incompétence juridique sauvegardée dans cette matière scabreuse, elles ont pourtant infléchi son cours en laissant - selon une métaphore juridique d'époque - les administrations belges prendre part à l'oeuvre du "bourreau".
Après coup, dans l'après-1945, il apparut aux juristes chargés d'enquêter sur les "crimes de guerre" que l'occupant avait accompli une "oeuvre de mort" avec la déportation des Juifs. Ils lui appliquèrent une grille de lecture juridique inadéquate. Elle s'attachait aux "crimes de droit commun" perpétrés sur place. Le modèle dissociait la déportation de l'extermination. Pris au piège de l'ambiguïté de la solution finale, les tribunaux belges ont fait l'impasse sur la complicité des responsables de cette déportation dans l'"anéantissement" des déportés juifs. L'épilogue judiciaire belge de l'événement a ignoré, dans l'immédiat après-guerre, la participation criminelle à "la déportation et l'anéantissement de millions de Juifs".
Il a fallu près d'un demi-siècle pour qu'une juridiction belge ait enfin à connaître de ce crime dans ces termes historiquement corrects. C'est au début des années 1990 que l'agression "révisionniste" et ses injures à la mémoire collective ont imposé à la Belgique judiciaire de se prononcer à ce propos. Dans ce troisième rendez-vous du palais avec le génocide juif, les magistrats en traitent au chapitre de "la lutte contre le racisme et la xénophobie". Le "révisionnisme" en relève par le biais de ses provocations. antisémites. Il faudra ici apprécier la nature exacte du phénomène, son rapport avec le passé et son présent. Plutôt que d'y lire un symptôme d'une "nouvelle judéophobie", la pression insistante d'une opinion inquiète porte à en faire une lecture passéiste d'"apologie des crimes de guerre". En l'occurrence, ce retour aux concepts juridiques de l'après-1945 reconduirait le palais de justice à son rendez-vous manqué.
Ce débat juridique des années 1990 autour des tentatives d'annuler, dans la mémoire contemporaine, l'événement juif de la seconde guerre mondiale gagnerait à s'instruire du débat belgo-allemand du temps de l'occupation nazie. Quelles qu'aient été alors les tergiversations des autorités belges, elles se sont référées aux principes juridiques de l'Etat de droit. Foncièrement, ils sont incompatibles avec l'antisémitisme, sous quelque forme qu'il se présente. Qu'il prenne le masque du "révisionnisme" assassin de la mémoire ou, un demi-siècle avant, celui brutal et meurtrier du nazisme antijuif, il est une insulte à l'esprit des lois.
C'est de ce point de vue juridique qu'on considérera ici le premier temps fort des rendez-vous avec l'antisémitisme pendant ce demi-siècle. D'importation à l'époque, il butait sur les "scrupules nés du respect de la Constitution " des autorités nationales.
L'occupant n'ignorait pas combien la greffe d'un antisémitisme d'Etat en Belgique constituait une subversion fondamentale de l'Etat de droit. Ses directives pour l'administration du pays l'avaient averti du risque politique d'y "entamer la question des races, cela pourrait faire conclure à des intentions d'annexion"[3]. Introduites après six mois d'expectative, le 28 octobre 1940, ses premières ordonnances "contre les Juifs" - comme elles s'intitulaient - étaient "en opposition avec les principes de notre droit constitutionnel et de nos lois"[4]. Il revint aux porte-parole de la magistrature dans la capitale de le lui rappeler. Dans ce propos, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et les Premier Président et Procureur Général de la Cour de Cassation s'abstinrent toutefois "scrupuleusement" de discuter des "principes qui sont à la base des Institutions du Reich". A Londres, le gouvernement belge ne s'engagea pas non plus dans cette vaine discussion. Les "diverses mesures" prises dans le pays occupé imposaient de dénoncer en janvier 1941 les "atteintes à la souveraineté de l'Etat belge" sous cette "occupation réalisée par la force au mépris du droit des gens"[5]. Londres visait entre autres des dispositions de l'occupant "contraires au principe constitutionnel d'égalité de tous les Belges devant la loi, sans distinction de croyance, de race ou de langue".
Le rappel des "principes d'ordre juridique et social qui sont à la base de la vie nationale" y introduisait explicitement le rejet de toute discrimination fondée sur "la race". Le concept juridique ne figurait cependant pas dans le droit belge. La guerre de 1939 n'avait pas alors laissé le temps au législateur belge de suivre l'exemple de la France , en matière d'antiracisme. La France des droits de l'homme et du citoyen dont on célébrait justement le cent cinquantième anniversaire venait d'instaurer le délit d'injure ou de diffamation raciale. Le décret Marchandeau du 21 avril 1939 punissait toute attaque contre "un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée, lorsqu'elle aura pour but d'exciter la haine entre citoyens ou habitants". Par un effet pervers de miroir, cette législation antiraciste avalisait le discours sur la "race" qu'elle prétendait combattre par la loi. C'est le travers paradoxal de la législation antiraciste d'acclimater, inconsciente de cette corruption, le mythe idéologique d'appartenance d'une personne "à une race" autre qu'humaine. Pour frapper de nullité légale les actes d'inspiration raciste accomplis en Belgique occupée, le gouvernement belge de Londres a, à son tour, introduit le concept racial dans l'arrêté-loi du 10 janvier 1941 publié dans le Moniteur belge londonien . Il en sera de même quarante ans après avec la loi Moureaux contre "le racisme ou la xénophobie": son article 1er qualifiera "en raison de [la] race" les pratiques décrétées illégales.
Cette race à laquelle les légistes se réfèrent est un concept juridique absurde au plein sens du terme. Même les légistes nazis, adeptes du racisme, ne purent articuler ses fantasmes. Dans le Reich hitlérien, les fonctionnaires du ministère de l'intérieur trébuchèrent, dès 1935, sur son absurdité juridique,. Il leur incombait, en novembre, de rédiger les arrêtés d'exécution de la toute récente "loi" de Nuremberg "pour la protection du sang et de l'honneur allemand". Aucun critère "biologique" n'était opératoire dans le dispositif administratif et réglementaire indispensable pour identifier par la "race" ce Juif "non-aryen" exclu désormais des droits de la citoyenneté. Il fallut se résoudre à un biais non racial. L'appartenance "au culte juif" vint combler le vide juridique de la "race juive". L'administration nazie en Belgique occupée fut tout aussi pragmatique. L'idéologie raciste lui commandait, dans sa première ordonnance antijuive, de définir le Juif par son ascendance biologique ... de "race juive". C'est la filiation avec les grands-parents qui introduisit le lien biologique. La définition demeurait vicieuse. Elle portait qu'"est jui[ve] toute personne issue d'au moins trois grands-parents de race juive". L'idéologie sauvegardée, la "race juive" du grand-parent prenait consistance avec la preuve de son adhésion au "culte juif". La disposition permettait, selon l'administration militaire, de "constater plus facilement la qualité de Juif, d'empêcher les Juifs d'éluder la loi et de rendre plus difficiles aux autorités belges d'éventuels manquements à leurs devoirs". En l'occurrence, elle imposait au pays occupé dont il incombait de respecter les lois et la constitution une discrimination basée sur la religion, tout au moins dans l'ascendance parentale des personnes. Absurde dans son principe, le concept racial corrigé par la religion débouchait sur une incohérence juridique. Un Juif converti à la religion catholique restait de "race juive" s'il était prouvé que trois de ses grands-parents avaient adhéré à la religion juive. Il perdait sa qualification "juive" s'ils appartenaient à une autre religion pour autant qu'il n'eût pas lui-même rallié celle des Juifs.
Pour démêler cet imbroglio juridique, il fallut établir un Bureau des Etudes Généalogiques et Raciques qui délivrait des certificats d'aryanité. Instance belge, il ne relevait pas d'un Commissariat Royal aux Questions juives. Le projet existait dans les cartons de services allemands impliqués dans la question juive. Des raisons d'opportunité politique écartèrent cette tentative de greffer une instance raciste d'Ordre nouveau sur l'appareil d'Etat belge. Les contestations de judéité raciale furent en conséquence traitées dans un service auxiliaire de la police de sécurité allemande, et non devant les tribunaux belges. Il en fut autrement en France où les magistrats furent les premiers à se "salir les mains"[6]. Engagé dès l'invasion allemande dans une autre "Révolution nationale", l'"État français" du Maréchal Pétain s'était empressé, en août 1940, d'écarter l'obstacle du décret Marchandeau. L'abrogation de la législation antiraciste de 1939 ouvrit symboliquement la voie à l'antisémitisme d'Etat inscrit au programme du gouvernement du Maréchal. Il était de facture française et, devant la concurrence allemande, farouchement jaloux de ses prérogatives nationales. En l'absence de sollicitations du côté allemand, c'est Vichy qui prit les devants au début de l'automne 1940 et qui instaura un statut français de discrimination et d'exclusion des personnes de "race juive". L'initiative précipita la décision allemande de poser enfin cette "question juive" si embarrassante dans les territoires occupés de l'Ouest et d'en conserver la maîtrise.
Relevant de la seule législation de la puissance occupante, le concept de race n'en fit pas moins une timide intrusion dans le texte légal belge. Au printemps 1942, le Moniteur belge des arrêtés ministériels et autres arrêtés des secrétaires généraux publia les statuts d'une Association des Juifs en Belgique créée sur ordre allemand. L'administration d'occupation tint, pour des raisons d'efficacité, à la faire apparaître comme une institution de droit belge, même de "droit public". Pour ce camouflage, on se rabattit, à défaut d'autre solution, sur le statut inconfortable d'association sans but lucratif. L'institution légale des Juifs en Belgique n'était cependant pas une association volontaire, mais une communauté forcée, un ghetto administratif auquel une ordonnance allemande imposait l'adhésion obligatoire[7]. C'est pour définir ses membres que les statuts se référaient explicitement à la première ordonnance antijuive et raciste de l'autorité militaire d'occupation. Cette référence dans le Moniteur belge déchaîna la jubilation des militants belges du racisme antijuif. La Ligue pour la Sauvegarde de la Race et du Sol s'empressa d'acter le "fait réjouissant que pour la première dans l'histoire "belge" un décret paraît dans le Moniteur basé sur le principe de la race"[8]. Dans la résistance, La Libre Belgique stigmatisa la complaisance du secrétaire général du Ministère de l'Intérieur responsable de cette publication belge sur simple "communication" allemande. Le journal patriotique dénonçait le "traître". Homme d'Ordre nouveau promu à ce poste, il s'était permis, "sans que les autres secrétaires généraux s'y opposent, de faire descendre définitivement notre Moniteur officiel - déjà bien bas - au niveau de la presse asservie [...] entièrement à la dévotion de l'occupant".
Les "scrupules nés du respect de la Constitution " n'étaient aucunement un obstacle incontournable. Les "principes" du "droit constitutionnel" et des "lois" belges ne constituèrent pas un rempart juridique contre la discrimination des personnes en raison de leur appartenance à la "race juive" et de leur adhésion au "culte juif". Jamais, les tribunaux belges, gardiens de la loi et du droit, ne furent au centre d'un conflit de légalité avec les ordonnances allemandes. Personne ne les invita à prendre la protection des Juifs atteints dans leurs droits, leurs biens et leurs libertés individuels en violation de la légalité du pays occupé. Ni les magistrats, ni les parties lésées n'ont songé à une guérilla judiciaire. Tout au plus, à l'occasion et par exception, une procédure judiciaire sanctionna l'un ou l'autre ressortissant belge pour ses forfaits antisémites. Dès l'invasion, à l'approche des Allemands, des militants du racisme antijuif se crurent la voie libre pour passer à l'acte. A Anvers, encore en mai 1940, ils placardèrent des affiches injurieuses et brisèrent des vitrines de magasins juifs[9]. La police communale leur dressa procès-verbal. Mais l'affaire n'eut pas de suite au parquet d'Anvers. A Bruxelles par contre, en 1941, le tribunal de 1ère instance de Bruxelles sanctionna 8 trublions d'Ordre nouveau. Membres de la milice rexiste, ils s'étaient attaqués aux marchands ambulants de la place Bara, à la gare du Midi, le 4 octobre 1940. un vendredi, jour du nouvel an israélite. A l'époque, le bulletin de victoire du Pays Réel s'était félicité de ce que "des boutiques furent prises d'assaut, saccagées et leur camelote éparpillée". Le journal d'extrême droite avait toutefois omis de signaler les procès-verbaux que des policiers bruxellois présents sur les lieux rédigèrent à leur charge. En cette circonstance, les magistrats de la capitale ne poursuivaient cependant pas une bataille d'arrière-garde judiciaire dans la question juive.
A l'automne 1940, après les premières ordonnances antijuives, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, le Président et le Procureur général de la Cour de Cassation n'étaient pas intervenus dans un esprit de rupture avec l'occupant. Ils avaient au contraire exprimé leur "vif désir de continuer à aplanir toute difficulté par la voie de la conciliation". Ils protestaient de leur bonne volonté. " La Justice belge s'est acquittée jusqu'ici", dirent-ils, "d'une tâche difficile et délicate pour le plus grand bien du pays sans aucun conflit avec l'occupant". Aussi, sollicitaient-ils un entretien avec l'autorité allemande pour l'"éclairer complètement sur la portée de la Constitution et des lois belges et sur les questions importantes que soulèvent [ses ...] ordonnances" antijuives. Leur lettre se limitait pourtant à un seul point. Elle manifestait l'émotion du "monde judiciaire", du moins celui de la seule capitale, devant l'interdit professionnel frappant ... les avocats juifs. Ces "protestations" - l'administration allemande interpréta en ce sens la lettre - agacèrent l'occupant. "Ils n'ont pas la moindre idée de ce que nous avons été encore beaucoup trop doux", nota une main allemande autorisée sur la lettre des magistrats bruxellois. Éconduit, le Bâtonnier de l'Ordre directement impliqué dans l'élimination de ses collègues juifs, durcit le ton. Il opposa au refus de l'occupant de l'entendre "un devoir de conscience qu'aucune considération ne peut modifier, celui de dire que le principe même de [son] ordonnance est en opposition directe avec le Droit". En conséquence, le Conseil de l'Ordre décida de ne plus publier le tableau des avocats pour n'avoir pas à en radier les collègues juifs interdits.
La presse la plus radicale de la collaboration dénonça publiquement cette "résistance passive". Du point de vue de la résistance, ce n'était pourtant qu'une "politique d'autruche". Au dire de La Voix des Belges, important journal clandestin, elle "avait été sévèrement critiquée dans les milieux loyalistes du Palais". Ils reprochaient aux autorités de l'Ordre d'avoir cherché son salut dans le silence. N'osant ni consacrer l'inconstitutionnalité d'une mesure inique en omettant du tableau les confrères frappés, ni surtout protester ouvertement en les y maintenant, le conseil s'était diplomatiquement résigné à ne point publier le tableau", selon le journal patriotique. Du côté des avocats interdits, personne n'osa non plus accomplir le geste qui aurait contraint le Conseil de l'Ordre à franchir un autre pas dans la protestation du droit contre l'ordonnance antijuive. La chose se fit à Anvers, dans un tout autre contexte. Une avocate rétive à l'injonction allemande se rebiffa et plaida sa cause devant le conseil de discipline. A Anvers, l'Ordre des avocats avait radié ses collègues - si le mot convient - juifs. La Juive rebelle lui contesta ce droit puisqu'elle n'avait en aucune façon failli aux règles d'honneur et de délicatesse dans l'exercice de la profession. Ce fut en vain. La pression de l'Ordre nouveau sur l'Ordre des Avocats n'était pas négligeable, à Anvers. Entre autres, le chef de la Ligue pour la Sauvegarde de la Race et du Sol appartenait au barreau anversois. A Bruxelles, un barreau bien moins complaisant, n'empêcha pas l'occupant de parvenir au résultat escompté. Dans ce cas d'espèce, les "principes" du "droit constitutionnel" et des "lois" belges ont seulement servi d'échappatoire pour ne pas se "salir les mains".
Dans cette "question juive" dont il préparait, pas à pas, la "solution finale" dans le territoire occupé, le pouvoir allemand sut, avec un sens aigu de l'opportunité, louvoyer entre les "scrupules" constitutionnels des autorités belges. Dans cette matière des plus délicates, l'administration militaire manoeuvra pour convaincre ces autorités nationales que ses ordonnances antijuives étaient pour elles un moindre mal. Il les persuada qu'"il lui répugne d'avoir recours [à ce] procédé". L'autorité d'occupation aurait préféré, prétendit-elle, que les secrétaires généraux des ministères décrètent leur propre statut des Juifs. Une initiative belge en la matière n'était pas impensable. Il était conforme à l'esprit du temps d'assurer "la protection de la race et (la) réduction graduelle du nombre d'étrangers"[10]. Dans le désarroi des premières semaines de l'occupation, on l'avait inscrit, du côté belge, au programme d'un gouvernement fort à constituer sous l'égide du roi Léopold III. Cette dérive de l'Etat belge vers l'Ordre nouveau aurait conservé des garde-fou de l'ancien Régime "en respectant les commandements de l'humanité et en réprimant toute action non légale". Ce projet avorté, les milieux de la collaboration raisonnable persisteront à plaider pour "un antisémitisme d'Etat qui épargnerait les violences inutiles par un statut des Juifs, humain et équitable, statut préparatoire au départ des Juifs"[11]. Le problème juif est, de ce point de vue national belge, "un problème d'Etat et postule une solution légale". On découvrira même dans es ordonnances antijuives de l'occupant "un statut des Juifs [qui] n'implique aucune idée de persécution, de brutalité ou de traitement inhumain". De ce côté, on regretta la "carence" de "certaines autorités belges [qui] s'abriteraient derrière la Constitution"[12].
Ce fut, en effet, la réponse des secrétaires généraux des ministères à la sollicitation allemande. Le 11 octobre 1940, ils se retranchèrent derrière la Constitution et la convention internationale de La Haye pour ne pas "assumer la responsabilité des mesures envisagées à l'égard des Juifs". Cette fin de non-recevoir faisait néanmoins l'impasse sur le noyau incontournable de la manoeuvre allemande. La "répugnance" de l'occupant à légiférer contre les Juifs du pays était de façade. Ce qui lui importait, c'était d'assurer l'intendance d'une politique antijuive dont il céderait pas le contrôle. Lui ne disposait pas d'un personnel administratif et policier suffisant en nombre pour la mener à bonne fin. Le relais de l'appareil d'Etat belge et de ses services lui était indispensable.
Le collège des secrétaires généraux ne s'engagea pas dans cette politique d'exécution d'ordres allemands contraires aux lois et à la constitution du peuple belge sans s'entourer de garanties juridiques. Il consulta, à cette fin, le comité permanent de législation formé de juristes et de hauts magistrats. A son estime, les "mesures contre les Juifs" méconnaissaient les principes de base du droit de belge au point "que la participation à ces ordonnances excède manifestement le pouvoir légal des autorités administratives belges": "elle constituerait la violation de leur serment d'obéissance à la Constitution et le crime prévu" dans le code pénal. L'expertise juridique ne concluait pourtant au refus de "participer". C'est que "toute exécution donnée aux prescriptions des ordonnances n'est pas une "participation" à celles-ci". Ainsi, selon le conseil de législation, "celui à l'égard de qui ou contre qui une mesure est prise par l'autorité occupante et qui, sous la contrainte sur laquelle s'appuie cette autorité, accomplit l'acte matériel qu'elle lui impose, subit la mesure, il n'y participe pas". Pour illustrer cette conception de l'exécution passive, un juriste - ministre d'Etat et procureur général honoraire - recourut à la métaphore du billot. "La victime de la mesure en la subissant ne l'exécute pas", expliquait-il. "Le bourreau exécute l'arrêt de condamnation, il exécute l'arrêt, il exécute le condamné, celui-ci est exécuté et ne participe pas à l'exécution, même s'il place spontanément sa tête sur le billot". En l'occurrence, l'aval des juristes autorisait les secrétaires généraux à prêter sur ordre de l'occupant, comme le bourreau, le concours des administrations belges à la persécution de ses victimes juives.
Tardivement, à la veille des déportations dont on ignorait l'imminence, on s'aperçut du côté belge, du moins dans la capitale, qu'il y avait des limites dans l'"exécution passive" que même un bourreau ne pouvait franchir.
Ces limites furent atteintes avec l'ordonnance du 1er juin 1942 obligeant tous les Juifs du pays à porter l'étoile jaune. Contre toute attente, les bourgmestres bruxellois - et eux seuls - refusèrent de prêter leur "collaboration à son exécution"[13]. Ils dirent à l'autorité allemande qu'ils ne pouvaient se "résoudre à [s']associer à une prescription qui porte une atteinte aussi directe à la dignité de tout homme, quel qu'il soit". Toutefois, ils insistaient, dans leur refus de prêter les services communaux à la distribution des étoiles aux 30.000 Juifs de la capitale, sur l'argument factice qu'"un grand nombre [...] sont belges". Sans s'en apercevoir, la protestation humanitaire belge ouvrait une faille que l'occupant saurait exploiter dans la phase suivante bien plus cruciale pour la personne humaine. Le port obligatoire de l'étoile jaune annonçait le "prochain pas à accomplir". Mesure de surveillance policière, il consacrait l'isolement des Juifs avant leur "évacuation". Dans l'imminence de la solution finale arrivée à échéance, l'occupant, pris au dépourvu dans l'affaire de l'étoile, laissa passer la rébellion des bourgmestres bruxellois. Cette insoumission nouvelle d'autorités belges dans la question juive lui indiquait jusqu'où l'action d'"évacuation" à venir ne pourrait aller trop loin au risque d'une crise politique dans le territoire occupé.
Avec un savoir-faire remarquable, l'administration allemande exploita l'attitude ambiguë des officiels belges à l'égard des Juifs du pays qui, dans leur masse - à 94% - n'étaient précisément pas leurs compatriotes. Certes, le principe constitutionnel n'autorisait pas les autorités belges à faire une différence dans la "protection accordée aux personnes et aux biens". La Constitution l'étendait "à tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique ", sauf les exceptions légales. En pratique, dans un repli xénophobe, les autorités belges abandonnèrent les Juifs étrangers à l'occupant. Après avoir négocié avec succès le cap difficile de la déportation, le pouvoir allemand acta avec satisfaction que "le "ministère de la justice", en particulier, son département des cultes compétent pour traiter des affaires concernant les ... Israélites, "et les autres institutions belges ont toujours déclaré qu'ils ne voulaient s'occuper que des Juifs de nationalité belge". D'emblée, pour neutraliser les autorités belges, l'administration allemande leur avait aménagé un espace de moindre mal dans la solution finale, en exceptant provisoirement de la déportation juive la toute petite minorité de leurs compatriotes. Avec cet atout belge, l'occupant réussit ici à retarder la crise redoutée d'une bonne année. Elle survint - encore que singulièrement amortie - en septembre 1943 après la rafle de moins d'un millier de Juifs belges et le départ de leur convoi. Le collège des secrétaires généraux se décida enfin à "élever une protestation contre des mesures qui méconnaissent à la fois les principes les plus sacrés du droit et le respect dû à la liberté humaine"[14]. Le champ d'action de ces "principes" était des plus étriqués. La protestation exprimait seulement "la pénible impression ressentie par les autorités et la population belge à l'occasion des mesures qui frappent certains de [leurs] compatriotes". Le nouveau secrétaire général du ministère de la justice méconnaissait, dans sa copie, le fait autrement massif de la déportation de 22.000 Juifs étrangers avant le départ du convoi "belge". Les "compatriotes" juifs des autorités nationales ne furent jamais qu'une infime minorité dans la population déportée: à peine 5% des 25.000 Juifs évacués au titre de la solution finale.
Se désintéressant de cette déportation massive, les autorités belges - y compris, en l'occurrence, les magistrats du parquet - furent d'autant plus discrètes sur la participation de leur police à la "rafle du 'Vel d'Hiv'" belge au cours de l'été 1942. Le Vélodrome d'Hiver à Paris avait servi à rassembler la plupart des 13.000 Juifs que la police française a arrêtés au cours de la grande rafle des 15 et 16 juillet 1942. Les rafles débutèrent un mois plus tard en Belgique, d'abord à Anvers où, comme à Paris, la police nazie pallia l'insuffisance de ses effectifs en se servant de la police communale. A deux reprises, dans la nuit du 15 au 16 et dans celle du 28 au 29 août, la police anversoise se prêta à l'arrestation de 2 à 3000 Juifs. Toutes proportions gardées, les policiers anversois firent au cours de ces deux nuits de rafle un score équivalent à celui de leurs collègues parisiennes. Mais, à la différence de la police de l'"État français", il n'y eut pas d'autres 'Vel d'Hiv' de la police belge. Dans la capitale, l'étoile jaune avait mis fin à la politique d'"exécution passive" dès la fin du printemps 1942. Dans ces conditions politiques nouvelles, les forces de police allemandes furent réduites à opérer avec leurs propres moyens le ratissage du quartier de la gare du midi, au cours de la razzia nocturne du 3 au 4 septembre 1942. Il n'y eut guère d'autres grandes rafles. Dès la fin de l'été 1942, les rescapés comprirent qu'ils se livraient à terme s'ils demeuraient à leur domicile légal.
Cette rupture avec la légalité, y compris la loi belge, face à la menace généralisée et anonyme de déportation, limita les ravages de la solution finale en Belgique occupée. Ils se chiffrent en fin de compte à 45% avec l'acheminement d'un total de 25.000 Juifs à Auschwitz. La plupart - 16.000 - furent assassinés dès leur arrivée, les autres étaient voués à la mort concentrationnaire. Guère plus d'un millier étaient encore en vie, à la fin de la guerre. Il n'y eut même aucun survivant d'un des 27 convois juifs partis du camp de rassemblement de Malines.
Ce convoi IV du 18 août 1942 est sans doute le plus typique de cette déportation raciale. Entièrement anéanti, il n'est pourtant pas, par sa formation, le plus caractéristique. Il a été constitué avec les victimes de la rafle anversoise du 15 août. Il donne rétrospectivement un sens terrible à la métaphore juridique du "billot" qui légitimait au début de la question juive la politique belge d'"exécution passive" des ordres allemands. La collaboration de policiers belges dans l'exercice de leur fonction à l'arrestation des Juifs à déporter au titre de la solution finale en a été la conséquence extrême. Les officiers de la police anversoise, sommés de procéder à ces arrestation dans leur ressort territorial, ne se conduisirent pas autrement que les autorités administratives dont ils relevaient. De même que la distribution des étoiles jaunes n'avaient pas été, à la fin du printemps 1942, un ordre inacceptable à Anvers, ces officiers de police firent, avec leur agents, le travail du "bourreau" accomplissant l'ordre allemand. Conformément à la loi belge, ils rendirent compte aux autorités concernées. Non sans embarras, ils justifièrent leur activité nocturne en invoquant l'état de nécessité dans les pro justitia adressés régulièrement au procureur du Roi d'Anvers. Ces arrestations pourtant arbitraires et contraires aux principes les plus élémentaires du droit belge ne provoquèrent pas la crise redoutée du côté allemand. Il n'y eut aucune protestation formelle des autorités belges, parquet compris, contre cette réquisition illégale des forces de police belges[15]. La seule mise en demeure faite à ce propos est de source allemande. Dans l'action d'"évacuation des Juifs", la police SS avait multiplié les "abus [....] contraires aux conventions antérieures" établies avec l'autorité militaire d'occupation[16]. Cette dernière inquiète de leurs "conséquences fâcheuses sur le plan politique" rappela à l'ordre la police SS et confirma ces remontrances dans un écrit en bonne et bue forme. Dans le même temps, le pouvoir militaire enjoignit formellement à ses services locaux de "s'abstenir de faire appel à la police belge"[17]. Il ne resta dès lors à la vingtaine de SS allemands en charge de la solution finale d'autres relais belges que les auxiliaires détachés des formations paramilitaires des mouvements d'ordre nouveau, principalement de la SS flamande.
De ces relais belges sans lesquels l'"ennemi" n'aurait pu accomplir son "oeuvre de mort", ce fut le seul que la commission des crimes de guerre auprès du ministère de la justice retint en fin de compte. Dans son rapport sur La persécution antisémitique en Belgique, elle dénonça l'aide apportée à l'occupant "par de très nombreux auxiliaires, prêts à tout pour assouvir leurs instincts les plus vils et leur cupidité éhontée"[18]. Sous ce regard tronqué, l'histoire était désormais criminalisée. La justice belge, convoquée à son deuxième rendez-vous avec cette "oeuvre de mort", allait lui appliquer des concepts juridiques inadéquats à son sens réel. Ils lui firent faire l'impasse de l'après-1945.
Constituée dès le 21 décembre 1944, cette commission d'enquête sur les violations des règles du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre et des devoirs de l'humanité prépara l'action répressive des cours militaires. Formée essentiellement de juristes, elle comportait aussi, à cette fin, un substitut de l'Auditeur général, ainsi que le secrétaire de la Commission Royale d'Histoire, dans le souci de "faire" également "travail d'historien". Son rapport sur la persécution antisémitique date de 1947. Il l'inscrivait au chapitre des "infractions au droit des gens".
Le "classement idéologique" de ces "infractions" distinguait la "persécution des Juifs" des autres infractions, entre autres des "déportations". L'énumération qui n'avait "aucun caractère limitatif", ne comportait néanmoins pas les exterminations. Celles-ci ne figuraient pas non plus dans l'autre catégorie des "crimes de droit commun" où la commission inscrivait notamment les "massacres par représailles", désignant par là des actes perpétrés sur le territoire belge. Avec ses deux volets d'"infractions au droit des gens" et de "crimes de droit commun", la notion belge de crime de guerre s'avérait d'emblée un concept juridique impropre à saisir l'événement juif de la seconde guerre mondiale.
Dans l'après 1945, il n'était pas mieux appréhendé avec le concept de "crimes contre l'humanité", fondement juridique de la Cour militaire internationale de Nuremberg. Le génocide juif n'a pas été inscrit dans les charges retenues contre les dirigeants de l'Allemagne nazie. Le statut de Nuremberg énumère un ensemble de "crimes contre l'humanité", mais non celui de génocide. Le concept juridique de Nuremberg englobe "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes populations civiles" ainsi que "les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux"[19]. La notion juridique couvre un large éventail des crimes de la période nazie sans pour autant qualifier les actes constitutifs d'un génocide. Ni des "déportations", ni des "exterminations" ne font un génocide et elles n'ont pas fait le génocide juif.
L'événement historique procède de "la grave décision" dont parlait pendant son exécution le chef des tueurs SS, "de faire disparaître ce peuple de la terre". La "décision" impliquait, pour son organisation, d'opérer la déportation génocidaire en un mouvement continu. Les déportés étaient systématiquement assassinés dès leur débarquement. Ils étaient déportés pour être exterminés. C'est cette continuité des déportations et des exterminations qui caractérise l'événement génocide dans son accomplissement. Élaborant le concept juridique en 1944, Raphaël Lemkin n'a considéré ce "cas" qu'à titre exceptionnel. "Dans son sens le plus général", écrit-il, "génocide ne signifie pas forcément liquidation immédiate d'une nation, sauf dans le cas où il s'accomplit par le massacre direct de tous ses membres". Aussi, le concept juridique a-t-il plutôt nommé une politique "visant à détruire les fondations de la vie des groupes nationaux, dans le dessein final d'annihiler les groupes eux-mêmes". Dans ce sens extensif, la convention de l'O.N.U. pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948 y a inscrit les "actes commis [...] dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux"[20].
Du "tout" à la "partie", le concept juridique glisse insensiblement de l'événement génocidaire à la spécificité de ses victimes. Il suffit qu'elles soient choisies en raison de leur identité "national[e], ethnique, racial[e] ou religieu[se]". A la limite, l'acte qui les prive de leur identité qualifie le génocide tout autant que leur assassinat. L'O.N.U. inscrit ainsi dans sa définition aussi bien le "transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe" que "le meurtre de membres du groupe".
Les SS d'Himmler, experts en la matière, avaient une conception bien plus restrictive du génocide juif. Dans ce cas d'espèce, les tueurs SS ne commettaient aucune confusion de sens. C'était "tout" le groupe dont le massacre était systématiquement poursuivi. Himmler ne concevait pas de lui prendre "tout ce qui est de bon sang"[21]. Le chef des SS l'envisageait chez d'autres peuples, entre autres les Slaves. Il était concevable, du point de vue raciste, de "leur vole[r] même leurs enfants". En revanche, il n'était admissible, du même point de vue, que des enfants juifs, même déjudaïsés, puissent vivre physiquement. Le sens de "la grave décision de faire disparaître ce peuple de la terre", c'est précisément de le priver d'avenir en exterminant les enfants. Le chef des SS ne se sentait pas, selon ses confidences livrées aux plus hauts dignitaires nazis, "le droit d'exterminer les hommes - dites si vous voulez, de les tuer ou de les faire tuer - et de laisser grandir les enfants qui se vengeraient sur nos enfants et nos descendants". Dans ce témoignage himmlérien d'époque, les massacres, fussent-ils de Juifs, ne suffisent pas encore à faire l'événement génocidaire dont il n'a jamais été si bien dit la nature singulière. Ce qui fait la différence du judéocide et qui signifie, dans la pratique meurtrière des SS, cette "grave décision", c'est, du point de vue de leur chef, la mise à mort préméditée et systématique des enfants juifs.
L'après-1945 découvrant toute l'ampleur du génocide ne pratiquera cette approche historique qui lui restitue sa singularité dans les atrocités nazies. Ce qu'on retiendra au moment de rendre justice, c'est, comme y insiste le rapport belge sur "la persécution antisémitique", "cette gigantesque entreprise criminelle"[22]. Enquêtant sur les faits, la commission des crimes de guerre n'a pu se limiter au juridisme des "infractions au droit des gens", ni même des "crimes de droit commun" commis sur le territoire belge. Le chapitre belge était l'"un des multiples aspects" de la "tragédie des Juifs d'Europe". Et, dans cette lecture, la commission découvrait même "un plan préalable et systématique", un "plan général d'anéantissement des Juifs". Il consistait "à rassembler et isoler les Juifs", puis "à les déporter". De cette déportation "dans des conditions inhumaines", insiste l document, le rapport retient qu'"arrivés à Auschwitz, [...] les femmes et les enfants, les vieillards, les faibles et les malades étaient isolés et immédiatement envoyés à Birkenau où se trouvaient les chambres à gaz et les crématoires. Des milliers de personnes furent ainsi dès leur arrivée, conduites à la mort dans des conditions atroces"[23].
La logique de cette lecture conduit la commission à déterminer la "responsabilité" des autorités allemandes d'occupation, tant les militaires que les policiers. Cette responsabilité est "engagée plus particulièrement en ce qui concerne la persécution antisémitique en Belgique", mais elle ne les dégage aucunement de toute implication dans "le plan général criminel". Au contraire, dit même le rapport, "c'est à eux qu'échut la tâche de mener à bien, sur un territoire déterminé, le plan général criminel des chefs suprêmes de leur pays"[24]. Le réquisitoire de la commission s'interroge toutefois sur l'opportunité "de doser les responsabilités". Il lui faut "répondre par la négative". Il ne lui est pas apparu, "bien au contraire", que quiconque, "à quelque degré de la hiérarchie qu'il ait appartenu" ait eu "le dessein d'adoucir les souffrances des victimes". "Il ressort au contraire, de l'analyse impartiale des faits [...] connus", souligne la commission, "que tous, initiateurs ou exécutants, dirigeants ou subordonnés, agents ou auxiliaires, sont également responsables, chacun pour sa part, des innombrables crimes dont furent les victimes innocentes les Juifs de Belgique"[25]. Mêmes les autorités militaires d'occupation n'échappent pas à cette responsabilité globale. "Ces hommes", souligne le rapport, "édicteront les ordonnances et donneront les instructions qui forment le cadre légal du mécanisme [...] d'anéantissement de la population juive". De surcroît, "c'est sous leur autorité que s'organisèrent et fonctionnèrent les multiples rouages de l'appareil policier, qui des caves de la Gestapo [...] ou aux charniers d'Auschwitz, broya tant de vies humaines".
La logique accusatrice de l'exposé laisse supposer que la commission des crimes de guerre recommande, en conclusion, que "les coupables soient justement punis des nombreux crimes qu'ils ont commis"[26]. Ce qu'elle fait en effet, mais en limitant singulièrement les chefs d'accusation. Elle ne dénonce pas "au gouvernement belge et aux gouvernements des Nations Unies" les responsables allemands de la persécution des Juifs de Belgique pour leur complicité dans l'exécution du "plan général criminel". Elle les dénonce seulement pour les "crimes suivants: déportation de civils, internement de civils dans des conditions inhumaines, confiscation de biens, arrestation en masse sans discrimination"[27].
Les procès "belges" de 1950/1951 feront ainsi l'impasse sur l'épilogue judiciaire du "plan criminel" du IIIe Reich contre les Juifs de Belgique. Dans ces procès, les charges "juives" pour le moins mitigées pèseront bien moins que d'autres chefs d'inculpation, telles les fusillades d'"otages terroristes". Les 300 victimes des ces "massacres par représailles" perpétrés en Belgique auront plus d'impact sur la condamnation des auteurs allemands que les 24.000 Juifs du pays disparus en déportation.
Occulté dans les procès "belges", le génocide des Juifs de Belgique connaîtra pourtant son épilogue judiciaire trente ans après en Allemagne fédérale. Tardivement il est vrai, les magistrats allemands reprendront la mauvaise copie de leurs collègues belges. Dans les années 1970-1980, trop lentement pour conclure par un procès dans ce cas, ils inculpèrent même l'un des officiers SS jugé en Belgique pour la déportation des Juifs, mais "uniquement du point de vue légal de la privation de liberté"[28]! Les charges allemandes furent autrement pesantes. Le chef d'inculpation fut rien de moins que la "complicité dans la mise à mort cruelle et perfide d'un grand nombre d'êtres humains pour avoir, dans la période d'août 1942 à juillet 1944, à divers moments et à des degrés divers, collaboré à la déportation de quelque 26.000 juifs [sic ...] vers le camp d'extermination d'Auschwitz"..
Ces "crimes nazis" du droit allemand ne sont pas plus des "crimes contre l'humanité" que dans le droit belge. Le procès "belge" en Allemagne n'a pas été, en 1981, un procès Barbie avant la lettre. A la différence du procès français de 1987, c'est le droit pénal ordinaire que les magistrats allemands ont appliqué au cas "belge". La cour d'Assises du Schleswig-Holstein rendit un verdict de culpabilité pour "avoir contribué au meurtre" des Juifs de Belgique en les déportant à Auschwitz[29]. Le jugement ne se fonde pas sur des preuves documentaires qui auraient inaccessibles à l'époque des procès "belges" pour répondre à la question cruciale de la connaissance du sens réel des déportations juives. La pièce d'archives nazies qui emporta la conviction figurait, à l'époque du procès de Nuremberg, dans le rapport français sur la persécution des Juifs à l'Ouest de l'Europe. Datant du printemps 1942, cette note de service dévoilait dans les déportations juives projetées à partir de l'Europe occidentale "une solution finale ayant pour but l'extermination totale de l'adversaire"[30]. Ni les magistrats français, ni leurs collègues belges ne s'y référèrent dans leurs réquisitoires et leurs verdicts. Aucune "juridiction belge" n'en avait eu besoin dans les procès pour crimes de guerre après 1945. En Belgique, aucune "personne" ne fut à l'époque "reconnue coupable" tout à la fois de la déportation et de l'anéantissement des Juifs.
Quarante ans après, le législateur n'envisage pas moins d'édifier avec les procès de l'après-1945 un rempart juridique contre le "révisionnisme" négateur du génocide juif. Les magistrats belges n'ont pourtant pas manqué ce troisième rendez-vous avec l'antisémitisme en dépit d'une législation répressive inappropriée. La loi Moureaux de 1981 ignore l'antisémitisme en tant que tel. Elle tend seulement "à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie". L'antisémitisme y est implicite comme une sous-catégorie du racisme moins essentielle cependant que la xénophobie élevée au rang de ce dernier. Ce faisant, la loi, en retrait des enjeux de son temps, ignore le fait nouveau du nouvel antisémitisme des années 1980[31].
Paradoxalement, ce sont pourtant des violences antisémites qui ont été à l'origine immédiate de cette législation contre "le racisme et la xénophobie". Il a "sans doute" fallu, confie l'auteur de la loi dix ans après, "les tragiques attentats de Paris, Munich et Anvers au début des années 1980" pour "vaincre des forces usant de toutes les arguties juridiques" au sein du Parlement[32]. Dans sa préface au bilan judiciaire d'une décennie de "lutte contre le racisme et la xénophobie", l'ancien ministre de la Justice rappelle encore que les premières propositions en cette matière datent des années 1960. La Belgique n'avait pas seulement dix ans de retard sur la France dotée d'une loi répressive en 1972. Elle avait laissé sans réponse les symptômes d'une renaissance de l'antisémitisme en Europe occidentale dès la fin des années 1950.
Ses soubresauts répétés ont tendu dans la longue durée à lui rendre un statut d'opinion dont les horreurs nazies de la seconde guerre mondiale l'avaient privé. Dès ces années 1950, l'extrême droite la plus extrême s'insurgeait contre ce "curieux épouvantail que dressent de temps en temps nos dirigeants pour effrayer les bien-pensants". La Phalange française découvrait dans l'accusation d'antisémitisme "la pierre angulaire de toute une propagande qui a pour mission de nous abattre"[33]. La crise des sociétés occidentales dans les années 1970 a permis d'attaquer l'obstacle. Comme dans les années 1930, la vague de racisme et de xénophobie qui déferle depuis a balisé le terrain pour le tournant des années 1980. Le retour en force de l'antisémitisme marque cette dernière décennie. Elle débute avec l'attentat à l'explosif à la synagogue de la rue Copernic à Paris le 3 octobre 1980. Elle s'achève avec la violence symbolique des profanations du cimetière israélite de Carpentras, le 10 mai 1990, exactement cinquante ans après l'invasion allemande de l'Europe occidentale. Loin d'être dissuasifs, ces accès de violence s'accompagnent d'une réhabilitation de l'antisémitisme d'opinion. Dès 1987, il cessait d'être ... honteux et retrouvait la légitimité d'un discours politiquement acceptable dans les médias.
Cette "nouvelle judéophobie" s'est articulée à partir des retombées des crises du Moyen-Orient[34]. Sous couvert d'antisionisme, elle avait travaillé les esprits pendant les décennies précédentes. Le "révisionnisme" s'y est ancré pour réduire les chambres à gaz du génocide juif à un "mensonge historique" et à une "gigantesque escroquerie politico-financière"[35]. "Les principaux bénéficiaires [en étaient] l'Etat d'Israël et le sionisme international". Avec ce discours antisioniste, le négationnisme se défendait d'être "antisémite"[36]. Il recherchait "la vérité [qui ...] ne saurait pas être antisémite", prétendait-il dans sa percée médiatique. Longtemps confidentiel, il sortit des catacombes de l'extrême droite groupusculaire à la toute fin des années 1970. Se targuant de constituer une "école historique", il a pu un moment faire illusion. Mais, il est vite apparu pour ce qu'il était. Comme l'a aperçu un tribunal belge en 1991, l'entreprise négationnistes a permis "avec une légèreté insigne, mais avec une conscience claire, de laisser prendre en charge, par autrui son discours dans une intervention d'apologie des crimes de guerre ou d'incitation à la haine raciale"[37].
C'est l'extrême droite qui disqualifia ce discours à prétention scientifique. Pour l'avoir couvé au temps où elle-même était confidentielle, elle fit mine, en toute candeur, de découvrir ce "révisionnisme" au cours de son avancée électorale dans les années 1980. Elle se posait à son tour "un certain nombre de questions" et récusait toute "vérité révélée" au nom de la "liberté de l'esprit"[38]. Elle était bien sûr "hostile à toutes les formes d'interdictions et de réglementation de la pensée". Ce discours respectable l'autorisait, dans un premier temps, à banaliser tout au moins l'antisémitisme génocidaire. Il s'agissait de le vider de toute singularité historique. Il n'était pas seulement un "point de détail" de l'histoire de la seconde guerre mondiale.
La banalisation fut plus subtile. D'une pierre, l'opération fit deux coups. Elle ravalait l'événement singulier de la seconde guerre mondiale au rang de "détail" d'un "détail". Le "point" englobait les "camps de concentration où moururent par million, juifs, tsiganes, chrétiens et patriotes de toute l'Europe et les méthodes employées pour les mettre à mort : pendaisons, fusillades, piqûres, chambres à gaz, traitements inhumains, privations"[39]. Ce discours réducteur du génocide juif renvoyait le public à sa propre représentation tronquée. La mémoire historique du temps présent pratique en permanence l'amalgame symbolique du "camp de concentration et d'extermination" et la confusion mythique du génocide avec la mort concentrationnaire[40]. Le "point de détail" se joua de cet embrouillement des notions d'histoire[41] pour tenter, à sa manière, de faire "passer un passé qui ne veut pas passer"[42] dans la France du "syndrome de Vichy"[43].
Cette banalisation du génocide juif inscrite dans l'air du temps est le passage obligé d'une entreprise plus du tout banale. Elle débordait l'hexagone français. Même en Belgique, l'extrême droite la plus radicale et ses nostalgiques du national-socialisme, néo-nazis et chevaux de retour fraternellement unis, s'extasièrent de leur vertu retrouvée.
Les magistrats belges avaient été confrontés - juste avant l'adoption de la loi Moureaux - à une autre protestation contre "la haine, l'intolérance et le fanatisme" dont les adeptes non allemands du nazisme auraient enduré "l'aveuglement et la bêtise" pendant les ... "années 1945- 1950" [47]. En 1979, des fidèles rexistes s'étaient cru autorisés à diffuser en Belgique un écrit "révisionniste" de leur chef historique. Il tombait sous le coup de la loi. Léon Degrelle condamné à mort par contumace et toujours réfugié en Espagne, était interdit de toute activité politique en Belgique. Sa Lettre au Pape - sur le point d'aller prier à Auschwitz - reprenait les arguments du négationnisme "révisionniste". Comme le notèrent les magistrats belges, l'ancien officier belge de la Waffen SS tentait de justifier par ce biais "les crimes politiques pour lesquels il fut condamné et déchu" . Il s'essayait à "convaincre l'opinion de ce que le régime nazi auquel il avait voué sa vie, a été calomnié lorsqu'il a été accusé d'avoir assassiné des millions d'individus pour la raison unique de leur race"[48].
Dix ans plus tard, pour faire passer ce "révisionnisme", ce fut le jeune nazi franco-belge qui multiplia les provocations. Il lui fallait une tribune, fut-ce devant un tribunal. En vain, il avait tenté de le fourguer à l'Université. Sa manoeuvre, préparée par publipostage, visait celle du Libre-Examen, à Bruxelles. Par usurpation, il tenta même de prendre pied sur le campus. La réplique fut cinglante. L'U.L.B. n'acceptait pas "que sous couvert du libre examen et de la tolérance qu'elle pratique, des individus puissent se faire impunément les propagandistes du racisme et d'idées susceptibles de ruiner les valeurs humanistes et démocratiques dont elle se réclame"[49]. Les historiens de cette Université, faisant leur "boulot", avaient, pour leur part, refusé aux productions d'"histoire exécrable" de la prétendue "école révisionniste" la reconnaissance scientifique escomptée[50]. Réduit à chercher sa tribune dans le prétoire, le négationnisme faillit l'obtenir ... à cause de la Communauté juive. Comme en France, elle fut tentée de céder à la provocation. Partie civile, elle jugea qu'un "procès" dans une telle affaire ne serait "rien [de] moins qu'une des composantes de la préservation de la Mémoire , de notre Mémoire collective"[51]. Ce procès pouvait "conditionner - entre autres - ce que sera, ou ne sera pas, l'antisémitisme de demain, dans ce pays". La partie civile s'attendait à la venue des "gros bras" du "révisionnisme" français et elle s'apprêtait à relever le défi, sur leur propre terrain. Dans cet égarement, elle avait pensé leur "oppos[er] la réalité historique". Elle faillit même présenter "à la Justice tous les éléments nécessaires pour que cette réalité historique soit juridiquement reconnue de sorte que le jugement qui interviendra puisse faire jurisprudence et venir étayer la loi existante du 30 juillet 1981 en ce qui concerne les actes de racisme et d'antisémitisme" .
Le procès - et les magistrats y contribuèrent sagement - évita tout dérapage. La loi Moureaux, inspirée du modèle français de 1972, ne crée "guère de difficultés" aux tribunaux pour "condamner les auteurs de thèses "révisionnistes" sur cette base"[52]. Même si elle ne définit pas l'injure antisémite, elle "établit", estiment les magistrats, "l'infraction d'incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou de leur origine nationale ou ethnique en des termes suffisamment larges". S'en tenant exclusivement à l'enjeu juridique, "le tribunal qui ne se reconnaît ni la qualité, ni la compétence de juger de l'histoire" ne fut pas dupe de "propos, procédant par un amalgame d'idées qui relèvent plus du discours politique que de la recherche scientifique"[53]. Certes, le jugement diagnostiquait très précisément "l'intention [...] de réhabiliter les auteurs des théories racistes qui sont à l'origine de la déportation et de l'anéantissement de millions de Juifs". Mais, pas plus qu'il n'incombait à la justice de se prononcer en matière de vérité historique, il ne lui appartenait de sanctionner "la liberté d'expression" qu'en cas d'"appels à la haine et à la discrimination" et "à la violence contre la communauté juive" en l'occurrence. Ce que le tribunal bruxellois fit, en la circonstance, avec une particulière sévérité. Sous la plume de son chroniqueur judiciaire, un grand quotidien de la capitale titra sur "la lourde condamnation" du "révisionniste"[54]. Le compte rendu de ce "jugement courageux" se félicitait que "racisme et calomnie ne passent plus au bleu".
Dans ce cas d'espèce d'une facture délibérément nazie, le prétendu "révisionnisme" s'était révélé sans la moindre ambiguïté. L'arrêt belge n'eut aucune peine à y lire une entreprise idéologique et politique visant à "provoquer des réactions passionnelles d'agressivité" contre "la communauté juive"[55]. Coulée en des termes compatibles avec la loi Moureaux, cette qualification caractérise la démarche ordinaire de l'antisémitisme dans l'histoire comme dans le présent. Habitué des prétoires des années 1990, le chroniqueur judiciaire conclut que la "loi de 1981 [...] réprime les actes inspirés par le racisme, l'antisémitisme ou la xénophobie" [56]. En fait, la loi Moureaux autrement intitulée n'avait pas pris en compte "la nouvelle judéophobie" des années 1970-1980. La législation française qui l'inspirait, plus ancienne, avait précédé en 1972 les développements les plus caractéristiques du phénomène nouveau.
Le "révisionnisme" négateur du génocide juif n'en a été qu'un des symptômes. Son passéisme apparent a pu faire illusion à une mémoire collective scandalisée et outragée. Elle y a lu - et elle n'avait pas tort sur ce point - une tentative de "blanchir" le IIIe Reich et de le "laver de ses crimes" en l'innocentant de ses crimes contre l'humanité afin de le "banaliser". Le rapport au passé ne dit cependant pas tout du ressort "révisionniste". L'articulation antisioniste de son discours en révèle le "sens politique". En faisant passer ses thèses négationnistes, il assure une "victoire idéologique absolue des ennemis des Juifs, par-delà celle des ennemis d'Israël"[57]. Instrument de cette nouvelle judéophobie particulièrement adapté au temps présent et à son imaginaire collectif, le "révisionnisme" ne saurait être dissocié des manifestations plus traditionnelles de l'antisémitisme. Non pas qu'il les autorise, comme on a pu l'imaginer sous le choc des 34 tombes profanées au cimetière israélite de Carpentras, en 1990.
Le public bouleversé y a vu les retombées de "l'action de l'extrême droite" dans la société française et de "l'oubli de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre"[58]. Les profanations de cimetières israélites n'avaient pourtant rien de nouveau. Les tombes israélites étaient tout autant renversées dans les années 1970. En ce temps, l'extrême droite et le révisionnisme encore confidentiels n'exerçaient pas cette influence "en profondeur" que le désarroi de l'opinion leur impute après la décennie suivante[59]. L'effet Carpentras n'en a pas moins eu un résultat pervers. Sous le choc, le législateur français se fit un devoir de contrer le "révisionnisme" par le recours à la loi. Il passa outre les mises en garde les plus autorisées d'historiens nullement complaisants. Il déclara "illégales" les prétendues "thèses révisionnistes" des négateurs du génocide et "non pas scandaleusement erronées"[60]. Leurs auteurs pouvaient enfin quitter "le coin où les historiens faisant bien leur métier, sont capables de les reléguer avec un bonnet d'âne"[61]. La loi Gayssot du 13 juillet 1990 les convoquait devant les magistrats pour contestation d'un crime contre l'humanité ayant entraîné des condamnations de ce chef par le Tribunal militaire international de Nuremberg ou une juridiction française.
A son tour, la Belgique , secouée par la percée de ses extrêmes droites aux élections législatives de novembre 1991, a envisagé, dès la session parlementaire, d'adopter également une "loi tendant à réprimer la contestation, la remise en cause et la négation ou l'apologie des crimes de guerre"[62]. Dix ans après la loi Moureaux sur "le racisme ou la xénophobie" - votée dans la hâte -, le parlementaire découvrait une spécificité à "l'antisémitisme". Il s'apercevait tardivement que "l'exclusion et la haine, le racisme et l'antisémitisme prennent une place de plus en plus inquiétante dans notre espace public". Dans ce constat attardé, la xénophobie perdait son privilège légal de 1981. L'analyse - passéiste dans son inspiration - s'obnubilait sur la "résurgence de la barbarie" parmi les "menaces qui guettent notre démocratie".
La décennie 1990 débutait pourtant avec une autre histoire, même à l'extrême droite, miroir caricatural des représentations du temps présent. Tout comme l'antisémitisme s'y était précédemment converti en un antisionisme de bon aloi, son racisme avait lui aussi mué dans les dernières décennies. Il n'était plus "biologique" à la manière par trop gâchée du précédent nazi. L'extrême droite ne pratiquait guère plus la "discrimination", "la haine" , la "violence à l'égard d'une personne en raison de sa race" comme le définissait la loi Moureaux. Ce racisme s'était mis à l'air du temps. Nationaliste, il s'est voulu culturaliste, différentialiste, ethnocentriste, en un mot xénophobe. La "purification ethnique" et le déchaînement des violences xénophobes en Europe ne sont pas des "résurgences" du passé. Ils sont les innovations barbares du temps présent. On se trompe d'histoire en croyant qu'elle se répète. On se trompe sur le passé comme on se trompe sur le présent et, dans l'erreur, on risque, comme souvent, de manquer le rendez-vous avec l'histoire.
Maxime Steinberg a évoqué cet aspect dans l'article suivant :
M. STEINBERG, "Le génocide aux rendez-vous du palais", in Justice et Barbarie 1940-1944, in Juger, n° 6-7, 1994.
Table de matières
- Les trois rendez-vous du palais
- Les "scrupules constitutionnels"
- La "voie de la conciliation"
- Les limites du "bourreau"
- L'impasse de l'après-1945
- Le temps du nouvel antisémitisme
- Le rendez-vous judiciaire du "révisionnisme"
Les trois rendez-vous du palais
Il est, en histoire, des rendez-vous manqués. Ses acteurs vivent l'instant présent en ignorant le sens réel de son accomplissement. "On ne savait pas", disent-ils après coup. Cet hiatus dans la conscience historique est typique de l'histoire du génocide juif ou, pour mieux dire, de la "solution finale". La formule du discours nazi d'époque dit bien l'ambiguïté de l'événement. Il comporte tout à la fois la déportation des Juifs et leur extermination; d'une part, leur évacuation d'un territoire au vu et au su de ses populations, et d'autre part, dans le secret de ses centres d'extermination, l'assassinat systématique des "évacués" dès leur débarquement. Ce secret et ses conventions de langage codées ont posé, après coup, la question la plus épineuse aux magistrats chargés d'instruire les procès des responsables des déportations juives. Cette difficulté inhérente aux retombées judiciaires du génocide juif n'explique pourtant pas que, pour leur part, les magistrats belges aient raté ce rendez-vous avec l'histoire à peine accomplie.
Durant son accomplissement, dans un pays où l'appareil d'Etat ne s'était pas rallié à l'Ordre nouveau, le Palais de Justice était resté à l'écart du dispositif antijuif importé par l'occupant. Au cours de ce premier rendez-vous avec l'histoire, les autorités judiciaires belges n'eurent guère à "se salir les mains" dans la "question juive". C'est l'occupant qui s'appliquait à la résoudre après l'avoir posée. Leur incompétence juridique sauvegardée dans cette matière scabreuse, elles ont pourtant infléchi son cours en laissant - selon une métaphore juridique d'époque - les administrations belges prendre part à l'oeuvre du "bourreau".
Après coup, dans l'après-1945, il apparut aux juristes chargés d'enquêter sur les "crimes de guerre" que l'occupant avait accompli une "oeuvre de mort" avec la déportation des Juifs. Ils lui appliquèrent une grille de lecture juridique inadéquate. Elle s'attachait aux "crimes de droit commun" perpétrés sur place. Le modèle dissociait la déportation de l'extermination. Pris au piège de l'ambiguïté de la solution finale, les tribunaux belges ont fait l'impasse sur la complicité des responsables de cette déportation dans l'"anéantissement" des déportés juifs. L'épilogue judiciaire belge de l'événement a ignoré, dans l'immédiat après-guerre, la participation criminelle à "la déportation et l'anéantissement de millions de Juifs".
Il a fallu près d'un demi-siècle pour qu'une juridiction belge ait enfin à connaître de ce crime dans ces termes historiquement corrects. C'est au début des années 1990 que l'agression "révisionniste" et ses injures à la mémoire collective ont imposé à la Belgique judiciaire de se prononcer à ce propos. Dans ce troisième rendez-vous du palais avec le génocide juif, les magistrats en traitent au chapitre de "la lutte contre le racisme et la xénophobie". Le "révisionnisme" en relève par le biais de ses provocations. antisémites. Il faudra ici apprécier la nature exacte du phénomène, son rapport avec le passé et son présent. Plutôt que d'y lire un symptôme d'une "nouvelle judéophobie", la pression insistante d'une opinion inquiète porte à en faire une lecture passéiste d'"apologie des crimes de guerre". En l'occurrence, ce retour aux concepts juridiques de l'après-1945 reconduirait le palais de justice à son rendez-vous manqué.
Ce débat juridique des années 1990 autour des tentatives d'annuler, dans la mémoire contemporaine, l'événement juif de la seconde guerre mondiale gagnerait à s'instruire du débat belgo-allemand du temps de l'occupation nazie. Quelles qu'aient été alors les tergiversations des autorités belges, elles se sont référées aux principes juridiques de l'Etat de droit. Foncièrement, ils sont incompatibles avec l'antisémitisme, sous quelque forme qu'il se présente. Qu'il prenne le masque du "révisionnisme" assassin de la mémoire ou, un demi-siècle avant, celui brutal et meurtrier du nazisme antijuif, il est une insulte à l'esprit des lois.
C'est de ce point de vue juridique qu'on considérera ici le premier temps fort des rendez-vous avec l'antisémitisme pendant ce demi-siècle. D'importation à l'époque, il butait sur les "scrupules nés du respect de la Constitution " des autorités nationales.
Les "scrupules constitutionnels"
L'occupant n'ignorait pas combien la greffe d'un antisémitisme d'Etat en Belgique constituait une subversion fondamentale de l'Etat de droit. Ses directives pour l'administration du pays l'avaient averti du risque politique d'y "entamer la question des races, cela pourrait faire conclure à des intentions d'annexion"[3]. Introduites après six mois d'expectative, le 28 octobre 1940, ses premières ordonnances "contre les Juifs" - comme elles s'intitulaient - étaient "en opposition avec les principes de notre droit constitutionnel et de nos lois"[4]. Il revint aux porte-parole de la magistrature dans la capitale de le lui rappeler. Dans ce propos, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et les Premier Président et Procureur Général de la Cour de Cassation s'abstinrent toutefois "scrupuleusement" de discuter des "principes qui sont à la base des Institutions du Reich". A Londres, le gouvernement belge ne s'engagea pas non plus dans cette vaine discussion. Les "diverses mesures" prises dans le pays occupé imposaient de dénoncer en janvier 1941 les "atteintes à la souveraineté de l'Etat belge" sous cette "occupation réalisée par la force au mépris du droit des gens"[5]. Londres visait entre autres des dispositions de l'occupant "contraires au principe constitutionnel d'égalité de tous les Belges devant la loi, sans distinction de croyance, de race ou de langue".
Le rappel des "principes d'ordre juridique et social qui sont à la base de la vie nationale" y introduisait explicitement le rejet de toute discrimination fondée sur "la race". Le concept juridique ne figurait cependant pas dans le droit belge. La guerre de 1939 n'avait pas alors laissé le temps au législateur belge de suivre l'exemple de la France , en matière d'antiracisme. La France des droits de l'homme et du citoyen dont on célébrait justement le cent cinquantième anniversaire venait d'instaurer le délit d'injure ou de diffamation raciale. Le décret Marchandeau du 21 avril 1939 punissait toute attaque contre "un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée, lorsqu'elle aura pour but d'exciter la haine entre citoyens ou habitants". Par un effet pervers de miroir, cette législation antiraciste avalisait le discours sur la "race" qu'elle prétendait combattre par la loi. C'est le travers paradoxal de la législation antiraciste d'acclimater, inconsciente de cette corruption, le mythe idéologique d'appartenance d'une personne "à une race" autre qu'humaine. Pour frapper de nullité légale les actes d'inspiration raciste accomplis en Belgique occupée, le gouvernement belge de Londres a, à son tour, introduit le concept racial dans l'arrêté-loi du 10 janvier 1941 publié dans le Moniteur belge londonien . Il en sera de même quarante ans après avec la loi Moureaux contre "le racisme ou la xénophobie": son article 1er qualifiera "en raison de [la] race" les pratiques décrétées illégales.
Cette race à laquelle les légistes se réfèrent est un concept juridique absurde au plein sens du terme. Même les légistes nazis, adeptes du racisme, ne purent articuler ses fantasmes. Dans le Reich hitlérien, les fonctionnaires du ministère de l'intérieur trébuchèrent, dès 1935, sur son absurdité juridique,. Il leur incombait, en novembre, de rédiger les arrêtés d'exécution de la toute récente "loi" de Nuremberg "pour la protection du sang et de l'honneur allemand". Aucun critère "biologique" n'était opératoire dans le dispositif administratif et réglementaire indispensable pour identifier par la "race" ce Juif "non-aryen" exclu désormais des droits de la citoyenneté. Il fallut se résoudre à un biais non racial. L'appartenance "au culte juif" vint combler le vide juridique de la "race juive". L'administration nazie en Belgique occupée fut tout aussi pragmatique. L'idéologie raciste lui commandait, dans sa première ordonnance antijuive, de définir le Juif par son ascendance biologique ... de "race juive". C'est la filiation avec les grands-parents qui introduisit le lien biologique. La définition demeurait vicieuse. Elle portait qu'"est jui[ve] toute personne issue d'au moins trois grands-parents de race juive". L'idéologie sauvegardée, la "race juive" du grand-parent prenait consistance avec la preuve de son adhésion au "culte juif". La disposition permettait, selon l'administration militaire, de "constater plus facilement la qualité de Juif, d'empêcher les Juifs d'éluder la loi et de rendre plus difficiles aux autorités belges d'éventuels manquements à leurs devoirs". En l'occurrence, elle imposait au pays occupé dont il incombait de respecter les lois et la constitution une discrimination basée sur la religion, tout au moins dans l'ascendance parentale des personnes. Absurde dans son principe, le concept racial corrigé par la religion débouchait sur une incohérence juridique. Un Juif converti à la religion catholique restait de "race juive" s'il était prouvé que trois de ses grands-parents avaient adhéré à la religion juive. Il perdait sa qualification "juive" s'ils appartenaient à une autre religion pour autant qu'il n'eût pas lui-même rallié celle des Juifs.
Pour démêler cet imbroglio juridique, il fallut établir un Bureau des Etudes Généalogiques et Raciques qui délivrait des certificats d'aryanité. Instance belge, il ne relevait pas d'un Commissariat Royal aux Questions juives. Le projet existait dans les cartons de services allemands impliqués dans la question juive. Des raisons d'opportunité politique écartèrent cette tentative de greffer une instance raciste d'Ordre nouveau sur l'appareil d'Etat belge. Les contestations de judéité raciale furent en conséquence traitées dans un service auxiliaire de la police de sécurité allemande, et non devant les tribunaux belges. Il en fut autrement en France où les magistrats furent les premiers à se "salir les mains"[6]. Engagé dès l'invasion allemande dans une autre "Révolution nationale", l'"État français" du Maréchal Pétain s'était empressé, en août 1940, d'écarter l'obstacle du décret Marchandeau. L'abrogation de la législation antiraciste de 1939 ouvrit symboliquement la voie à l'antisémitisme d'Etat inscrit au programme du gouvernement du Maréchal. Il était de facture française et, devant la concurrence allemande, farouchement jaloux de ses prérogatives nationales. En l'absence de sollicitations du côté allemand, c'est Vichy qui prit les devants au début de l'automne 1940 et qui instaura un statut français de discrimination et d'exclusion des personnes de "race juive". L'initiative précipita la décision allemande de poser enfin cette "question juive" si embarrassante dans les territoires occupés de l'Ouest et d'en conserver la maîtrise.
Relevant de la seule législation de la puissance occupante, le concept de race n'en fit pas moins une timide intrusion dans le texte légal belge. Au printemps 1942, le Moniteur belge des arrêtés ministériels et autres arrêtés des secrétaires généraux publia les statuts d'une Association des Juifs en Belgique créée sur ordre allemand. L'administration d'occupation tint, pour des raisons d'efficacité, à la faire apparaître comme une institution de droit belge, même de "droit public". Pour ce camouflage, on se rabattit, à défaut d'autre solution, sur le statut inconfortable d'association sans but lucratif. L'institution légale des Juifs en Belgique n'était cependant pas une association volontaire, mais une communauté forcée, un ghetto administratif auquel une ordonnance allemande imposait l'adhésion obligatoire[7]. C'est pour définir ses membres que les statuts se référaient explicitement à la première ordonnance antijuive et raciste de l'autorité militaire d'occupation. Cette référence dans le Moniteur belge déchaîna la jubilation des militants belges du racisme antijuif. La Ligue pour la Sauvegarde de la Race et du Sol s'empressa d'acter le "fait réjouissant que pour la première dans l'histoire "belge" un décret paraît dans le Moniteur basé sur le principe de la race"[8]. Dans la résistance, La Libre Belgique stigmatisa la complaisance du secrétaire général du Ministère de l'Intérieur responsable de cette publication belge sur simple "communication" allemande. Le journal patriotique dénonçait le "traître". Homme d'Ordre nouveau promu à ce poste, il s'était permis, "sans que les autres secrétaires généraux s'y opposent, de faire descendre définitivement notre Moniteur officiel - déjà bien bas - au niveau de la presse asservie [...] entièrement à la dévotion de l'occupant".
Les "scrupules nés du respect de la Constitution " n'étaient aucunement un obstacle incontournable. Les "principes" du "droit constitutionnel" et des "lois" belges ne constituèrent pas un rempart juridique contre la discrimination des personnes en raison de leur appartenance à la "race juive" et de leur adhésion au "culte juif". Jamais, les tribunaux belges, gardiens de la loi et du droit, ne furent au centre d'un conflit de légalité avec les ordonnances allemandes. Personne ne les invita à prendre la protection des Juifs atteints dans leurs droits, leurs biens et leurs libertés individuels en violation de la légalité du pays occupé. Ni les magistrats, ni les parties lésées n'ont songé à une guérilla judiciaire. Tout au plus, à l'occasion et par exception, une procédure judiciaire sanctionna l'un ou l'autre ressortissant belge pour ses forfaits antisémites. Dès l'invasion, à l'approche des Allemands, des militants du racisme antijuif se crurent la voie libre pour passer à l'acte. A Anvers, encore en mai 1940, ils placardèrent des affiches injurieuses et brisèrent des vitrines de magasins juifs[9]. La police communale leur dressa procès-verbal. Mais l'affaire n'eut pas de suite au parquet d'Anvers. A Bruxelles par contre, en 1941, le tribunal de 1ère instance de Bruxelles sanctionna 8 trublions d'Ordre nouveau. Membres de la milice rexiste, ils s'étaient attaqués aux marchands ambulants de la place Bara, à la gare du Midi, le 4 octobre 1940. un vendredi, jour du nouvel an israélite. A l'époque, le bulletin de victoire du Pays Réel s'était félicité de ce que "des boutiques furent prises d'assaut, saccagées et leur camelote éparpillée". Le journal d'extrême droite avait toutefois omis de signaler les procès-verbaux que des policiers bruxellois présents sur les lieux rédigèrent à leur charge. En cette circonstance, les magistrats de la capitale ne poursuivaient cependant pas une bataille d'arrière-garde judiciaire dans la question juive.
La "voie de la conciliation"
A l'automne 1940, après les premières ordonnances antijuives, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, le Président et le Procureur général de la Cour de Cassation n'étaient pas intervenus dans un esprit de rupture avec l'occupant. Ils avaient au contraire exprimé leur "vif désir de continuer à aplanir toute difficulté par la voie de la conciliation". Ils protestaient de leur bonne volonté. " La Justice belge s'est acquittée jusqu'ici", dirent-ils, "d'une tâche difficile et délicate pour le plus grand bien du pays sans aucun conflit avec l'occupant". Aussi, sollicitaient-ils un entretien avec l'autorité allemande pour l'"éclairer complètement sur la portée de la Constitution et des lois belges et sur les questions importantes que soulèvent [ses ...] ordonnances" antijuives. Leur lettre se limitait pourtant à un seul point. Elle manifestait l'émotion du "monde judiciaire", du moins celui de la seule capitale, devant l'interdit professionnel frappant ... les avocats juifs. Ces "protestations" - l'administration allemande interpréta en ce sens la lettre - agacèrent l'occupant. "Ils n'ont pas la moindre idée de ce que nous avons été encore beaucoup trop doux", nota une main allemande autorisée sur la lettre des magistrats bruxellois. Éconduit, le Bâtonnier de l'Ordre directement impliqué dans l'élimination de ses collègues juifs, durcit le ton. Il opposa au refus de l'occupant de l'entendre "un devoir de conscience qu'aucune considération ne peut modifier, celui de dire que le principe même de [son] ordonnance est en opposition directe avec le Droit". En conséquence, le Conseil de l'Ordre décida de ne plus publier le tableau des avocats pour n'avoir pas à en radier les collègues juifs interdits.
La presse la plus radicale de la collaboration dénonça publiquement cette "résistance passive". Du point de vue de la résistance, ce n'était pourtant qu'une "politique d'autruche". Au dire de La Voix des Belges, important journal clandestin, elle "avait été sévèrement critiquée dans les milieux loyalistes du Palais". Ils reprochaient aux autorités de l'Ordre d'avoir cherché son salut dans le silence. N'osant ni consacrer l'inconstitutionnalité d'une mesure inique en omettant du tableau les confrères frappés, ni surtout protester ouvertement en les y maintenant, le conseil s'était diplomatiquement résigné à ne point publier le tableau", selon le journal patriotique. Du côté des avocats interdits, personne n'osa non plus accomplir le geste qui aurait contraint le Conseil de l'Ordre à franchir un autre pas dans la protestation du droit contre l'ordonnance antijuive. La chose se fit à Anvers, dans un tout autre contexte. Une avocate rétive à l'injonction allemande se rebiffa et plaida sa cause devant le conseil de discipline. A Anvers, l'Ordre des avocats avait radié ses collègues - si le mot convient - juifs. La Juive rebelle lui contesta ce droit puisqu'elle n'avait en aucune façon failli aux règles d'honneur et de délicatesse dans l'exercice de la profession. Ce fut en vain. La pression de l'Ordre nouveau sur l'Ordre des Avocats n'était pas négligeable, à Anvers. Entre autres, le chef de la Ligue pour la Sauvegarde de la Race et du Sol appartenait au barreau anversois. A Bruxelles, un barreau bien moins complaisant, n'empêcha pas l'occupant de parvenir au résultat escompté. Dans ce cas d'espèce, les "principes" du "droit constitutionnel" et des "lois" belges ont seulement servi d'échappatoire pour ne pas se "salir les mains".
Dans cette "question juive" dont il préparait, pas à pas, la "solution finale" dans le territoire occupé, le pouvoir allemand sut, avec un sens aigu de l'opportunité, louvoyer entre les "scrupules" constitutionnels des autorités belges. Dans cette matière des plus délicates, l'administration militaire manoeuvra pour convaincre ces autorités nationales que ses ordonnances antijuives étaient pour elles un moindre mal. Il les persuada qu'"il lui répugne d'avoir recours [à ce] procédé". L'autorité d'occupation aurait préféré, prétendit-elle, que les secrétaires généraux des ministères décrètent leur propre statut des Juifs. Une initiative belge en la matière n'était pas impensable. Il était conforme à l'esprit du temps d'assurer "la protection de la race et (la) réduction graduelle du nombre d'étrangers"[10]. Dans le désarroi des premières semaines de l'occupation, on l'avait inscrit, du côté belge, au programme d'un gouvernement fort à constituer sous l'égide du roi Léopold III. Cette dérive de l'Etat belge vers l'Ordre nouveau aurait conservé des garde-fou de l'ancien Régime "en respectant les commandements de l'humanité et en réprimant toute action non légale". Ce projet avorté, les milieux de la collaboration raisonnable persisteront à plaider pour "un antisémitisme d'Etat qui épargnerait les violences inutiles par un statut des Juifs, humain et équitable, statut préparatoire au départ des Juifs"[11]. Le problème juif est, de ce point de vue national belge, "un problème d'Etat et postule une solution légale". On découvrira même dans es ordonnances antijuives de l'occupant "un statut des Juifs [qui] n'implique aucune idée de persécution, de brutalité ou de traitement inhumain". De ce côté, on regretta la "carence" de "certaines autorités belges [qui] s'abriteraient derrière la Constitution"[12].
Ce fut, en effet, la réponse des secrétaires généraux des ministères à la sollicitation allemande. Le 11 octobre 1940, ils se retranchèrent derrière la Constitution et la convention internationale de La Haye pour ne pas "assumer la responsabilité des mesures envisagées à l'égard des Juifs". Cette fin de non-recevoir faisait néanmoins l'impasse sur le noyau incontournable de la manoeuvre allemande. La "répugnance" de l'occupant à légiférer contre les Juifs du pays était de façade. Ce qui lui importait, c'était d'assurer l'intendance d'une politique antijuive dont il céderait pas le contrôle. Lui ne disposait pas d'un personnel administratif et policier suffisant en nombre pour la mener à bonne fin. Le relais de l'appareil d'Etat belge et de ses services lui était indispensable.
Le collège des secrétaires généraux ne s'engagea pas dans cette politique d'exécution d'ordres allemands contraires aux lois et à la constitution du peuple belge sans s'entourer de garanties juridiques. Il consulta, à cette fin, le comité permanent de législation formé de juristes et de hauts magistrats. A son estime, les "mesures contre les Juifs" méconnaissaient les principes de base du droit de belge au point "que la participation à ces ordonnances excède manifestement le pouvoir légal des autorités administratives belges": "elle constituerait la violation de leur serment d'obéissance à la Constitution et le crime prévu" dans le code pénal. L'expertise juridique ne concluait pourtant au refus de "participer". C'est que "toute exécution donnée aux prescriptions des ordonnances n'est pas une "participation" à celles-ci". Ainsi, selon le conseil de législation, "celui à l'égard de qui ou contre qui une mesure est prise par l'autorité occupante et qui, sous la contrainte sur laquelle s'appuie cette autorité, accomplit l'acte matériel qu'elle lui impose, subit la mesure, il n'y participe pas". Pour illustrer cette conception de l'exécution passive, un juriste - ministre d'Etat et procureur général honoraire - recourut à la métaphore du billot. "La victime de la mesure en la subissant ne l'exécute pas", expliquait-il. "Le bourreau exécute l'arrêt de condamnation, il exécute l'arrêt, il exécute le condamné, celui-ci est exécuté et ne participe pas à l'exécution, même s'il place spontanément sa tête sur le billot". En l'occurrence, l'aval des juristes autorisait les secrétaires généraux à prêter sur ordre de l'occupant, comme le bourreau, le concours des administrations belges à la persécution de ses victimes juives.
Tardivement, à la veille des déportations dont on ignorait l'imminence, on s'aperçut du côté belge, du moins dans la capitale, qu'il y avait des limites dans l'"exécution passive" que même un bourreau ne pouvait franchir.
Les limites du "bourreau"
Ces limites furent atteintes avec l'ordonnance du 1er juin 1942 obligeant tous les Juifs du pays à porter l'étoile jaune. Contre toute attente, les bourgmestres bruxellois - et eux seuls - refusèrent de prêter leur "collaboration à son exécution"[13]. Ils dirent à l'autorité allemande qu'ils ne pouvaient se "résoudre à [s']associer à une prescription qui porte une atteinte aussi directe à la dignité de tout homme, quel qu'il soit". Toutefois, ils insistaient, dans leur refus de prêter les services communaux à la distribution des étoiles aux 30.000 Juifs de la capitale, sur l'argument factice qu'"un grand nombre [...] sont belges". Sans s'en apercevoir, la protestation humanitaire belge ouvrait une faille que l'occupant saurait exploiter dans la phase suivante bien plus cruciale pour la personne humaine. Le port obligatoire de l'étoile jaune annonçait le "prochain pas à accomplir". Mesure de surveillance policière, il consacrait l'isolement des Juifs avant leur "évacuation". Dans l'imminence de la solution finale arrivée à échéance, l'occupant, pris au dépourvu dans l'affaire de l'étoile, laissa passer la rébellion des bourgmestres bruxellois. Cette insoumission nouvelle d'autorités belges dans la question juive lui indiquait jusqu'où l'action d'"évacuation" à venir ne pourrait aller trop loin au risque d'une crise politique dans le territoire occupé.
Avec un savoir-faire remarquable, l'administration allemande exploita l'attitude ambiguë des officiels belges à l'égard des Juifs du pays qui, dans leur masse - à 94% - n'étaient précisément pas leurs compatriotes. Certes, le principe constitutionnel n'autorisait pas les autorités belges à faire une différence dans la "protection accordée aux personnes et aux biens". La Constitution l'étendait "à tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique ", sauf les exceptions légales. En pratique, dans un repli xénophobe, les autorités belges abandonnèrent les Juifs étrangers à l'occupant. Après avoir négocié avec succès le cap difficile de la déportation, le pouvoir allemand acta avec satisfaction que "le "ministère de la justice", en particulier, son département des cultes compétent pour traiter des affaires concernant les ... Israélites, "et les autres institutions belges ont toujours déclaré qu'ils ne voulaient s'occuper que des Juifs de nationalité belge". D'emblée, pour neutraliser les autorités belges, l'administration allemande leur avait aménagé un espace de moindre mal dans la solution finale, en exceptant provisoirement de la déportation juive la toute petite minorité de leurs compatriotes. Avec cet atout belge, l'occupant réussit ici à retarder la crise redoutée d'une bonne année. Elle survint - encore que singulièrement amortie - en septembre 1943 après la rafle de moins d'un millier de Juifs belges et le départ de leur convoi. Le collège des secrétaires généraux se décida enfin à "élever une protestation contre des mesures qui méconnaissent à la fois les principes les plus sacrés du droit et le respect dû à la liberté humaine"[14]. Le champ d'action de ces "principes" était des plus étriqués. La protestation exprimait seulement "la pénible impression ressentie par les autorités et la population belge à l'occasion des mesures qui frappent certains de [leurs] compatriotes". Le nouveau secrétaire général du ministère de la justice méconnaissait, dans sa copie, le fait autrement massif de la déportation de 22.000 Juifs étrangers avant le départ du convoi "belge". Les "compatriotes" juifs des autorités nationales ne furent jamais qu'une infime minorité dans la population déportée: à peine 5% des 25.000 Juifs évacués au titre de la solution finale.
Se désintéressant de cette déportation massive, les autorités belges - y compris, en l'occurrence, les magistrats du parquet - furent d'autant plus discrètes sur la participation de leur police à la "rafle du 'Vel d'Hiv'" belge au cours de l'été 1942. Le Vélodrome d'Hiver à Paris avait servi à rassembler la plupart des 13.000 Juifs que la police française a arrêtés au cours de la grande rafle des 15 et 16 juillet 1942. Les rafles débutèrent un mois plus tard en Belgique, d'abord à Anvers où, comme à Paris, la police nazie pallia l'insuffisance de ses effectifs en se servant de la police communale. A deux reprises, dans la nuit du 15 au 16 et dans celle du 28 au 29 août, la police anversoise se prêta à l'arrestation de 2 à 3000 Juifs. Toutes proportions gardées, les policiers anversois firent au cours de ces deux nuits de rafle un score équivalent à celui de leurs collègues parisiennes. Mais, à la différence de la police de l'"État français", il n'y eut pas d'autres 'Vel d'Hiv' de la police belge. Dans la capitale, l'étoile jaune avait mis fin à la politique d'"exécution passive" dès la fin du printemps 1942. Dans ces conditions politiques nouvelles, les forces de police allemandes furent réduites à opérer avec leurs propres moyens le ratissage du quartier de la gare du midi, au cours de la razzia nocturne du 3 au 4 septembre 1942. Il n'y eut guère d'autres grandes rafles. Dès la fin de l'été 1942, les rescapés comprirent qu'ils se livraient à terme s'ils demeuraient à leur domicile légal.
Cette rupture avec la légalité, y compris la loi belge, face à la menace généralisée et anonyme de déportation, limita les ravages de la solution finale en Belgique occupée. Ils se chiffrent en fin de compte à 45% avec l'acheminement d'un total de 25.000 Juifs à Auschwitz. La plupart - 16.000 - furent assassinés dès leur arrivée, les autres étaient voués à la mort concentrationnaire. Guère plus d'un millier étaient encore en vie, à la fin de la guerre. Il n'y eut même aucun survivant d'un des 27 convois juifs partis du camp de rassemblement de Malines.
Ce convoi IV du 18 août 1942 est sans doute le plus typique de cette déportation raciale. Entièrement anéanti, il n'est pourtant pas, par sa formation, le plus caractéristique. Il a été constitué avec les victimes de la rafle anversoise du 15 août. Il donne rétrospectivement un sens terrible à la métaphore juridique du "billot" qui légitimait au début de la question juive la politique belge d'"exécution passive" des ordres allemands. La collaboration de policiers belges dans l'exercice de leur fonction à l'arrestation des Juifs à déporter au titre de la solution finale en a été la conséquence extrême. Les officiers de la police anversoise, sommés de procéder à ces arrestation dans leur ressort territorial, ne se conduisirent pas autrement que les autorités administratives dont ils relevaient. De même que la distribution des étoiles jaunes n'avaient pas été, à la fin du printemps 1942, un ordre inacceptable à Anvers, ces officiers de police firent, avec leur agents, le travail du "bourreau" accomplissant l'ordre allemand. Conformément à la loi belge, ils rendirent compte aux autorités concernées. Non sans embarras, ils justifièrent leur activité nocturne en invoquant l'état de nécessité dans les pro justitia adressés régulièrement au procureur du Roi d'Anvers. Ces arrestations pourtant arbitraires et contraires aux principes les plus élémentaires du droit belge ne provoquèrent pas la crise redoutée du côté allemand. Il n'y eut aucune protestation formelle des autorités belges, parquet compris, contre cette réquisition illégale des forces de police belges[15]. La seule mise en demeure faite à ce propos est de source allemande. Dans l'action d'"évacuation des Juifs", la police SS avait multiplié les "abus [....] contraires aux conventions antérieures" établies avec l'autorité militaire d'occupation[16]. Cette dernière inquiète de leurs "conséquences fâcheuses sur le plan politique" rappela à l'ordre la police SS et confirma ces remontrances dans un écrit en bonne et bue forme. Dans le même temps, le pouvoir militaire enjoignit formellement à ses services locaux de "s'abstenir de faire appel à la police belge"[17]. Il ne resta dès lors à la vingtaine de SS allemands en charge de la solution finale d'autres relais belges que les auxiliaires détachés des formations paramilitaires des mouvements d'ordre nouveau, principalement de la SS flamande.
De ces relais belges sans lesquels l'"ennemi" n'aurait pu accomplir son "oeuvre de mort", ce fut le seul que la commission des crimes de guerre auprès du ministère de la justice retint en fin de compte. Dans son rapport sur La persécution antisémitique en Belgique, elle dénonça l'aide apportée à l'occupant "par de très nombreux auxiliaires, prêts à tout pour assouvir leurs instincts les plus vils et leur cupidité éhontée"[18]. Sous ce regard tronqué, l'histoire était désormais criminalisée. La justice belge, convoquée à son deuxième rendez-vous avec cette "oeuvre de mort", allait lui appliquer des concepts juridiques inadéquats à son sens réel. Ils lui firent faire l'impasse de l'après-1945.
L'impasse de l'après-1945
Constituée dès le 21 décembre 1944, cette commission d'enquête sur les violations des règles du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre et des devoirs de l'humanité prépara l'action répressive des cours militaires. Formée essentiellement de juristes, elle comportait aussi, à cette fin, un substitut de l'Auditeur général, ainsi que le secrétaire de la Commission Royale d'Histoire, dans le souci de "faire" également "travail d'historien". Son rapport sur la persécution antisémitique date de 1947. Il l'inscrivait au chapitre des "infractions au droit des gens".
Le "classement idéologique" de ces "infractions" distinguait la "persécution des Juifs" des autres infractions, entre autres des "déportations". L'énumération qui n'avait "aucun caractère limitatif", ne comportait néanmoins pas les exterminations. Celles-ci ne figuraient pas non plus dans l'autre catégorie des "crimes de droit commun" où la commission inscrivait notamment les "massacres par représailles", désignant par là des actes perpétrés sur le territoire belge. Avec ses deux volets d'"infractions au droit des gens" et de "crimes de droit commun", la notion belge de crime de guerre s'avérait d'emblée un concept juridique impropre à saisir l'événement juif de la seconde guerre mondiale.
Dans l'après 1945, il n'était pas mieux appréhendé avec le concept de "crimes contre l'humanité", fondement juridique de la Cour militaire internationale de Nuremberg. Le génocide juif n'a pas été inscrit dans les charges retenues contre les dirigeants de l'Allemagne nazie. Le statut de Nuremberg énumère un ensemble de "crimes contre l'humanité", mais non celui de génocide. Le concept juridique de Nuremberg englobe "l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes populations civiles" ainsi que "les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux"[19]. La notion juridique couvre un large éventail des crimes de la période nazie sans pour autant qualifier les actes constitutifs d'un génocide. Ni des "déportations", ni des "exterminations" ne font un génocide et elles n'ont pas fait le génocide juif.
L'événement historique procède de "la grave décision" dont parlait pendant son exécution le chef des tueurs SS, "de faire disparaître ce peuple de la terre". La "décision" impliquait, pour son organisation, d'opérer la déportation génocidaire en un mouvement continu. Les déportés étaient systématiquement assassinés dès leur débarquement. Ils étaient déportés pour être exterminés. C'est cette continuité des déportations et des exterminations qui caractérise l'événement génocide dans son accomplissement. Élaborant le concept juridique en 1944, Raphaël Lemkin n'a considéré ce "cas" qu'à titre exceptionnel. "Dans son sens le plus général", écrit-il, "génocide ne signifie pas forcément liquidation immédiate d'une nation, sauf dans le cas où il s'accomplit par le massacre direct de tous ses membres". Aussi, le concept juridique a-t-il plutôt nommé une politique "visant à détruire les fondations de la vie des groupes nationaux, dans le dessein final d'annihiler les groupes eux-mêmes". Dans ce sens extensif, la convention de l'O.N.U. pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948 y a inscrit les "actes commis [...] dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux"[20].
Du "tout" à la "partie", le concept juridique glisse insensiblement de l'événement génocidaire à la spécificité de ses victimes. Il suffit qu'elles soient choisies en raison de leur identité "national[e], ethnique, racial[e] ou religieu[se]". A la limite, l'acte qui les prive de leur identité qualifie le génocide tout autant que leur assassinat. L'O.N.U. inscrit ainsi dans sa définition aussi bien le "transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe" que "le meurtre de membres du groupe".
Les SS d'Himmler, experts en la matière, avaient une conception bien plus restrictive du génocide juif. Dans ce cas d'espèce, les tueurs SS ne commettaient aucune confusion de sens. C'était "tout" le groupe dont le massacre était systématiquement poursuivi. Himmler ne concevait pas de lui prendre "tout ce qui est de bon sang"[21]. Le chef des SS l'envisageait chez d'autres peuples, entre autres les Slaves. Il était concevable, du point de vue raciste, de "leur vole[r] même leurs enfants". En revanche, il n'était admissible, du même point de vue, que des enfants juifs, même déjudaïsés, puissent vivre physiquement. Le sens de "la grave décision de faire disparaître ce peuple de la terre", c'est précisément de le priver d'avenir en exterminant les enfants. Le chef des SS ne se sentait pas, selon ses confidences livrées aux plus hauts dignitaires nazis, "le droit d'exterminer les hommes - dites si vous voulez, de les tuer ou de les faire tuer - et de laisser grandir les enfants qui se vengeraient sur nos enfants et nos descendants". Dans ce témoignage himmlérien d'époque, les massacres, fussent-ils de Juifs, ne suffisent pas encore à faire l'événement génocidaire dont il n'a jamais été si bien dit la nature singulière. Ce qui fait la différence du judéocide et qui signifie, dans la pratique meurtrière des SS, cette "grave décision", c'est, du point de vue de leur chef, la mise à mort préméditée et systématique des enfants juifs.
L'après-1945 découvrant toute l'ampleur du génocide ne pratiquera cette approche historique qui lui restitue sa singularité dans les atrocités nazies. Ce qu'on retiendra au moment de rendre justice, c'est, comme y insiste le rapport belge sur "la persécution antisémitique", "cette gigantesque entreprise criminelle"[22]. Enquêtant sur les faits, la commission des crimes de guerre n'a pu se limiter au juridisme des "infractions au droit des gens", ni même des "crimes de droit commun" commis sur le territoire belge. Le chapitre belge était l'"un des multiples aspects" de la "tragédie des Juifs d'Europe". Et, dans cette lecture, la commission découvrait même "un plan préalable et systématique", un "plan général d'anéantissement des Juifs". Il consistait "à rassembler et isoler les Juifs", puis "à les déporter". De cette déportation "dans des conditions inhumaines", insiste l document, le rapport retient qu'"arrivés à Auschwitz, [...] les femmes et les enfants, les vieillards, les faibles et les malades étaient isolés et immédiatement envoyés à Birkenau où se trouvaient les chambres à gaz et les crématoires. Des milliers de personnes furent ainsi dès leur arrivée, conduites à la mort dans des conditions atroces"[23].
La logique de cette lecture conduit la commission à déterminer la "responsabilité" des autorités allemandes d'occupation, tant les militaires que les policiers. Cette responsabilité est "engagée plus particulièrement en ce qui concerne la persécution antisémitique en Belgique", mais elle ne les dégage aucunement de toute implication dans "le plan général criminel". Au contraire, dit même le rapport, "c'est à eux qu'échut la tâche de mener à bien, sur un territoire déterminé, le plan général criminel des chefs suprêmes de leur pays"[24]. Le réquisitoire de la commission s'interroge toutefois sur l'opportunité "de doser les responsabilités". Il lui faut "répondre par la négative". Il ne lui est pas apparu, "bien au contraire", que quiconque, "à quelque degré de la hiérarchie qu'il ait appartenu" ait eu "le dessein d'adoucir les souffrances des victimes". "Il ressort au contraire, de l'analyse impartiale des faits [...] connus", souligne la commission, "que tous, initiateurs ou exécutants, dirigeants ou subordonnés, agents ou auxiliaires, sont également responsables, chacun pour sa part, des innombrables crimes dont furent les victimes innocentes les Juifs de Belgique"[25]. Mêmes les autorités militaires d'occupation n'échappent pas à cette responsabilité globale. "Ces hommes", souligne le rapport, "édicteront les ordonnances et donneront les instructions qui forment le cadre légal du mécanisme [...] d'anéantissement de la population juive". De surcroît, "c'est sous leur autorité que s'organisèrent et fonctionnèrent les multiples rouages de l'appareil policier, qui des caves de la Gestapo [...] ou aux charniers d'Auschwitz, broya tant de vies humaines".
La logique accusatrice de l'exposé laisse supposer que la commission des crimes de guerre recommande, en conclusion, que "les coupables soient justement punis des nombreux crimes qu'ils ont commis"[26]. Ce qu'elle fait en effet, mais en limitant singulièrement les chefs d'accusation. Elle ne dénonce pas "au gouvernement belge et aux gouvernements des Nations Unies" les responsables allemands de la persécution des Juifs de Belgique pour leur complicité dans l'exécution du "plan général criminel". Elle les dénonce seulement pour les "crimes suivants: déportation de civils, internement de civils dans des conditions inhumaines, confiscation de biens, arrestation en masse sans discrimination"[27].
Les procès "belges" de 1950/1951 feront ainsi l'impasse sur l'épilogue judiciaire du "plan criminel" du IIIe Reich contre les Juifs de Belgique. Dans ces procès, les charges "juives" pour le moins mitigées pèseront bien moins que d'autres chefs d'inculpation, telles les fusillades d'"otages terroristes". Les 300 victimes des ces "massacres par représailles" perpétrés en Belgique auront plus d'impact sur la condamnation des auteurs allemands que les 24.000 Juifs du pays disparus en déportation.
Occulté dans les procès "belges", le génocide des Juifs de Belgique connaîtra pourtant son épilogue judiciaire trente ans après en Allemagne fédérale. Tardivement il est vrai, les magistrats allemands reprendront la mauvaise copie de leurs collègues belges. Dans les années 1970-1980, trop lentement pour conclure par un procès dans ce cas, ils inculpèrent même l'un des officiers SS jugé en Belgique pour la déportation des Juifs, mais "uniquement du point de vue légal de la privation de liberté"[28]! Les charges allemandes furent autrement pesantes. Le chef d'inculpation fut rien de moins que la "complicité dans la mise à mort cruelle et perfide d'un grand nombre d'êtres humains pour avoir, dans la période d'août 1942 à juillet 1944, à divers moments et à des degrés divers, collaboré à la déportation de quelque 26.000 juifs [sic ...] vers le camp d'extermination d'Auschwitz"..
Ces "crimes nazis" du droit allemand ne sont pas plus des "crimes contre l'humanité" que dans le droit belge. Le procès "belge" en Allemagne n'a pas été, en 1981, un procès Barbie avant la lettre. A la différence du procès français de 1987, c'est le droit pénal ordinaire que les magistrats allemands ont appliqué au cas "belge". La cour d'Assises du Schleswig-Holstein rendit un verdict de culpabilité pour "avoir contribué au meurtre" des Juifs de Belgique en les déportant à Auschwitz[29]. Le jugement ne se fonde pas sur des preuves documentaires qui auraient inaccessibles à l'époque des procès "belges" pour répondre à la question cruciale de la connaissance du sens réel des déportations juives. La pièce d'archives nazies qui emporta la conviction figurait, à l'époque du procès de Nuremberg, dans le rapport français sur la persécution des Juifs à l'Ouest de l'Europe. Datant du printemps 1942, cette note de service dévoilait dans les déportations juives projetées à partir de l'Europe occidentale "une solution finale ayant pour but l'extermination totale de l'adversaire"[30]. Ni les magistrats français, ni leurs collègues belges ne s'y référèrent dans leurs réquisitoires et leurs verdicts. Aucune "juridiction belge" n'en avait eu besoin dans les procès pour crimes de guerre après 1945. En Belgique, aucune "personne" ne fut à l'époque "reconnue coupable" tout à la fois de la déportation et de l'anéantissement des Juifs.
Quarante ans après, le législateur n'envisage pas moins d'édifier avec les procès de l'après-1945 un rempart juridique contre le "révisionnisme" négateur du génocide juif. Les magistrats belges n'ont pourtant pas manqué ce troisième rendez-vous avec l'antisémitisme en dépit d'une législation répressive inappropriée. La loi Moureaux de 1981 ignore l'antisémitisme en tant que tel. Elle tend seulement "à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie". L'antisémitisme y est implicite comme une sous-catégorie du racisme moins essentielle cependant que la xénophobie élevée au rang de ce dernier. Ce faisant, la loi, en retrait des enjeux de son temps, ignore le fait nouveau du nouvel antisémitisme des années 1980[31].
Le temps du nouvel antisémitisme
Paradoxalement, ce sont pourtant des violences antisémites qui ont été à l'origine immédiate de cette législation contre "le racisme et la xénophobie". Il a "sans doute" fallu, confie l'auteur de la loi dix ans après, "les tragiques attentats de Paris, Munich et Anvers au début des années 1980" pour "vaincre des forces usant de toutes les arguties juridiques" au sein du Parlement[32]. Dans sa préface au bilan judiciaire d'une décennie de "lutte contre le racisme et la xénophobie", l'ancien ministre de la Justice rappelle encore que les premières propositions en cette matière datent des années 1960. La Belgique n'avait pas seulement dix ans de retard sur la France dotée d'une loi répressive en 1972. Elle avait laissé sans réponse les symptômes d'une renaissance de l'antisémitisme en Europe occidentale dès la fin des années 1950.
Ses soubresauts répétés ont tendu dans la longue durée à lui rendre un statut d'opinion dont les horreurs nazies de la seconde guerre mondiale l'avaient privé. Dès ces années 1950, l'extrême droite la plus extrême s'insurgeait contre ce "curieux épouvantail que dressent de temps en temps nos dirigeants pour effrayer les bien-pensants". La Phalange française découvrait dans l'accusation d'antisémitisme "la pierre angulaire de toute une propagande qui a pour mission de nous abattre"[33]. La crise des sociétés occidentales dans les années 1970 a permis d'attaquer l'obstacle. Comme dans les années 1930, la vague de racisme et de xénophobie qui déferle depuis a balisé le terrain pour le tournant des années 1980. Le retour en force de l'antisémitisme marque cette dernière décennie. Elle débute avec l'attentat à l'explosif à la synagogue de la rue Copernic à Paris le 3 octobre 1980. Elle s'achève avec la violence symbolique des profanations du cimetière israélite de Carpentras, le 10 mai 1990, exactement cinquante ans après l'invasion allemande de l'Europe occidentale. Loin d'être dissuasifs, ces accès de violence s'accompagnent d'une réhabilitation de l'antisémitisme d'opinion. Dès 1987, il cessait d'être ... honteux et retrouvait la légitimité d'un discours politiquement acceptable dans les médias.
Cette "nouvelle judéophobie" s'est articulée à partir des retombées des crises du Moyen-Orient[34]. Sous couvert d'antisionisme, elle avait travaillé les esprits pendant les décennies précédentes. Le "révisionnisme" s'y est ancré pour réduire les chambres à gaz du génocide juif à un "mensonge historique" et à une "gigantesque escroquerie politico-financière"[35]. "Les principaux bénéficiaires [en étaient] l'Etat d'Israël et le sionisme international". Avec ce discours antisioniste, le négationnisme se défendait d'être "antisémite"[36]. Il recherchait "la vérité [qui ...] ne saurait pas être antisémite", prétendait-il dans sa percée médiatique. Longtemps confidentiel, il sortit des catacombes de l'extrême droite groupusculaire à la toute fin des années 1970. Se targuant de constituer une "école historique", il a pu un moment faire illusion. Mais, il est vite apparu pour ce qu'il était. Comme l'a aperçu un tribunal belge en 1991, l'entreprise négationnistes a permis "avec une légèreté insigne, mais avec une conscience claire, de laisser prendre en charge, par autrui son discours dans une intervention d'apologie des crimes de guerre ou d'incitation à la haine raciale"[37].
C'est l'extrême droite qui disqualifia ce discours à prétention scientifique. Pour l'avoir couvé au temps où elle-même était confidentielle, elle fit mine, en toute candeur, de découvrir ce "révisionnisme" au cours de son avancée électorale dans les années 1980. Elle se posait à son tour "un certain nombre de questions" et récusait toute "vérité révélée" au nom de la "liberté de l'esprit"[38]. Elle était bien sûr "hostile à toutes les formes d'interdictions et de réglementation de la pensée". Ce discours respectable l'autorisait, dans un premier temps, à banaliser tout au moins l'antisémitisme génocidaire. Il s'agissait de le vider de toute singularité historique. Il n'était pas seulement un "point de détail" de l'histoire de la seconde guerre mondiale.
La banalisation fut plus subtile. D'une pierre, l'opération fit deux coups. Elle ravalait l'événement singulier de la seconde guerre mondiale au rang de "détail" d'un "détail". Le "point" englobait les "camps de concentration où moururent par million, juifs, tsiganes, chrétiens et patriotes de toute l'Europe et les méthodes employées pour les mettre à mort : pendaisons, fusillades, piqûres, chambres à gaz, traitements inhumains, privations"[39]. Ce discours réducteur du génocide juif renvoyait le public à sa propre représentation tronquée. La mémoire historique du temps présent pratique en permanence l'amalgame symbolique du "camp de concentration et d'extermination" et la confusion mythique du génocide avec la mort concentrationnaire[40]. Le "point de détail" se joua de cet embrouillement des notions d'histoire[41] pour tenter, à sa manière, de faire "passer un passé qui ne veut pas passer"[42] dans la France du "syndrome de Vichy"[43].
Cette banalisation du génocide juif inscrite dans l'air du temps est le passage obligé d'une entreprise plus du tout banale. Elle débordait l'hexagone français. Même en Belgique, l'extrême droite la plus radicale et ses nostalgiques du national-socialisme, néo-nazis et chevaux de retour fraternellement unis, s'extasièrent de leur vertu retrouvée.
Le rendez-vous judiciaire du "révisionnisme"
Les magistrats belges avaient été confrontés - juste avant l'adoption de la loi Moureaux - à une autre protestation contre "la haine, l'intolérance et le fanatisme" dont les adeptes non allemands du nazisme auraient enduré "l'aveuglement et la bêtise" pendant les ... "années 1945- 1950" [47]. En 1979, des fidèles rexistes s'étaient cru autorisés à diffuser en Belgique un écrit "révisionniste" de leur chef historique. Il tombait sous le coup de la loi. Léon Degrelle condamné à mort par contumace et toujours réfugié en Espagne, était interdit de toute activité politique en Belgique. Sa Lettre au Pape - sur le point d'aller prier à Auschwitz - reprenait les arguments du négationnisme "révisionniste". Comme le notèrent les magistrats belges, l'ancien officier belge de la Waffen SS tentait de justifier par ce biais "les crimes politiques pour lesquels il fut condamné et déchu" . Il s'essayait à "convaincre l'opinion de ce que le régime nazi auquel il avait voué sa vie, a été calomnié lorsqu'il a été accusé d'avoir assassiné des millions d'individus pour la raison unique de leur race"[48].
Dix ans plus tard, pour faire passer ce "révisionnisme", ce fut le jeune nazi franco-belge qui multiplia les provocations. Il lui fallait une tribune, fut-ce devant un tribunal. En vain, il avait tenté de le fourguer à l'Université. Sa manoeuvre, préparée par publipostage, visait celle du Libre-Examen, à Bruxelles. Par usurpation, il tenta même de prendre pied sur le campus. La réplique fut cinglante. L'U.L.B. n'acceptait pas "que sous couvert du libre examen et de la tolérance qu'elle pratique, des individus puissent se faire impunément les propagandistes du racisme et d'idées susceptibles de ruiner les valeurs humanistes et démocratiques dont elle se réclame"[49]. Les historiens de cette Université, faisant leur "boulot", avaient, pour leur part, refusé aux productions d'"histoire exécrable" de la prétendue "école révisionniste" la reconnaissance scientifique escomptée[50]. Réduit à chercher sa tribune dans le prétoire, le négationnisme faillit l'obtenir ... à cause de la Communauté juive. Comme en France, elle fut tentée de céder à la provocation. Partie civile, elle jugea qu'un "procès" dans une telle affaire ne serait "rien [de] moins qu'une des composantes de la préservation de la Mémoire , de notre Mémoire collective"[51]. Ce procès pouvait "conditionner - entre autres - ce que sera, ou ne sera pas, l'antisémitisme de demain, dans ce pays". La partie civile s'attendait à la venue des "gros bras" du "révisionnisme" français et elle s'apprêtait à relever le défi, sur leur propre terrain. Dans cet égarement, elle avait pensé leur "oppos[er] la réalité historique". Elle faillit même présenter "à la Justice tous les éléments nécessaires pour que cette réalité historique soit juridiquement reconnue de sorte que le jugement qui interviendra puisse faire jurisprudence et venir étayer la loi existante du 30 juillet 1981 en ce qui concerne les actes de racisme et d'antisémitisme" .
Le procès - et les magistrats y contribuèrent sagement - évita tout dérapage. La loi Moureaux, inspirée du modèle français de 1972, ne crée "guère de difficultés" aux tribunaux pour "condamner les auteurs de thèses "révisionnistes" sur cette base"[52]. Même si elle ne définit pas l'injure antisémite, elle "établit", estiment les magistrats, "l'infraction d'incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou de leur origine nationale ou ethnique en des termes suffisamment larges". S'en tenant exclusivement à l'enjeu juridique, "le tribunal qui ne se reconnaît ni la qualité, ni la compétence de juger de l'histoire" ne fut pas dupe de "propos, procédant par un amalgame d'idées qui relèvent plus du discours politique que de la recherche scientifique"[53]. Certes, le jugement diagnostiquait très précisément "l'intention [...] de réhabiliter les auteurs des théories racistes qui sont à l'origine de la déportation et de l'anéantissement de millions de Juifs". Mais, pas plus qu'il n'incombait à la justice de se prononcer en matière de vérité historique, il ne lui appartenait de sanctionner "la liberté d'expression" qu'en cas d'"appels à la haine et à la discrimination" et "à la violence contre la communauté juive" en l'occurrence. Ce que le tribunal bruxellois fit, en la circonstance, avec une particulière sévérité. Sous la plume de son chroniqueur judiciaire, un grand quotidien de la capitale titra sur "la lourde condamnation" du "révisionniste"[54]. Le compte rendu de ce "jugement courageux" se félicitait que "racisme et calomnie ne passent plus au bleu".
Dans ce cas d'espèce d'une facture délibérément nazie, le prétendu "révisionnisme" s'était révélé sans la moindre ambiguïté. L'arrêt belge n'eut aucune peine à y lire une entreprise idéologique et politique visant à "provoquer des réactions passionnelles d'agressivité" contre "la communauté juive"[55]. Coulée en des termes compatibles avec la loi Moureaux, cette qualification caractérise la démarche ordinaire de l'antisémitisme dans l'histoire comme dans le présent. Habitué des prétoires des années 1990, le chroniqueur judiciaire conclut que la "loi de 1981 [...] réprime les actes inspirés par le racisme, l'antisémitisme ou la xénophobie" [56]. En fait, la loi Moureaux autrement intitulée n'avait pas pris en compte "la nouvelle judéophobie" des années 1970-1980. La législation française qui l'inspirait, plus ancienne, avait précédé en 1972 les développements les plus caractéristiques du phénomène nouveau.
Le "révisionnisme" négateur du génocide juif n'en a été qu'un des symptômes. Son passéisme apparent a pu faire illusion à une mémoire collective scandalisée et outragée. Elle y a lu - et elle n'avait pas tort sur ce point - une tentative de "blanchir" le IIIe Reich et de le "laver de ses crimes" en l'innocentant de ses crimes contre l'humanité afin de le "banaliser". Le rapport au passé ne dit cependant pas tout du ressort "révisionniste". L'articulation antisioniste de son discours en révèle le "sens politique". En faisant passer ses thèses négationnistes, il assure une "victoire idéologique absolue des ennemis des Juifs, par-delà celle des ennemis d'Israël"[57]. Instrument de cette nouvelle judéophobie particulièrement adapté au temps présent et à son imaginaire collectif, le "révisionnisme" ne saurait être dissocié des manifestations plus traditionnelles de l'antisémitisme. Non pas qu'il les autorise, comme on a pu l'imaginer sous le choc des 34 tombes profanées au cimetière israélite de Carpentras, en 1990.
Le public bouleversé y a vu les retombées de "l'action de l'extrême droite" dans la société française et de "l'oubli de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre"[58]. Les profanations de cimetières israélites n'avaient pourtant rien de nouveau. Les tombes israélites étaient tout autant renversées dans les années 1970. En ce temps, l'extrême droite et le révisionnisme encore confidentiels n'exerçaient pas cette influence "en profondeur" que le désarroi de l'opinion leur impute après la décennie suivante[59]. L'effet Carpentras n'en a pas moins eu un résultat pervers. Sous le choc, le législateur français se fit un devoir de contrer le "révisionnisme" par le recours à la loi. Il passa outre les mises en garde les plus autorisées d'historiens nullement complaisants. Il déclara "illégales" les prétendues "thèses révisionnistes" des négateurs du génocide et "non pas scandaleusement erronées"[60]. Leurs auteurs pouvaient enfin quitter "le coin où les historiens faisant bien leur métier, sont capables de les reléguer avec un bonnet d'âne"[61]. La loi Gayssot du 13 juillet 1990 les convoquait devant les magistrats pour contestation d'un crime contre l'humanité ayant entraîné des condamnations de ce chef par le Tribunal militaire international de Nuremberg ou une juridiction française.
A son tour, la Belgique , secouée par la percée de ses extrêmes droites aux élections législatives de novembre 1991, a envisagé, dès la session parlementaire, d'adopter également une "loi tendant à réprimer la contestation, la remise en cause et la négation ou l'apologie des crimes de guerre"[62]. Dix ans après la loi Moureaux sur "le racisme ou la xénophobie" - votée dans la hâte -, le parlementaire découvrait une spécificité à "l'antisémitisme". Il s'apercevait tardivement que "l'exclusion et la haine, le racisme et l'antisémitisme prennent une place de plus en plus inquiétante dans notre espace public". Dans ce constat attardé, la xénophobie perdait son privilège légal de 1981. L'analyse - passéiste dans son inspiration - s'obnubilait sur la "résurgence de la barbarie" parmi les "menaces qui guettent notre démocratie".
La décennie 1990 débutait pourtant avec une autre histoire, même à l'extrême droite, miroir caricatural des représentations du temps présent. Tout comme l'antisémitisme s'y était précédemment converti en un antisionisme de bon aloi, son racisme avait lui aussi mué dans les dernières décennies. Il n'était plus "biologique" à la manière par trop gâchée du précédent nazi. L'extrême droite ne pratiquait guère plus la "discrimination", "la haine" , la "violence à l'égard d'une personne en raison de sa race" comme le définissait la loi Moureaux. Ce racisme s'était mis à l'air du temps. Nationaliste, il s'est voulu culturaliste, différentialiste, ethnocentriste, en un mot xénophobe. La "purification ethnique" et le déchaînement des violences xénophobes en Europe ne sont pas des "résurgences" du passé. Ils sont les innovations barbares du temps présent. On se trompe d'histoire en croyant qu'elle se répète. On se trompe sur le passé comme on se trompe sur le présent et, dans l'erreur, on risque, comme souvent, de manquer le rendez-vous avec l'histoire.
La dérive de la mémoire: le cas Fonséca